
État d’urgence sanitaire : Vous reprendrez bien un peu de dystopie ?
Le 1er mai, une distribution alimentaire gratuite avait lieu à Montreuil mais s’est rapidement vue encerclée par des BRAV-M (les voltigeurs) et de nombreux véhicules de police. Ce beau monde a distribué moult contraventions pour « participation à une manifestation interdite par arrêté municipal », la manif’ étant déduite de la présence de banderoles dites « revendicatoires » (sic), accrochées autour du point de distribution.
« Sanctionner le gens pour des actions politiques relèverait-il officiellement des missions de police » s’interroge-t-on alors ? Il est vrai qu’aujourd’hui, exprimer son avis par banderole, surtout si c’est un avis de lèse-Macron, ce n’est pas sans conséquences.
Mais l’état d’urgence sanitaire, c’est bien ça : il transforme la prévention du risque en une politique disciplinaire, particulièrement profitable : un grand nombre d’ordonnances passées depuis mars ne concernent pas directement la crise sanitaire (31 en tout rapporte Bastamag) et les arrêtés préfectoraux se sont eux aussi multipliés, chacun·e y allant de son idée pour régenter.
L’état d’urgence sanitaire est loin de ne répondre qu’à un problème de santé. Il a aussi renforcé un régime politique où le pouvoir est concentré dans les mains de l’exécutif qui peut agir de manière discrétionnaire, comme l’analyse un collectif espagnol. Ceci alors même que les lois qui existaient avant la mise en place de l’état d’urgence sanitaire permettaient déjà de prendre des mesures fortes et contraignantes, tant pour la durée du travail que pour mettre en place une réponse sanitaire à la pandémie.
Les ordonnances prises pendant cet état d’urgence concernant l’augmentation du temps de travail devaient concerner des « secteurs particulièrement utiles ». Or aucun secteur n’a été jusqu’à présent déclaré particulièrement utile et l’exécutif peut garder ses ordonnances sous le coude pour une application future...
L’état d’urgence sanitaire lui-même est inséré dans le code de la santé publique, ce qui constitue un indice de sa pérennisation possible pour le juriste Paul Cassia.
D’aucun·es souhaiteraient sans doute aussi que quelques dispositions actuelles du domaine juridique puissent perdurer. Les procès par visioconférence, par exemple. L’avocat Anis Harabi nous rappelle qu’ils sont en tout cas dans la droite ligne des projets de réformes des procédures pénales des années précédentes. Et il indique que le procès à juge unique, sans témoins, avec un·e prévenu·e et un·e avocat·e à distance par téléphone ou visio (lorsque cela fonctionne), images de films un peu glauques, est possible grâce aux ordonnances d’aujourd’hui. Et ça a quand même l’air plus simple ainsi, non ?

Le gouvernement, via l’état d’urgence sanitaire, a réduit le rôle des institutions judiciaires à punir et enfermer. Portion congrue, mais tellement importante pour lui. Les crises sanitaires ont par le passé déjà été des occasions de favoriser des « dictatures de la commodité », qui mettent en place ce dont l’État a besoin : de quoi punir, enfermer, et aussi contrôler.
Tout ça pour que puisse continuer à se faire le jeu de l’économie, dans un monde où des sous pour l’hôpital, c’est compliqué, mais des sous pour des entreprises qui se dissimulent dans des paradis fiscaux, ça a l’air faisable.
Alors, certains s’insurgent : « la pandémie n’a rien d’une catastrophe naturelle, elle est le fruit d’un rapport social, l’économie marchande » et dénoncent un « chantage à la survie ». Aux États-Unis, d’ailleurs, où les manifestations pour reprendre le travail incluent armes et drapeaux, CrimethInc se demande « qu’est-ce qui vaut la peine de mourir ? », en observant qu’une interprétation individualiste et compétitive pourrait pousser à se dire que, plus la classe ouvrière est réduite, meilleures seront les chances de celleux qui restent.
Mais ici, tout va bien. On pourra toujours aller bosser dans un entrepôt de livraison puisqu’il y aura toujours des gentes pour consommer. Un jeu de rapidité mesurée au son de bip, stimulant non ?
Sinon, plus souple et arrangeant, le travail du clic à domicile : un travail à la tâche autorisé en France tant que la rémunération - ramenée au temps de travail -, est supérieure au salaire minimum... (comprenez l’arnaque ici, et plongez plus profond en vidéo par là et par ici).
Et si vous en avez marre et que vous voulez demander des comptes à celleux qui sont tout là-haut, sachez qu’ielles ont envisagé une parade. Un aménagement législatif, décrit ainsi par la députée LREM Aurore Bergé : « Nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires pénalement mais aussi toutes les personnes dépositaires d’une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement. ». Traduction : la responsabilité pénale des décideurs publics de l’État dans la gestion du déconfinement ne serait plus mise en cause, ce qu’un juriste décrit comme une « Auto-amnistie préventive de la Macronie ».
Cette Macronie s’étant déjà brutalement émancipée de la Constitution sous couvert de circonstances exceptionnelles (qui n’étaient en fait pas si exceptionnelles, comme expliqué ici), elle semble bien pouvoir nous dire « Et alors ? »
Toute ressemblance avec un présent que nous ne souhaitons pas n’est pas complètement fortuite. Cependant, le réel est pire encore.

Tabac : les médias s’emballent autour d’une hypothèse qui affirme que la nicotine permettrait de lutter contre le Coronavirus
L’industrie du tabac fait partie des entreprises capitalises les plus meurtrières. Pour vendre leurs produits, on sait depuis longtemps que les industriels ont utilisé de nombreuses techniques de propagande : par exemple, en instrumentalisant le féminisme pour augmenter leurs ventes, en achetant des publicités cachées dans les films ou en semant le doute scientifique sur la nocivité de la cigarette.
On n’est donc pas surpris·es de voir que les cigarettiers essayent de profiter de la crise du Covid-19 pour redorer leur blason : ainsi les industriels communiquent sur le fait qu’ils cherchent actuellement un vaccin. De futurs sauveurs de l’humanité à n’en pas douter. Peut-on se permettre de critiquer la privatisation des laboratoires de recherche pour faire de la publicité à des industries aussi meurtrières ?
Et une autre information enrage le milieu antitabac : le communiqué de presse récent sur l’hypothèse que la nicotine servirait à la lutte contre le Covid-19 repris sans aucune précaution par la presse française.
On souhaite rappeler à ce stade qu’il ne s’agit que d’un communiqué de presse, et qu’il s’agisse de l’hypothèse d’un neurobiologiste ou d’un boulanger ne change pas le statut de cette hypothèse : il n’y a actuellement aucun début de preuve sur le fait qu’elle puisse être vraie si ce ne sont des observations trop légères pour communiquer dessus. Cela n’a pas empêché les médias de la relayer sans précaution et il y aurait eu une ruée sur les patchs anti-nicotine dans les pharmacies.
La Gazette souhaite rappeler qu’il est prouvé que la nicotine est nocive et que, même dans le cas où elle aurait un effet positif contre le Covid-19 - ce qui est loin d’être prouvé -, le rapport bénéfices-risques a de grandes chances d’être en défaveur de la nicotine dans l’état actuel des connaissances.

Un article d’Acrimed remarque justement que dans cet emballement médiatique ont été oubliées deux informations particulièrement importantes. D’abord, le fait qu’aucune étude concluante n’a été publiée et ensuite le fait que l’auteur, Jean-Pierre Changeux, a eu des liens avec l’industrie du tabac il y a une dizaine d’années. Les industriels affirment que cela n’est plus le cas aujourd’hui.
Ne cédons pas trop rapidement au complotisme sur ce sujet, néanmoins on peut quand même fortement regretter l’absence de recul des médias et cela peut avoir de graves conséquences car la cigarette tue. Il est tout à fait possible que ces informations encouragent des gens à continuer de fumer ou même à commencer à fumer, ce qui arrange bien l’industrie du tabac.
Si vous voulez arrêter de fumer et de donner de l’argent à ces entreprises destructrices, n’oubliez pas qu’il existe des sites web pour aider comme Tabac info service et des alternatives aux drogues les plus courantes. Faisons cependant attention à ne pas tomber pour autant dans la culpabilisation stérile des fumeur·euses alors qu’il existe de nombreux déterminants sociaux à la pratique tabagique.
On a parcouru la nouvelle carte de France des luttes au travail

Après la carte du déconfinement à la méthodologie aléatoire, voici celle des colères au travail, mise en ligne par des militant·es. Si celle-ci vire au rouge, c’est le patronat et le gouvernement qui pourraient tousser.
« Colère covid » est en ligne depuis le 1er mai. « Une manière de faire vivre cette date symbolique dans ces conditions particulières », expliquent ses créatrices et créateurs anonymes. Tout juste devine-t-on un lien avec la plateforme #Covid-entraide, dont nous vous parlions dès notre première Gazette des confiné·es.
Cette carte participative doit servir à recenser les luttes en cours dans le monde du travail. Des conflits ont éclaté pendant le confinement, « mais rien, à notre connaissance, ne permettait de relever le nez et de penser ce phénomène à une échelle plus large », poursuivent les internautes qui épluchent donc la presse locale pour donner de la visibilité aux grèves, droits de retraits et autres expressions du rapport de force entre le travail et le capital.
Un rapide survol de cette France en lutte nous permet de vérifier la sur-représentation des entreprises liées à la distribution et à la vente en ligne. On pense bien sûr à La Poste et à Amazon, qui ont défrayé la chronique. C’est aussi le cas des livreuses et livreurs de Deliveroo et UberEats à Lyon, parfait·es représentant·es de cette nouvelle classe ouvrière hyper-précarisés, aux salarié·es de La Redoute à Wattrelos, d’Orchestra près de Montpellier, de Fedex à Roissy ou d’Oscaro.com à Cergy-Pontoise et Argenteuil.
Les premiers de corvée du nettoyage à l’industrie
Plusieurs sociétés du secteur des déchets et de la propreté ont connu des tensions au sujet - et c’est un comble -, de l’hygiène. On le remarque chez La Pyrénéenne, dont les employé·es nettoient la gare de Toulouse, à Rimma et Urbaser Environnement, dont les éboueur·ses ramassent respectivement les poubelles à Nancy et Poitiers, ainsi que chez Atalian, sous-traitant du groupe Carrefour en Île-de-France.
Le site permet aussi de localiser rapidement quelques affaires emblématiques de la désindustrialisation du pays. Au nord de Clermont-Ferrand, les ex-Luxfer demandent la nationalisation de cette usine qui était capable de produire des bouteilles d’oxygène médicales, jusqu’à sa fermeture l’an dernier. La mobilisation a permis d’empêcher la destruction des machines et les ouvrièr·es estiment pouvoir fournir leur première bouteille en moins de deux mois. Toutefois, malgré des relais politiques et médiatiques, l’État ne bouge pas.

Près de Saint-Brieuc, les ancien·nes d’Honeywell avaient perdu tout espoir depuis leur licenciement, en 2018. La dernière ligne de montage de ce qui fut la plus grande usine de masques médicaux de France après l’épidémie de Sras en 2003 a été découpée puis envoyée à la casse. Toutefois, la crise sanitaire leur donne de nouveaux arguments. Le syndicat Solidaires Côtes-d’Armor a proposé la création d’une coopérative ouvrière se reposant sur ces travailleur·ses et leur savoir-faire. La région Bretagne a lancé une mission pour vérifier la faisabilité du projet. Une promesse de commande formulée par Emmanuel Macron a attiré quelques vautours de la finance le bec rempli d’oseille. Rien n’est fait.
Quelques fleurons industriels ont connu des refus de reprendre le travail. Des mouvements ont été suivis sur Les Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, chez Renault au Mans et Valenciennes ou PSA, notamment à Sochaux. Citons aussi la grève appelée par Sud et la CGT sur le site de traitement des déchets nucléaires Orano (ex-Areva) situé à La Hague, dans la Manche, en avril.
Silence radio dans l’agri-agro
Dans le même département, une trentaine de soignant·es de l’hôpital de Guingamp ont débrayé mercredi 5 mai à l’appel de la CGT. La question des plannings tend les relations déjà dégradées par la diminution du nombre de lits. Le personnel craint « ne pas pouvoir affronter la deuxième vague de l’épidémie s’il y en avait une », rapporte Le Télégramme. Le 1er mai, 17 syndicalistes ont été verbalisés après avoir défilé en voiture entre l’établissement et un Ehpad de la ville.
Si l’heure est encore à la lutte contre le Covid-19 dans une bonne partie des centres hospitaliers du pays, un conflit social a également éclaté le mois dernier à l’hôpital psychiatrique Le Vitanier, à Lyon, contre un plan d’économies.
En revanche, un autre secteur dont l’activité a été maintenue voire augmentée depuis le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire se fait très discret. L’agroalimentaire semble laver son linge sale en famille. On compte bien des mouvements éparses chez Jacquet-Brossard, dans le Puy-de-Dôme, Vandemoortele, à Reims, Marie Surgelés à Airvault dans les Deux-Sèvres et Fromarsac, en Dordogne, mais c’est une goutte d’eau comparé au poids des abattoirs, entrepôts de stockage et autres usines de congélation qui parsèment la campagne.
Ainsi, « Colère Covid » ne recense pas la moindre action dans ce secteur en Bretagne, pourtant première région d’élevage. Les patrons le savent, les intérimaires ne se syndiquent pas. Quant au BTP, qui regroupe de très petites et moyennes entreprises, il est tout simplement absent de la carte.
Les résistances d’aujourd’hui alimenteront-elles celles de demain, comme l’espère l’équipe derrière « Colère Covid » ? En tout cas, les risques de contamination, les carottes qui se transforment en bâtons, le stress qui s’ajoute à la fatigue et tout simplement les menaces sur l’emploi risquent de former un cocktail explosif dans les prochains mois. Les responsables de tous bords seraient biens inspirés de lire le rapport d’enquête publié par l’UGICT-CGT mardi 5 mai, à partir de 34.000 réponses de salarié·es. A moins de souhaiter voir cette carte des luttes se remplir irrésistiblement.
« Nous, enseignant·es, sommes désolé·es que l’école rouvre dans de telles conditions »
Puisque Macron le veut, il en sera ainsi : les écoles rouvriront le 11 mai. Avec un protocole sanitaire dense, mais néanmoins épuré au cours de versions successives. Le 30 avril, le Café pédagogique notait bien que les personnels de l’Éducation nationale devaient recevoir deux masques par jour de travail... et le 3 mai, parmi l’allègement des règles sanitaires, il repère que cette distribution de masques a disparu et qu’ils ne doivent plus obligatoirement être portés en cours.
En revanche, ça ne s’allège pas pour les enfants, qui, à part rester assis à une table, ne pourront pas faire grande chose. Une tribune d’enseignant·es et d’intervenant·es à l’école n’hésite pas à qualifier les règles auxquelles les enfants seront soumis de maltraitance et à dénoncer une « expérience de psychologie sociale à grande échelle ».
Ces règles placent aussi le personnel éducatif dans une position intenable et particulièrement paradoxale : en faisant respecter les règles du protocole de sécurité, les enseignant·es, Atsem et AESH nient les besoins des enfants et des bases pédagogiques. Et s’il ne les fait pas respecter, il se met en faute.
Ce qu’il faut à l’État, ce ne sont pas des personnels de l’Éducation nationale, ce sont des matons.

Les enseignant·es sont par ailleurs bien conscient·es que le positionnement du gouvernement en faveur de la réouverture des les écoles pour des questions de justice sociale n’est que du flan : il s’agit bien plus de remettre les parents au boulot. Des argumentaires contre la réouverture des écoles sont développés et les personnels de l’Éducation nationale s’organisent aux côtés d’autres secteurs, notamment en tenant des assemblées générales interprofessionnelles à distances, qu’on peut suivre sur un réseau social bien connu (sans compte).
Et finalement, les enseignant·es s’adressent aux parents et à toustes les autres, puisque ni leur ministre ni le gouvernement n’est capable de prendre conscience de ce que signifie réellement enseigner.
Nous vivons dans un univers bien plus riche, bien plus imprévisible : le « réel » ! Et dans ce réel, les enfants, comme les adultes, ne respectent pas toujours les règles. Les enfants attendent avec impatience de retrouver leurs camarades. Qui peut sérieusement imaginer qu’ils seront capables, huit heures par jour, de respecter tous les gestes barrière, toutes les consignes données, toutes les mesures de protection et toutes les distances de sécurité ? Qui peut sérieusement penser que les enfants pourront réprimer leurs envies et leurs besoins de contact, de chaleur, de câlins et d’humanité ?
Le Coronavirus expose au grand jour le scandale du financement de la recherche scientifique par projets
C’est une information qui a vite été oubliée dans les médias, peut-être parce qu’elle donnait un peu trop raison aux gréves récentes dans l’ESR (enseignement supérieur et la recherche) : un chercheur spécialiste du coronavirus, Bruno Canard, explique qu’il n’a pas reçu assez de financements pour sa recherche sur le Coronavirus.
Pourtant, il avait - avec d’autres -, alerté la Commission européenne en 2015 sur les risques d’émergence de virus épidémiques au sein de plusieurs familles de virus, dont les flavivirus (comme l’épidémie de Zika en 2016) et les coronavirus (comme l’épidémie du Covid-19).
Pourquoi n’avait-il plus suffisamment d’argent pour que son équipe continue de travailler dans de bonnes conditions ? Parce que le sujet n’était pas à la mode, tout simplement !

Car maintenant, la recherche se finance en grande partie sur projet, c’est-à-dire que des bureaucrates, par exemple ceux de l’ANR (Agence nationale de la recherche), décident où l’argent public va être investi, dans quels projets.
Ces bureaucrates, ce sont les président·es d’universités, des instituts, etc. Iels ne font plus de recherche, iels participent au mercato des directions d’instituts et d’universités... Ainsi, le président actuel de l’ANR, Thierry Damerval, a enchaîné entre 1996 et 2020 les fonctions suivantes : conseiller du secrétaire d’État à la Recherche, directeur de la stratégie et de l’évaluation au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), conseiller technique auprès du premier ministre, directeur de l’Inserm pendant dix ans et finalement directeur de l’ANR.
Plus simplement, cette personne n’a eu que des fonctions de direction, grassement payées (plus de 190.000 euros par an à l’Inserm), depuis 1996 sans jamais toucher à la recherche depuis le début de sa carrière de bureaucrate.
Et tout ce fonctionnement coûte un argent fou : l’ANR, censée distribuer de l’argent à la recherche, pompe 9 % de son budget pour financer son propre fonctionnement, en constante progression depuis 2005. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg des appels à projets (AAP) : un rapport du syndicat Snesup-FSU estime que 90 % des financements des laboratoires (équipes de recherches) viennent d’appels à projets contre seulement 10 % de financements pérennes.
Tout cela fait que les chercheur·ses perdent un temps de plus en plus important à écrire des rapports inutiles et à chercher des financements. Dans le rapport du Comité national de la recherche scientifique de 2019 (pdf) il est écrit :
Le temps collectif consacré à l’allocation de crédits par appels à projets compétitifs (conception des appels à projets, rédaction des projets, processus d’évaluation, contrôle projet par projet) est disproportionné, sans parler du coût économique correspondant, estimé dans certaines études comme supérieur aux montants distribués (notamment par l’ANR).
Le mot projet est particulièrement important dans la novlangue managériale et bureaucratique, comme le rappelle le dictionnaire de la langue de bois de la Scop Le Pavé dont fait partie Franck Lepage (pdf).
Il a le grand avantage d’être éphémère : un projet de recherche ça a un but et une fin, c’est une marchandise que la hiérarchie achète aux chercheur·ses.
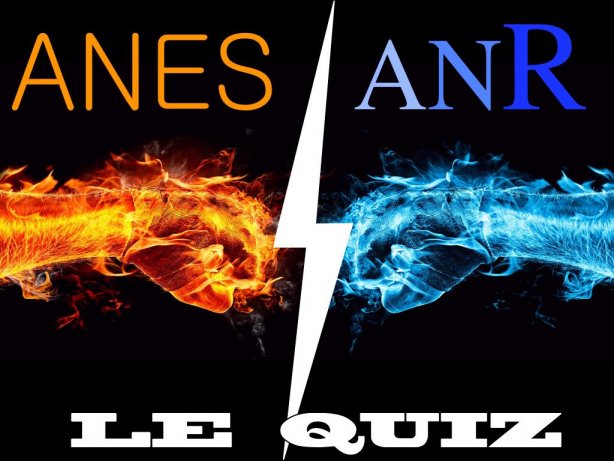
Ainsi, la langue de bois fait son rôle, il est beaucoup moins risqué de parler de financement par projet de la recherche que de choix par la hiérarchie des sujets de recherches. Et comme on peut le constater dans l’exemple du Coronavirus, le pilotage de la recherche par une hiérarchie incompétente est complètement inefficace pour déterminer les sujets importants pour l’avenir.
La bureaucratie universitaire normalise les comportements via l’utilisation d’indicateurs : vers une science encore plus au service de l’économie ?
Pour évaluer et contrôler les chercheur·ses, les bureaucrates utilisent leur principale arme de normalisation : les indicateurs, imposés comme neutres et objectifs aux chercheur·ses.
Dans la recherche, on parle d’indicateurs bibliométriques et ceux-ci, grossièrement, comptent le nombre de productions sous forme d’articles dans des journaux indexés des chercheur·es, ainsi que leur ré-emploi dans d’autres articles. Comme pour tout indicateur, le but des chercheur·ses n’est alors plus de découvrir des choses intéressantes pour la société mais de maximiser l’indicateur.
Cela donne de nombreux effets pervers qui sont très bien illustrés de manière humoristique dans cet article : multiplication des articles pourris, des revues prédatrices (qui font payer la publication aux chercheur·ses souhaitant améliorer leur indicateur), baisse de qualité des articles, etc.
Dans le cas du Covid-19, on peut regarder le nombre de publications sur le Coronavirus : plus de 24.000 en 2020. Quelle est la balance entre des contributions honnêtes motivées par l’urgence et des articles pourris écrits uniquement pour surfer sur un phénomène de mode ? Dur à dire mais ces dernières représentent probablement une grande partie vu l’effet de mode. Publiez sur le Coronavirus et vos indicateurs bibliométriques auront de grandes chances de bondir !
Et pendant ce temps, l’avancement des connaissances ? Il est clairement ralenti par le fait de devoir trier les articles bien faits dans cet océan de productions écrites uniquement pour faire du chiffre.
Mais comment expliquer qu’on organise ce désastre ? Ce qui est sous le coup d’indicateurs est mesurable, quantifiable... et donc « marchandisable ». En effet, la science et la bibliométrie rapportent beaucoup aux grands éditeurs privés que sont Elsevier, Springer, Wiley Blackwell’s et Taylor & Francis.
De plus, « marchandiser » signifie aussi identifier ce qui rapporte. Pour l’argent investi, on est capables d’analyser le tout sous l’angle de l’investissement et des retours sur investissement (c’est le même processus que dans les hôpitaux publics, voir à ce sujet La Casse du Siècle, documentaire téléchargeable en ligne, notamment les chapitres deux et trois).
Et voilà que le tout s’insère dans les processus de capitalisation. La recherche publique et ses fonds publics peuvent ainsi être orientés vers les domaines les plus profitables pour les entreprises privées. Le contrôle de la recherche par le monde économique est aussi facilité.
Selon les domaines, en fonction de leurs enjeux, les ressources pourraient bien se tarir si la critique du système dominant se fait trop forte... Si toutefois cette critique n’est pas récupérée avant par le système, via par exemple du green-washing, ou des équivalents.
Parmi les produits de la recherche particulièrement « marchandisables », citons les innovations, et notamment celles qui se rattachent aisément à la société de consommation.
Les jeunes chercheur·ses qui auront produit des résultats un tant soit peu « marchandisables » pendant leurs travaux d’entrée en recherche (doctorat, post-doctorat) sont ainsi aujourd’hui incité·es à créer des start-up pour « valoriser » ces résultats. Entretenir un monde où tout se vend, où leur savoir devient marchandise.
Et ces innovations-marchandises, en plus de rapporter de l’argent, justifient en entier tout le système capitaliste ; en 1967, dans la société du spectacle, Guy Debord écrivait :
Dans l’image de l’unification heureuse de la société par la consommation, la division réelle est seulement suspendue jusqu’au prochain non-accomplissement dans le consommable. Chaque produit particulier qui doit représenter l’espoir d’un raccourci fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation totale est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive. [...] Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu’il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà c’est un autre objet qui porte la justification du système et l’exigence d’être reconnu.

Ainsi, le groupe Oblomov va jusqu’à conclure dans son livre qu’il ne faut pas sauver la recherche scientifique car elle est intrinsèquement au service des dominants et du capitalisme.
Des écoféministes accusent la science moderne, rationnelle et aux dichotomies fortes (dont nature vs. culture), d’être à l’origine du désastre environnemental [1].
Et, au-delà de refuser l’opposition entre recherche fondamentale et recherche appliquée, qui sont complémentaires et produisent chacune des innovations à plus ou moins longs termes, reconnaissons aussi d’autres façons de pratiquer la recherche. Comme par exemple la recherche impliquée, ou recherche-action. Lorsqu’elle n’est pas seulement un mot-clef destiné à vendre une réponse à un appel à projets, elle propose une transformation délibérée de la réalité pendant le processus du recherche, avec une implication des chercheur·ses et un réel dialogue avec les personnes rencontrées dans cette recherche.
À propos de l’éducation, Ivan Illich disait qu’elle est un outil de production, en tant qu’institution productrice de savoir et que, passé un certain seuil, toute institution, ou outil de production, ne vise plus que son auto-reproduction et devient destructeur (voir Pédagogie et Révolution, en accès libre chez Libertalia, chapitre sur Illich).
L’institution (l’éducation) est alors confondue avec le besoin fondamental (l’éducation) ; et l’apprentissage est confondu par commodité avec la fréquentation scolaire : mesurable, quantifiable... « marchandisable ». De même qu’Illich proposait de « déscolariser la société ? » (traduction littérale du titre original de son ouvrage Deschooling Society, paru en français comme La Société sans école), pouvons-nous trouver un moyen de nous réapproprier la production et la transmission des savoirs scientifiques ?


