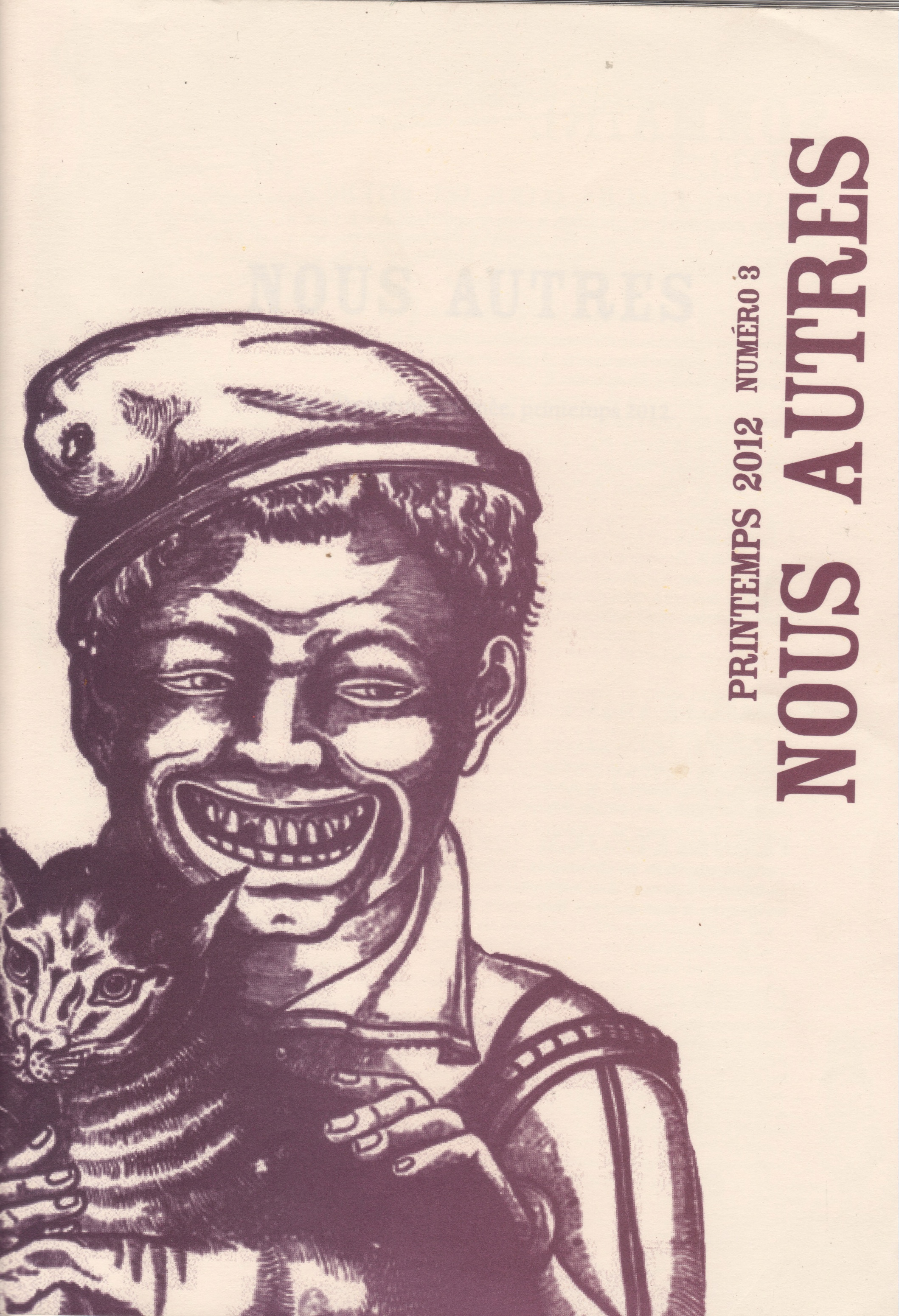
Qui ne tente rien n’a rien (présentation)
Depuis quelques temps, nous ressentons le besoin, entre camarades, de dresser le bilan de l’expérience militante accumulée en Espagne parmi les anarchistes, les communistes et les autonomes qui gravitent autour de l’idée « d’insurrection ». Pour deux raisons. La première, c’est le constat qu’une page a été tournée. La situation, dix ans après – et même cinq ans après –, n’est plus la même, et nous voulons en tirer d’utiles enseignements pour mieux affronter les batailles qui s’annoncent, non dans un hypothétique avenir, mais au coin de la rue. Pour cette raison, il est absolument nécessaire d’ouvrir un débat, ou au moins de provoquer une réflexion.
La deuxième raison qui nous pousse à écrire est l’ignorance absolue des faits survenus ces dix dernières années de la part des nouvelles générations de camarades. Cette ignorance, il faut le reconnaître, résulte en grande partie de la place qu’a prise entre nous la (non-)communication par internet, qui a presque remplacé le contact et la connaissance directs. Cependant, elle donne aussi la mesure de notre incapacité à ériger des modèles auxquels ces jeunes camarades puissent s’identifier : des luttes et des regroupements qui auraient permis à ce remarquable élan combatif de durer et de s’amplifier.
Cet échec est celui de ce qu’on a appelé « l’organisation informelle ». Et avec les années, nous nous rendons compte qu’il était inscrit dans les principes mêmes que nous avions adoptés. Malgré cela, nous ne regrettons rien, nous ne pensons pas avoir perdu notre temps, ni que nos camarades aient perdu le leur. Il est facile aujourd’hui de contempler un amas de cendres et de dire que « tout ceci a été une erreur », que les gens ont tout simplement « pété les plombs ». Cette fausse critique passe sous silence la situation particulière de ces dix dernières années, soit qu’elle ne la connaisse pas, soit qu’elle fasse mine de ne pas la connaître. Elle nous ramène au point de départ — aux grossières illusions de l’anarchisme officiel ou à la joyeuse inconscience des jeunesses radicales — , et contribue ainsi à ce que les erreurs se répètent indéfiniment, à l’intérieur de ce « temps cyclique » typique des milieux politiques qui se tiennent à distance de l’histoire.
Il est beaucoup plus difficile, et bien moins commode pour tout un chacun, d’entamer une analyse dialectique des événements. Les conditions qui étaient les nôtres au départ ne nous laissaient guère d’issue, et ce qui devait arriver arriva. L’épidémie de rage n’a pas été qu’une nouvelle mode esthétique/idéologique du ghetto : toutes les idées qui ont été formulées ont été éprouvées jusqu’à leurs ultimes conséquences. Bien que les résultats en aient été souvent catastrophiques, il s’est agi d’une expérience collective digne de ce nom ; pour cette raison, une autocritique est possible.
Quant aux résultats positifs, ils sont sans rapport avec la position maximaliste que nous avions adoptée et qui souvent s’est retournée contre nous ; mais enfin ils existent. Ces années ont été l’occasion de solder définitivement l’héritage de deux décennies de paralysie et d’inertie du mouvement libertaire. Mais surtout, elles ont vu ressurgir des questions cruciales comme la révolution ou l’organisation, non pas en tant que dogmes idéologiques, mais comme des problèmes vivants, complexes, dynamiques. Ces résultats, modestes il est vrai, gardent une importance qualitative du point de vue des perspectives qu’ils ouvrent. Ils ont eu un coût tragique, payés par les camarades qui ont été et sont encore frappés par la répression.
Ces pages leur sont dédiées.
Signalons que ce texte ne prétend pas trancher, mais apporter au débat une contribution nourrie de ce que nous avons vu, vécu et pensé pendant toute cette période. Plutôt que de parler ex cathedra ou de fournir « notre opinion », il nous a paru prioritaire de reconstruire le mieux possible cette histoire, d’essayer d’élaborer une vision d’ensemble. Pour cela, on ne peut se contenter d’accumuler les dates ou de se remémorer les petites batailles : il faut séparer les faits importants de ceux qui le sont moins, et risquer des interprétations pour savoir pourquoi les choses se sont déroulées de telle manière et non de telle autre. Cette entreprise confère au texte un biais subjectif que nous revendiquons : pour qui veut une vision objective des choses, il y a le JT et les journaux.
Enfin, il était impossible de mener ce travail sans en tirer le moindre enseignement. Nous nous sommes donc risqués à quelques conclusions, même s’il est inévitable qu’elles suscitent des remises en question. C’est aussi bien comme ça.
Il était une fois…
Entre 1996 et 1997, l’ensemble des mouvements de jeunesse, des mouvements radicaux, anticapitalistes, etc., de la péninsule ibérique se trouvait au seuil d’une transformation en raison de conditions externes et de leur propre évolution durant dix ans. Cette transformation générale a pris la forme, dans le cas de l’anarchisme, d’une rupture violente. Dans cette première partie, nous traiterons de la manière dont s’est opérée cette rupture, qui a été double : avec l’anarchisme officiel et ses traditions d’une part, avec les tendances de plus en plus ouvertement conformistes des mouvements de jeunesse de l’autre. C’est sur le terrain de cette critique que se sont rencontrés des camarades aux positions différentes – autonomes, anarchistes ou marxistes « hétérodoxes » – qui ont mis de côté leurs héritages idéologiques respectifs pour élaborer en commun une pratique révolutionnaire effective. Les idées insurrectionnalistes ont été le dénominateur commun de cette époque d’étranges reconfigurations.
L’anarchisme officiel
Au début des années 1990, les conséquences de la restructuration capitaliste en Espagne étaient déjà visibles. Dans ce contexte, la sclérose de l’anarchisme officiel – le Mouvement Libertaire, qui s’était lui-même attribué les majuscules – n’en était que plus évidente. À la fin de la dictature, il y avait eu une tentative pour reformer la CNT historique, dans des conditions qui avaient rapidement conduit à la scission. Tout ceci est de l’histoire ancienne, et archiconnue, mais peut-être n’a-t-on pas assez remarqué que la polémique entre les deux factions (que l’on peut résumer grosso modo par l’alternative « pour ou contre la participation aux élections syndicales ») a paralysé pendant deux longues décennies le débat militant à l’intérieur de l’anarchisme. Absorbé par ce monologue intérieur, le parti du « non », qui a conservé le sigle historique CNT, a traversé la période de la restructuration du capitalisme espagnol dans un isolement et une marginalité grandissants. C’est à cette faction que nous nous référons quand nous parlons d’ « anarchisme officiel » ; en effet, l’autre faction (la CGT d’aujourd’hui) a volontairement écarté toute référence à l’anarchisme, et se contente d’une touche « libertaire », pourvu qu’elle ne nuise en rien à sa respectabilité.
Pendant les vingt années dont nous parlons, l’anarchisme officiel a été parfaitement incapable d’avancer un seul concept qui puisse rendre compte des changements historiques en cours, comme d’inventer quoi que ce soit, du point de vue organisationnel, pour faire face aux transformations sociales et économiques. Systématiquement sur la défensive, il s’est acharné à réaffirmer les « principes », à marteler l’idéologie et à défendre un passé idéalisé ainsi qu’un mode d’organisation tout aussi idéalisé, qui datait précisément de 1918. Avec ça, une bureaucratie étouffante, une avalanche de photocopies, de tampons, de comités, d’assemblées et de réunions plénières, pour une organisation minuscule qui comptait en 1996 à peine trois mille adhérents [2].
Au début et au milieu des années 1990, les diverses organisations de l’anarchisme officiel ont vu arriver de jeunes militants fascinés par son « glorieux » passé ; par sa réputation combative, qui tenait plus de l’image que de la réalité ; et par un discours qui était, sans exagérer, le plus extrémiste qu’il était donné d’entendre. La CNT n’a pas opposé le moindre obstacle à cet afflux de jeunes militants – rien d’étonnant vu son manque de militants et son obsession pour le nombre d’adhérents. La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias [3]] (FIJL) ne leur servait pas de première « école » ; dès leur entrée dans la FIJL, ils étaient souvent affiliés à la CNT où ils se voyaient relégués dans d’inutiles « groupes étudiants ».
Une fois au syndicat, ces jeunes ont pu constater d’eux-mêmes le gouffre entre la radicalité du discours et la pratique, inexistante ; entre l’ouvriérisme « années vingt » et le manque de présence dans les entreprises ; entre le nombre d’adhérents revendiqué et le réel… Bref, entre le passé « merveilleux » et la misère du présent. Il n’était pas rare qu’ils y rencontrent de surcroît le mépris et la condescendance de militants plus âgés et plus expérimentés.
Finalement, cette jeunesse militante a souvent servi de piétaille dans les batailles bureaucratiques de l’anarchisme officiel, sans se rendre bien compte des manipulations dont elle était l’objet. Personne n’a pris la peine de lui apprendre quoi que ce soit qui aille au-delà des rudiments de la doctrine. Et elle s’est laissée contaminer par les pires défauts de l’organisation, depuis le sectarisme le plus total jusqu’au bureaucratisme, en passant par la paresse intellectuelle. Mais elle avait aussi la volonté sincère de surmonter cette pénible situation, sans trop savoir comment. Les nombreuses personnes qui se sont engagées de fait dans cette voie devaient rencontrer — et ont rencontré — l’immobilisme de l’organisation, pour la simple raison qu’elles exprimaient un désir de changement, même si chacun entendait le changement à sa manière.
Au milieu des années 1990, la paralysie théorique et pratique de l’anarchisme officiel rendait l’ambiance plus que délétère, situation qui a suscité d’inévitables conflits internes. La CNT en a connu de nombreux, mais le plus retentissant reste celui de la « séparation » — pour ne pas dire l’expulsion hors de la fédération — , d’une partie importante, voire de la majeure partie de la section catalane. Comme dans la plupart des luttes internes à la Confédération, les véritables causes du conflit sont demeurées secrètes, car aucune des deux parties n’avait intérêt à les révéler. Personne n’a eu la moindre velléité d’avancer le début d’un motif idéologique, une raison pratique ou théorique, qui puisse expliquer une telle saignée dans l’organisation. Il s’est simplement agi d’un conflit entre cliques bureaucratiques, dans lequel s’est imposé celui qui a obtenu le soutien des réseaux bureaucratiques qui dirigeaient la CNT dans le reste du pays. Des luttes semblables avaient lieu dans tous les secteurs de la confédération. Quand les disputes se terminaient ici, elles recommençaient là, achevant ainsi de miner le moral de l’organisation et de ruiner son image.
Parmi ces conflits, il y en a un qui revêt un sens particulier pour l’histoire que nous voulons raconter. Il s’agit d’un conflit interne à la CNT de Madrid qui a eu lieu dans les années 1997 et 1998. À peine achevée une lutte interne qui s’est conclue par l’expulsion en bloc du syndicat des métiers, un autre conflit entre deux secteurs opposés a pris forme. Les termes de l’opposition constituaient un symptôme classique de la pathologie cénétiste : une aile « anarchiste » minoritaire, à la tête de laquelle se trouvait en l’occurrence le syndicat des métallurgistes, luttait contre une aile « syndicaliste » formée par le nouveau syndicat des métiers, représentant le transport et la construction. Les membres de la fédération locale des Jeunesses Libertaires — une des plus importantes et des plus actives de la FIJL — ont pris le parti du syndicat des métallurgistes. L’aile « syndicale » était irritée par la violence employée par ces jeunes dans leurs luttes antifascistes ou contre les entreprises d’intérim ; on ne leur pardonnait pas leur comportement particulièrement irresponsable lors de l’occupation du CES [4] par la CNT en décembre 1996.
Le conflit, larvé, éclate en 1997 au sein du comité national de la CNT, établi à Madrid depuis un an, où les deux secteurs bureaucratiques s’étaient répartis les postes. Pour une raison inconnue, les deux représentants des « métallos » sont expulsés du syndicat, et par conséquent du comité national. Une bonne partie de la section étudiante – dans laquelle militaient plusieurs membres de la FIJL – est elle aussi expulsée, accusée d’être un repaire de jeunes « violents » qui auraient fomenté des affrontements lors des manifestations étudiantes de l’époque. Des membres de l’organisation en question se rendent au local rue Tirso de Molina pour exprimer leurs démocratiques doléances aux caciques cénétistes, qui démocratiquement expulsent les jeunes rebelles qui troublent la paix des milieux gauchistes. On passe ainsi à une lutte déclarée au cours de laquelle la section majoritaire réussit à expulser la section « métallos » à travers une suite d’expulsions aux motifs aussi folkloriques que celui que nous venons de citer. Le conflit atteint son intensité maximale lorsque des membres de la FIJL, d’ores et déjà expulsés, font irruption dans une réunion du comité national de la rue Magdalena pour demander des explications à ceux qu’ils estiment responsables, à commencer par le secrétaire général de l’époque. Un échange de beignes de part et d’autres s’ensuit, que le comité national et la fédération locale de Madrid présentent au reste de la CNT comme un « assaut » en règle, obtenant le soutien de presque toutes les fédérations régionales, restées muettes face à la série d’expulsions madrilènes, qu’elles considèrent comme une question interne à la fédération de la capitale.
Jusqu’ici, la situation a suivi une méthode bien rodée de résolution des conflits, que la CNT utilise depuis 1977 : manœuvres bureaucratiques [5] , expulsions dans la plus pure tradition stalinienne, et l’inévitable dose de beignes, expression de la rage des vaincus ou argument final des vainqueurs. Cependant, le comité national décide alors de donner un tour de vis supplémentaire et de chasser les Jeunesses Libertaires de l’ensemble de l’organisation. Le comité national se pose en victime en mettant en avant l’« assaut » qu’il dit avoir subi, et se lance dans une chasse aux sorcières au cours de laquelle la FIJL sert de bouc émissaire aux tensions internes à la CNT. Le comité national du syndicat décide unilatéralement de rompre toute relation avec la FIJL, décision qui selon les règles ne peut être prise que par l’organisation réunie en congrès. Cette rupture n’est pas seulement symbolique, car elle permet de présenter la FIJL comme une « avant-garde externe » qui prétend diriger le syndicat. Par conséquent, ses militants vont être harcelés dans presque toutes les localités où la FIJL compte des groupes organisés. Ses archives sont forcées5 à Bilbao et Grenade, et de la documentation interne dérobée. En un peu moins d’un an, on réussit à virer du syndicat la totalité des militants de la FIJL, par expulsion directe, harcèlement ou dégoût pur et simple. Ainsi, on a conjuré le spectre d’une radicalisation de la CNT ; mais il va reprendre corps immédiatement, comme nous allons le voir, dans cette minorité de militants qui a soutenu les prisonniers suite au braquage de Cordoue.
Quant à la FIJL, elle va continuer à être diabolisée dans les récits de l’anarchisme officiel, et suivre son propre chemin. Jusqu’alors, la fédération de jeunesse avait été une sorte de manifestation extrême du sectarisme propre à l’anarchisme officiel. Son existence reposait sur la croyance erronée qu’une action plus « radicale » était possible sans modifier les principes de la CNT. En tant qu’adhérents au syndicat, les militants de la FIJL se montraient d’ailleurs d’un dogmatisme féroce à l’heure de défendre l’orthodoxie cénétiste ; c’est pourquoi ils ont été si facilement manipulables par l’aile « puriste » du syndicat. Leur sacrifice, mené à bien par ceux qui voulaient un syndicat plus poli et « civilisé », a totalement désorienté la FIJL, qui va marcher dans le vide pour ensuite s’agripper à l’insurrectionnalisme comme à une bouée de sauvetage. Mais, dans le sillage des membres de la FIJL, bien d’autres jeunes cénétistes sont partis, dégoûtés d’une lutte — souvent longue de plusieurs années — contre une bureaucratie inamovible.
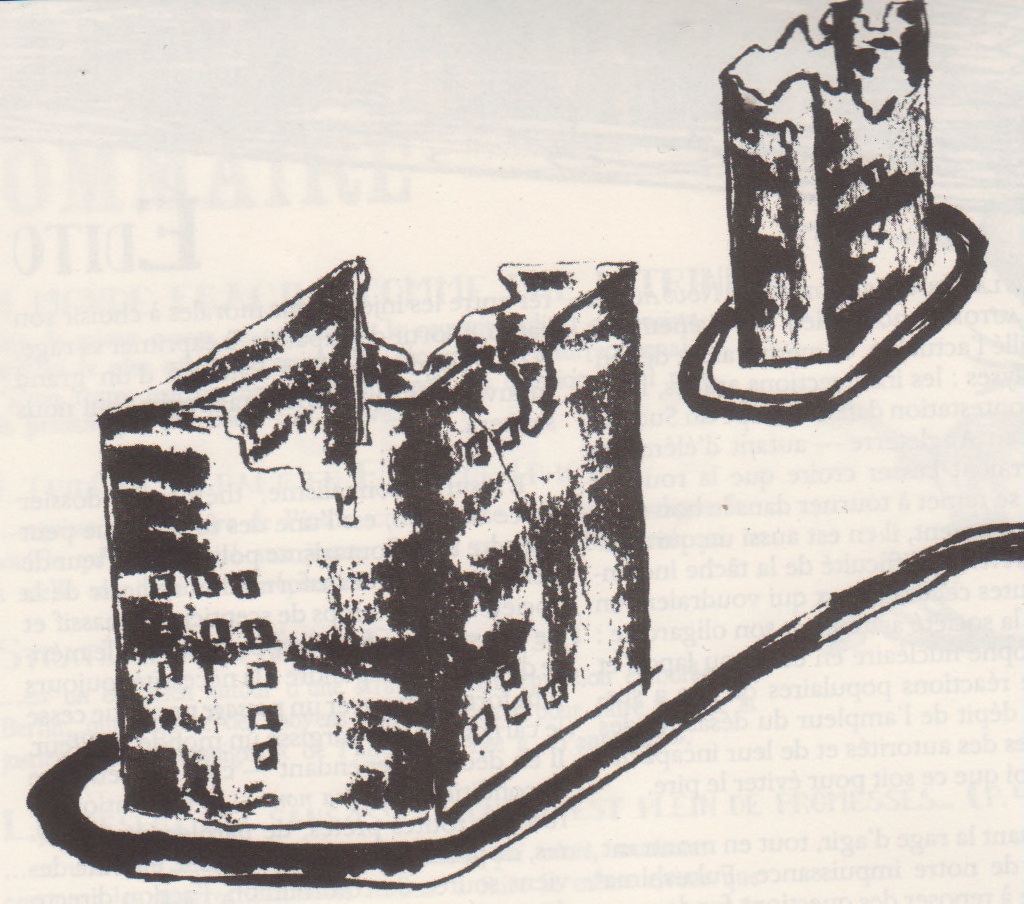
Les mouvements de jeunesse
L’anarchisme officiel postulait lors de ses congrès, maniant une subtile dialectique inclus/exclus, que le « Mouvement Libertaire » était composé de la CNT, de la FAI, de la FIJL et de Mujeres Libres (Femmes Libres). En fait, la réalité était plus complexe et changeante que ces schémas simplistes, bureaucratiques et sectaires. Au-delà des frontières parfaitement tracées par les organisations anarchistes instituées s’était développé, un peu dans toutes les directions, un mouvement diffus et hétérogène dont les origines remontaient au milieu des années 1980. Il se manifestait à travers des squats, des fanzines, des infokiosques, des groupes de musique, des collectifs et des groupes affinitaires… et à travers des mouvements plus larges comme l’antimilitarisme, qui s’est développé à la même époque avec le mouvement des insoumis.
Cette nébuleuse, qu’elle se revendique anarchiste ou autonome, était née en marge du vieil ouvriérisme de l’anarchisme officiel, et se regroupait dans de multiples coordinations, souvent dénommées « anti » — antisexiste, anti-répression, antimilitariste, antifasciste, anti-corrida, etc. — qui avaient comme point commun d’être des lieux de sociabilité pour la jeunesse. Des publications emblématiques comme Sabotage, Resiste, El Acratador, La Lletra A ou Ekintza Zuzena [6], s’appuyaient sur ces réseaux. Comme ce mouvement de la jeunesse était incapable de mettre en place des instances de coordination et d’établir des lignes d’action communes, une partie continuait de considérer la CNT comme une référence, dont la stabilité et l’aura mythique conféraient, pour le moins, le respect.
Cependant, dans divers endroits, les mouvements de jeunesse ont eu un poids spécifique et sont allés au-delà de l’anarchisme officiel. C’est une banalité de souligner le caractère exceptionnel du Pays basque, car il a constitué une exception dans tous les domaines. Il est bien connu que la guerre sociale s’y est déroulée d’une manière bien particulière ; les thèmes que l’épidémie de rage a remis au goût du jour après des décennies d’oubli, comme la violence ou la prison, n’ont jamais cessé d’y être une préoccupation quotidienne pour des milliers de personnes, dépassant largement les petits cercles d’activistes. Ce contexte est trop particulier pour ne pas le laisser à l’écart de cette histoire, bien qu’à partir du milieu des années 1980, un puissant mouvement de jeunesse y ait émergé, et qu’il ait influencé de nombreuses manières les autres mouvements du pays, pour lesquels il a constitué une référence importante.
Faute de temps et d’espace, nous ne pouvons aborder tous les sujets que nous souhaiterions. Valencia a été, par exemple, un foyer important de squats, en plus d’être le lieu de publication début 1997 du mythique Todo lo que pensaste sobre la okupación y nunca te atreviste a cuestionar [7]], premier texte espagnol présentant les idées que l’épidémie de rage a développé par la suite, et qui se situait à des années-lumière aussi bien de la liturgie de l’anarchisme officiel que de l’insipide spectacle du mouvement squat. D’autres lieux mériteraient d’être mentionnés, mais étant données les limites de ce texte, nous nous concentrerons sur les deux points de cristallisation maximale des mouvements de jeunesse, qui influeront fortement sur les événements ultérieurs dans le reste du pays : Madrid et Barcelone.
Madrid constitue un cas particulier. Les mouvements de jeunesse y ont très tôt réussi à se doter d’instances de coordination, qui ont fonctionné pendant presque dix ans. La coordination de collectifs Lucha Autónoma (LA, Lutte Autonome) a été fondée en 1990, regroupant d’un côté les premières fournées de squatteurs madrilènes, de l’autre des groupes de jeunes qui avaient quitté les organisations d’extrême-gauche comme le MC et la LCR (Mouvement Communiste et Ligue Communiste Révolutionnaire), dégoûtés par leur autoritarisme. Ainsi est née une organisation singulière qui, bien que limitée au milieu madrilène, a entraîné de véritables dynamiques de lutte et d’« auto-organisation », pour employer le langage de l’époque. LA n’était pas exempte d’une esthétisation très forte, c’est l’un de ses éléments caractéristiques. C’est une organisation au caractère activiste très marqué qui a servi de fourre-tout idéologique, ce qui lui a permis de grandir dans un premier temps, mais ensuite s’est retourné contre elle.
Autour de 1997, son propre développement ainsi que le manque de perspective a entraîné une divergence de position en son sein. Ceci a provoqué une crise qui s’est conclue par une autodissolution en 1998. Peu après, on a tenté de refonder, en suivant les préceptes du post-opéraïsme italien, une LA « émancipée » de ses composantes anarchistes et autonomes « traditionnelles », mais ce pas vers l’inconnu s’est soldé par un bel et rapide échec. D’ailleurs, le panorama des mouvements de jeunesse madrilène de cette époque ne se limite pas à LA. Il fallait compter avec toute une constellation de groupes, squats, collectifs, infokiosques, etc. Il faut cependant reconnaître que LA a été une référence incontournable à Madrid durant toute la décennie : sa fin en queue de poisson a laissé des séquelles encore visibles, dix ans après, à travers les fractures internes aux mouvements madrilènes.
Quant à Barcelone, nous pensons que l’apparition d’un vigoureux mouvement de jeunesse ne peut être dissociée de la tradition de révolte de cette même ville et de sa banlieue, dont les luttes ouvrières et de quartier des années 1970 sont la dernière manifestation en date. Au contraire de Madrid, le mouvement s’est organisé autour de réseaux informels fondés sur le tissu social de voisinage, les rencontres dans les squats ou les affinités personnelles entre camarades. Ce milieu politique s’est développé de manière totalement indépendante de la CNT catalane, trop occupée dès le début des années 90 à s’autodétruire, offrant le spectacle de règlements de comptes mafieux auxquels les sommités cénétistes nous ont habitués.
Le premier fait d’armes remarquable du mouvement barcelonais est la campagne menée contre les cérémonies de 19926. À partir de cette date, le squat est de plus en plus été utilisé comme forme de rassemblement et de lutte. Le nombre d’immeubles « libérés » atteint un seuil critique sans pareil dans le reste du pays. Cette effervescence facilite un saut qualitatif en 1996 : l’occupation et l’expulsion du cinéma Princesa, situé en plein centre de Barcelone. Après avoir déployé pendant sept mois une activité frénétique, les squatteurs sont expulsés au cours d’un véritable siège médiéval, au cours duquel la police reçoit tous les projectiles possibles et imaginables. La manifestation qui suit réunit des milliers de personnes et se termine par une des émeutes les plus grandioses dont les camarades de Barcelone puissent se souvenir. L’agitation de Barcelone est transmise en direct dans tout le pays, et se prolonge en mars 1997 par une autre expulsion à forte résonance médiatique, celle de La Guindalera à Madrid, durant laquelle plus de cent personnes sont arrêtées.
Après Le Princesa et La Guindalera, le pays tout entier est en proie à une frénésie d’occupations, la plupart du temps éphémères, la police ayant sans doute reçu l’instruction d’agir vite pour éviter une propagation du phénomène. L’État s’en inquiète, comme le montre le code pénal voté en 1996, qui établit des peines particulièrement élevées pour le délit de « violation de domicile ». La frange libertaire des mouvements de jeunesse a pour la première fois un modèle dans lequel elle peut se reconnaître, et ce n’est pas la CNT, qui la considère toujours comme sa petite sœur. Elle a atteint la majorité et ce petit monde a fait son entrée au journal télévisé. À partir de là, elle peut regarder la CNT avec un certain détachement. à ce moment-là, il n’est pas question d’une quelconque rupture, mais une critique larvée commence à s’exprimer ; on commence aussi à écouter d’une oreille plus attentive les critiques des camarades qui avaient auparavant attaqué le mythe du cénétisme, et parfois on finit par les croire.
D’autre part, ce qui est plus important, la conscience diffuse d’avoir franchi une étape ouvrait les mouvements de jeunesse à de nouvelles idées et théories. Cette ouverture a été à l’origine d’une opposition entre, d’une part, ceux qui cherchaient à approfondir et à radicaliser l’affrontement contre l’État et le capitalisme, et d’autre part, ceux qui tendaient à sublimer ce conflit dans une mise en scène « sympathique » et inoffensive, censée permettre de « toucher les gens ». On a souvent — et de manière simplificatrice — qualifié ces positions de « révolutionnaire » et « réformiste ». Mais la position révolutionnaire ne pouvait l’être, malgré toute sa bonne volonté, parce qu’elle manquait d’un projet révolutionnaire qui aille au-delà des aspects purement destructeurs (qui sans cesse primaient), et parce que la marée contre-révolutionnaire, caractéristique de l’après 1968, était toujours haute.
Quant à la seconde, elle n’aspirait pas à réformer quoi que ce soit, mais à préserver des îlots d’« État-providence » et à obtenir la gestion para-étatique de l’assistance dans certains secteurs d’exclusion sociale, produits de la restructuration du capitalisme (précarité, immigration…). Cette opposition était alors présente dans tout le mouvement, mais c’est autour de la dissolution de Lucha Autónoma et dans les polémiques madrilènes touchant la légalisation des centres sociaux occupés qu’elle a été le mieux visible. Un peu plus tard, les grands rendez-vous antimondialistes mettront en scène cette rupture de manière spectaculaire : entre « black block » et « tute bianche ».

Un jour comme les autres à Cordoue
Notre récit aurait pu commencer ici, mais pour donner tout leur sens aux événements, nous avons jugé utile d’exposer des faits précurseurs, dans le but de décrire le contexte dans lequel est née l’épidémie de rage. Toute histoire a un début, ou au moins son élément déclencheur, et en ce qui nous concerne l’étincelle de notre histoire a mis le feu aux poudres à Cordoue le 18 décembre 1996, quand trois camarades italiens et un argentin, alors inconnus du mouvement, tentent de braquer une banque. L’histoire est parfaitement connue et il ne sert à rien de s’y attarder [8]. Deux membres de la police municipale trouvent la mort ce jour-là, et les quatre assaillants sont faits prisonniers. Leurs noms : Giovanni Barcia, Michele Pontolillo, Giorgio Rodríguez et Claudio Lavazza.
Dans un premier temps, cela n’a été qu’une nouvelle parmi d’autres à la une des journaux. La filiation anarchiste des braqueurs n’a été connue que plus tard, tout comme le fait qu’ils revendiquaient la dimension politique de leur acte. Et s’ils étaient inconnus en Espagne, ils étaient représentatifs des embardées du mouvement révolutionnaire italien des vingt années précédentes.
L’engagement de Lavazza avait commencé dès son jeune âge, au cœur des luttes ouvrières des années soixante-dix. Comme tant d’autres militants italiens, il avait choisi de prendre les armes, intégrant les Prolétaires Armés pour le Communisme, organisation d’inspiration léniniste centrée sur la lutte contre le système carcéral. Il avait ensuite évolué vers des positions anarchistes, tout en restant dans la clandestinité. Pontolillo et Barcia étaient très actifs au sein de la frange insurrectionnaliste de l’anarchisme italien, qui a émergé au cours des années quatre-vingt. Le premier avait été condamné en Italie pour insoumission au service militaire, et le second était inculpé dans le « montage Marini » dont nous parlerons plus bas. Leur engagement anarchiste n’était donc pas nouveau, et encore moins (ce que certains ont mesquinement prétendu) une manœuvre opportuniste, visant à obtenir des soutiens une fois arrêtés.
Comme ils n’entretenaient aucun contact avec l’anarchisme espagnol, leurs voix mettent du temps à franchir les murs de la prison. Elles y réussissent néanmoins au moyen de Llar, bulletin édité dans les Asturies qui se distingue par son absence totale de dogmatisme. Llar propose une mise en page surprenante ainsi qu’une facture bien plus soignée que les fanzines photocopiés de l’époque. En plus d’être gratuit et de maintenir rigoureusement un rythme régulier de publication, il bénéficie d’une excellente distribution, non seulement en Asturies, mais dans toute l’Espagne. Il est ainsi disponible dans tous les syndicats de la CNT et dans la quasi-totalité de la nébuleuse alternative : collectifs, infokiosques, squats, etc.
Pour cette raison, Llar a été le média par excellence d’une polémique qui ne pouvait pas plus mal s’engager pour la CNT. Dès que le bulletin des Asturies rend publiques les positions anarchistes des braqueurs de Cordoue, des voix s’élèvent, à l’intérieur et à l’extérieur de la CNT, pour demander l’appui du syndicat. Par respect pour la vérité, il faut admettre qu’une minorité, petite mais significative, de militants du syndicat était favorable à ce que la CNT soutienne les expropriateurs — comme elle l’avait fait auparavant avec le prisonnier libertaire Pablo Serrano — , et de fait des syndicats comme celui d’Avilés adoptent alors cette position. Ces cénétistes, tout en restant dans le syndicat, rejoignent des camarades issus des mouvements de jeunesse, et forment ainsi les premiers groupes de la Croix Noire Anarchiste (CNA) à Grenade, Villaverde et ailleurs. Leur objectif, mis à part un mot d’ordre global de « lutte contre les prisons », est de soutenir les prisonniers anarchistes. Ces groupes sont un drôle de phénomène de « transition » : en effet, ils ne procèdent pas au départ d’une rupture avec la CNT, et se réunissent dans ses locaux. Cependant la méfiance, voire l’hostilité ouverte, que leur témoigne l’organisation les amène bien vite à se détacher du cénétisme et à suivre d’autres chemins.
Ces exceptions mises à part, la majeure partie de l’organisation est plus que réticente, et même ouvertement opposée, à l’idée d’accorder la moindre protection aux détenus de Cordoue. Cette attitude, dictée par la crainte de se voir criminalisée, est enrobée d’argumentations idéologiques et d’une condamnation implicite des auteurs du braquage. La polémique se déroule principalement dans les pages de Llar, avec quelques épisodes dans le périodique cnt, et se maintient « à l’intérieur de certaines limites » en 1997. Mais deux événements, dans la première moitié de l’année 1998, provoquent une césure irréversible. Premier événement : l’ouverture du procès pour le braquage de Cordoue, qui est l’occasion d’un rassemblement de soutien aux camarades italiens. Des jeunes venus d’ailleurs, qui ne représentent aucun syndicat, se présentent avec un drapeau de la CNT. Les médias insistent là-dessus. La CNT se désolidarise totalement, ce qui lui vaut de virulentes critiques de la part du récent réseau de soutien aux expropriateurs prisonniers.
Le deuxième événement d’importance est l’expulsion du Centre Social Autogéré (CSA) de Gijón (siège de Llar et d’autres collectifs) par la CNT — qui possédait ce local en usufruit au titre du Patrimoine Syndical Accumulé1 — expulsion de force et sans préavis. Rien dans les misérables motifs avancés par la CNT ne justifiait un tel acte, qui ressemble à s’y méprendre aux expulsions de squats et provoque chez beaucoup de gens une profonde indignation. Le motif profond et dissimulé, ce sont les critiques formulées contre la CNT par les lecteurs du Llar, critiques que ce journal publiait scrupuleusement. La forme que prend l’expulsion est, de plus, significative du paternalisme et du mépris de la CNT envers l’« autre » mouvement libertaire, et pas seulement à Gijón. Pour cette raison, énormément de gens s’identifient immédiatement au CSA et se sentent solidaires.
À partir de cette date, la polémique monte très vite d’un ton. Le tirage du Llar, en soi élevé pour un journal alternatif, ne cesse alors d’augmenter, tout comme le nombre de ses soutiens. Le dernier numéro (septembre 1999) est tiré à 7000 exemplaires. Au même moment, le périodique cnt était tiré à 3000 exemplaires, dont le tiers du stock prenait la poussière dans les locaux des syndicats, qui le diffusaient à peine. S’opérant par capilarité, « informelle », la diffusion du Llar est alors bien plus large et efficace que la presse du syndicat, ankylosée.
L’importance de cette polémique, d’un niveau très bas d’un côté comme de l’autre, appelle quelques remarques. La CNT aurait pu se défendre avec un argument très simple et difficilement contestable : elle aurait pu dire qu’elle n’était nullement obligée d’assumer des prisonniers qui appartenaient à un autre courant, de surcroît inconnu en Espagne, et qui avaient agi de manière unilatérale et étrangère au répertoire cénétiste. Ces évidences n’ont quasiment traversé aucun esprit. L’erreur des cénétistes qui prennent la parole alors est de prétendre prouver, sans qu’on le leur demande, que les prisonniers de Cordoue ne peuvent être anarchistes, car ni leurs méthodes ni leur point de vue ne coïncident avec ceux de la sacro-sainte Organisation.
Habitués pendant de longues années à distribuer des certificats de pureté anarchiste, ils ne doutent pas un seul instant que ce cas-ci soit une occasion de plus pour le faire. Ils ne réalisent pas — leur petites têtes en sont bien incapables — que l’excommunication doctrinaire de l’anarchisme officiel peut très bien marcher contre une quelconque entité située « à leur droite », mais que la position des Italiens est bien plus radicale que la leur, car ils prônent l’assaut révolutionnaire immédiat et en plus le mettent en pratique. Par conséquent, les misérables inquisiteurs se retrouvent devant une rébellion ouverte d’une foule de gens qui ont patiemment supporté leurs âneries pendant des années. Perturbés par cet imprévu, auquel leur programme n’offre pas de réponse rapide, ils perdent les pédales et ne trouvent rien de mieux à faire que des condamnations morales.
Le problème de fond est qu’on exige de la CNT, dans un milieu où elle est un point de référence, qu’elle soit à la hauteur de son extrémisme verbal.
Pour la première fois depuis des années, il est question non de théorie, mais de faits réels et très graves, qui peuvent souiller son image médiatique ; la CNT est alors prise de panique, et l’on voit que son radicalisme n’est que pure logorrhée, que son auto-marginalisation est une forme d’intégration au système qu’elle prétend combattre. Les pages de Llar racontent mois après mois (il faut souligner qu’internet n’existait pas encore) l’histoire de l’enfant qui, innocemment, déclare que le roi est nu, alors que personne ne peut plus faire semblant d’y croire. Mais dans ce cas l’enfant est Michele Pontolillo, et son « innocence » vient du fait que, s’étant formé ailleurs, il est immunisé contre les intoxications et les conventions propres à l’anarchisme ibérique.
À partir de l’expulsion du CSA de Gijón, la rupture est irréversible. Le Mouvement Libertaire avec un grand M a perdu en quelques mois le monopole de l’anarchisme, qu’il avait jalousement défendu pendant deux décennies. Fin 1998, il y a deux camps parfaitement délimités. Le premier, celui de l’anarchisme officiel, armé de son inertie doctrinaire, adopte une posture défensive ; le second, un anarchisme bien plus radical, se cristallise d’un coup à gauche de la CNT, autour du rejet viscéral de cette dernière et du soutien aux prisonniers de Cordoue.
Les crises dans l’organisation sont typiques des périodes de tournant historique. L’anarchisme espagnol, qui s’est distingué de bien des manières mais jamais dans la théorie, a toujours cherché à les résoudre par une fuite en avant dans l’activisme. Ces antécédents expliquent naturellement le succès foudroyant de ce qui se présente alors comme « insurrectionalisme ». Ce nouveau courant anarchiste, sa critique de la bureaucratisation, de l’immobilisme et du dogmatisme de l’anarchisme officiel, vont avoir un très fort pouvoir de séduction sur les militants les plus jeunes de la CNT, qui vont la quitter les uns après les autres, au cours d’un véritable exode générationnel qui va toucher tous les syndicats. Les positions insurrectionalistes auront le même succès auprès des autres franges des mouvements de jeunesse. Le poids de ces différentes origines se retrouvera plus tard dans la constitution d’ailes « informelles » qui marcheront côte à côte, mais séparément.
Le rôle de l’insurrectionnalisme : l’irruption
Dans leurs lettres à Llar, les camarades faits prisonniers suite au braquage de Cordoue confrontent leurs positions à celles des cénétistes qui écrivent dans la même revue. C’est ainsi que l’anarchisme insurrectionnaliste [9] trouve un premier écho en Espagne. Par ailleurs, un éditeur barcelonais vient de publier début 1997 une traduction en castillan de la brochure d’Alfredo Bonanno intitulée La tensione anarchica (Littéralement La tension anarchiste). C’est à peu près tout ce que les défenseurs et les détracteurs de l’insurrectionnalisme peuvent connaître sur ce thème à cette date en Espagne. Associé à l’exemple pratique des prisonniers de Cordoue, cela provoque d’entrée un malentendu : beaucoup de gens croient alors que la problématique de l’insurrectionnalisme se limite à l’expropriation, ou encore que le braquage est le mode d’action insurrectionnaliste par excellence.
Ce n’est cependant pas la toute première fois qu’il est question d’insurrectionnalisme en Espagne. Chose curieuse, le périodique cnt lui-même avait publié, à l’occasion, des articles de Bonanno qui avaient provoqué la perplexité, et même scandalisé de nombreux lecteurs. Le groupe « Revuelta » (Révolte) de Cornellá (ville de la banlieue de Barcelone), désormais disparu, diffusait depuis des années des informations sur l’anarchisme révolutionnaire en Italie. Son bulletin avait relayé les informations sur le montage Marini [10], les écosabotages et les luttes anti-développementalistes centrées sur le TAV (le TGV) et les centrales nucléaires, ainsi que des communiqués de camarades emprisonnés comme Marco Camenisch. Mais la priorité était donnée à des informations éparses au détriment des textes théoriques ; le fond de la question était donc en grande partie éludé.
C’est aussi le groupe « Revuelta » qui a relayé en Espagne l’invitation pour le rassemblement fondateur de l’Internationale Antiautoritaire Insurrectionnaliste (IAI) en 1996, auquel ont assisté des camarades provenant de diverses régions espagnoles. Cette invitation était parvenue entre autres à la FIJL, à une époque où elle gravitait encore autour de la CNT. À ce moment-là — avant les faits de Cordoue — la fédération de jeunesse avait accueilli la proposition avec une certaine méfiance, due principalement au manque d’information. Bien que l’invitation soit « arrivée » au milieu d’un débat sur l’opportunité de créer un mouvement de jeunesse anarchiste international (qui est resté lettre morte), la « peur de l’inconnu » a pris le dessus. C’est regrettable, car cette prise de contact avec l’expérience italienne aurait favorisé en Espagne une meilleure compréhension — en bien ou en mal — du discours insurrectionnaliste, et aurait fait que sa diffusion ne soit pas biaisée par les événements de Cordoue.
Aucune de ces tentatives n’a abouti parce que les conditions en Espagne n’étaient pas les bonnes. Les mouvements de jeunesse n’avaient pas atteint un niveau suffisant de maturité, et l’anarchisme officiel de putréfaction, pour que se produise d’un côté comme de l’autre la rupture de toute une frange de la jeunesse libertaire. Le moment venu, le discours insurrectionnaliste a eu une influence réelle, conditionnée en grande partie par le contexte spécifiquement espagnol, ce qui a donné lieu à d’énormes malentendus sur lesquels nous reviendrons plus bas.
Quelques précisions s’imposent. Ce que nous avons baptisé « l’épidémie de rage » a été une tentative collective, sans unité ni coordination, de vaincre l’impuissance et la sclérose des milieux politiques qui, en Espagne, se prétendaient « anticapitalistes » et « révolutionnaires ». Si nous lui avons donné ce nom lyrique, c’est pour ne pas confondre le tout avec la partie — certes importante — correspondant à « l’insurrectionnalisme ». Cette variante de l’anarchisme, créée et mise au point en Italie et en Grèce, a eu une influence de premier ordre dans le contexte de l’épidémie de rage, et a déterminé en grande partie son évolution. Mais l’épidémie de rage a aussi été le fruit des dynamiques ibériques décrites dans la première partie de ce texte. L’adaptation irréfléchie de l’insurrectionnalisme en a été le produit, non la cause.
L’insurrectionnalisme n’a pas été la seule nouveauté théorique [11] à faire irruption dans le champ libertaire à l’occasion du conflit ouvert autour des faits de Cordoue. Une fois rompu le monopole idéologique de l’anarchisme officiel, diverses idées et diverses positions se sont engouffrées dans la brèche ouverte. Certaines, comme le primitivisme, se sont révélées n’être que des modes idéologiques. D’autres, comme la critique anti-industrielle, ont montré une plus grande solidité théorique. On a exhumé de vieux courants marxistes comme le conseillisme, et avec toute la bonne volonté du monde, on a essayé de se convaincre qu’ils étaient d’une actualité brûlante. Même si ce n’était pas le cas, leur diffusion a du moins sapé l’anticommunisme ancestral de l’anarchisme espagnol : nous avons découvert un Marx beaucoup plus proche de nous, qui n’était plus le théologien du catéchisme léniniste, ni la caricature satanique que nous en avait fait l’anarchisme. Dans le même sens, la théorie situationniste, accessible pour la première fois dans sa quasi-intégralité en espagnol grâce au travail de la maison d’édition Literatura Gris, a eu un impact considérable parmi nous.
Bref, à partir de 1998, et pendant cinq ans au moins, on a brassé beaucoup d’idées, à un rythme vertigineux. Tous les mouvements situés à gauche de la gauche institutionnelle ont connu une transformation, et pas seulement l’anarchisme. Cette mutation globale a ouvert des espaces de débat qui n’existaient pas auparavant, suscitant une remise à jour complète. Pour cette raison, on a assisté à une effervescence éditoriale « alternative » sans précédent depuis les années soixante-dix. L’objet caractéristique de cette époque — juste avant l’irruption d’internet — était la brochure photocopiée, support de textes plus longs et approfondis que ceux qui circulaient à travers les fanzines et revues habituels. Libérée de l’obligation de servir de « porte-parole » à tel ou tel groupe ou collectif, la brochure a été un excellent moyen de communication qui, grâce à son faible coût et sa facilité de reproduction, a accéléré considérablement la circulation d’idées.
Ainsi a été sauvée la mémoire, théorique et pratique, de tant de luttes et d’événements historiques qui avaient été sciemment occultés, déformés ou exorcisés dans les traditions de l’extrême gauche espagnole. Des leçons d’histoire d’une importance capitale, grâce auxquelles nous nous sommes rendu compte que nous ne venions pas de nulle part. D’autre part, la réactivation de la mémoire des expériences armées antiautoritaires — MIL [12], Comandos Autónomos, Rote Zora7, parmi tant d’autres — a levé le tabou de la violence au sein du mouvement libertaire. En résumé, on est passé brusquement d’un manque total de textes et d’informations à une surabondance qui a provoqué plus d’une indigestion. L’épidémie de rage s’est également nourrie de ces thèmes, de ces lectures et de ces idées qui l’ont plus ou moins fortement marquée.
Soyons clair : le sujet de cet article n’est pas l’insurrectionnalisme en soi, mais le bilan critique d’une expérience collective longue d’une décennie, à laquelle ont participé des personnes qui ne se considéraient pas insurrectionnalistes ni même, pour beaucoup, anarchistes. Si nous devions préciser la relation entre cette expérience — qu’il serait abusif de qualifier de « mouvement » — et l’insurrectionnalisme, nous dirions que toutes ses composantes ont fini par se retrouver autour des problèmes soulevés par ce dernier. L’insurrectionnalisme n’a pas imposé de réponse à tout comme l’aurait fait n’importe quel dogme, mais il a posé les questions auxquelles chacun de nous tentait de répondre pendant ces années. C’est dans ce sens que nous avons écrit, dans la première partie de cet article, que les idées insurrectionnalistes étaient à la fois « point de rencontre et dénominateur commun ».
Le récit que nous nous sommes proposé de faire gagnera en clarté si nous abordons quelques aspects significatifs de l’insurrectionnalisme. Mais il faut préciser qu’il est loin d’être une doctrine structurée, aucune instance centralisée ne veillant sur sa « pureté ». Cela rend difficile l’analyse critique que nous allons malgré tout tenter sur la base de textes qui nous paraissent représentatifs, sans par ailleurs épuiser le sujet.

Un individualisme avant-gardiste ?
L’insurrectionnalisme estime que l’assaut révolutionnaire contre l’État et le capital est possible ici et maintenant, indépendamment de la conjoncture historique, qu’elle soit favorable ou non à une transformation radicale de la société. Selon Bonanno, le système a atteint un niveau de complexité tel qu’il empêche toute prévision stratégique [13] ; il ne reste donc qu’à le soumettre au harcèlement continu. Aux révolutionnaires de déterminer les points les plus vulnérables, ou ceux qui offrent les meilleures possibilités d’extension de la lutte.
Si l’on fait abstraction des conditions historiques et sociales — comme le font plus ou moins explicitement tous les théoriciens insurrectionnalistes — , le sujet révolutionnaire ne peut être que l’anarchiste lui-même, c’est-à-dire l’individu en lutte contre le système qui l’opprime. Ce « rebelle » est désigné par des noms différents dans la littérature insurrectionnelle, mais il n’en constitue pas moins un de ses référents théoriques centraux.
L’insurrectionnalisme comporte donc une forte composante individualiste. Inversement, il se refuse à déterminer clairement un sujet collectif susceptible de mener à bien l’attaque contre le système, à part de vagues allusions aux « opprimés », aux « exploités » ou aux « exclus ». Les théories insurrectionnalistes, peu structurées, vagues, laissent assez largement ouverte la question de savoir quelle catégorie sociale assumerait le rôle d’en finir avec le joug capitaliste ou, pour le moins, de mener à bien une lutte sans pitié. Ainsi, dans le cas de l’Espagne, certains ont cru que ce rôle incombait aux prisonniers, d’autres ont voulu faire un retour aux sources en invoquant le prolétariat révolutionnaire. Des réflexions plus récentes ont vu un sujet de rechange chez les exclus des banlieues, surtout après les émeutes de 2005 [14] en France. Rien qui ne compense cependant le fondement individualiste de cette idéologie — pleinement assumé par ailleurs — ni ne puisse servir de base à une lutte collective, même s’il y a eu de nombreuses tentatives dans ce sens.
Du point de vue insurrectionnaliste, le renoncement à toute projection stratégique et la conception de la guerre sociale comme un règlement de comptes donnent à l’action une valeur en soi. Notez qu’il y a deux modes d’action insurrectionnaliste que les écrivains du milieu distinguent nettement l’un de l’autre, même s’ils leur donnent des noms variables.
Nous les nommerons « attaque diffuse » et « radicalisation des luttes ». Ils ont tous deux servi de succédanés à la perspective stratégique que l’insurrectionnalisme avait volontairement abandonnée. L’ « attaque diffuse » est en fait une pratique de sabotage détachée de tout conflit concret, de toute revendication. Comme la domination touche désormais tous les aspects de la vie, elle offre de nombreux points d’attaque.
La « radicalisation des luttes » charrie d’autres connotations. Dans ce cas, l’insurrectionnalisme révèle un fond que nous pouvons qualifier d’avant-gardiste. Pour notre démonstration, nous allons citer quelques textes, à notre avis représentatifs de la pensée insurrectionnaliste :
Tout objectif de lutte spécifique contient en soi, prête à exploser, la violence de tous les rapports sociaux. La banalité de leur cause immédiate, on le sait, est la carte de visite des révoltes au cours de l’histoire. (…) Que pourrait faire un groupe de camarades résolus dans de telles situations ?(…) Il est assez clair que l’interruption de l’activité sociale reste un point décisif. C’est vers cette paralysie de la normalité que doit tendre l’action subversive, quelle que soit la raison d’un affrontement insurrectionnel. (…) La pratique révolutionnaire restera toujours au-dessus des gens. (…) Ce sont les libertaires qui peuvent pousser à travers leurs méthodes (l’autonomie individuelle, l’action directe, la conflictualité permanente) à dépasser le cadre de la revendication, à nier toutes les identités sociales. (…) Pour le moment, on ne peut pas dire que la capacité des subversifs à lancer des luttes sociales soit remarquable (…). Demeure l’autre hypothèse (…), celle d’une intervention autonome dans les luttes — ou dans les révoltes plus ou moins étendues — qui naissent spontanément. (…) Si l’on pense que lorsque les chômeurs parlent de droit au travail on doit en faire autant (…), alors le seul lieu de l’action devient la place remplie de manifestants.
[15]
Ouvrir un éventail de possibilités concrètes pour détruire le pouvoir implique de relier la tension de l’insurrection individuelle à tous ces moments qui dans le social lui-même, au-delà de l’action anarchiste, portent en eux l’expression de l’autodétermination ou d’une rupture avec l’ordre établi. Un tel lien exclut toute instrumentalisation, tout avant-gardisme. Les anarchistes n’ont rien à nous apprendre en ce qui concerne la révolte contre l’ordre établi. Le lien qui existe entre la tension anarchiste et les forces sociales en révolte prend donc effet en stimulant la radicalité de la lutte et de la rébellion, en accentuant certains éléments de l’auto-détermination et en en prospectant d’autres. [16]
(…) Il faudra construire des groupes affinitaires qui regroupent un petit nombre de camarades (…). Les groupes affinitaires peuvent à leur tour servir à la constitution de “cercles de base”. L’intérêt de cette structure est de se substituer, dans le cadre de luttes intermédiaires, aux vieilles organisations syndicales de la résistance (…). Chaque cercle de base se constitue presque toujours autour de l’impulsion donnée par des anarchistes insurrectionnalistes, mais il ne regroupe pas seulement des anarchistes. Par l’organisation en assemblée, les anarchistes doivent développer le plus possible leur fonction d’impulsion contre les objectifs des ennemis de la classe. (…) Le champ d’action des groupes affinitaires et des cercles de base est celui des luttes de masse. Ces luttes sont presque toutes des luttes intermédiaires, elle n’ont pas pour but direct et immédiat la destruction de l’ordre en vigueur. Elles avancent bien souvent de simples revendications, avec l’objectif de gagner des forces pour faire avancer une lutte ayant une autre visée.
[17]
Tous les textes cités — il y en a bien d’autres — ont un trait en commun : le mépris absolu envers l’autonomie des luttes sociales et les intérêts ou les besoins des gens qui y participent, ainsi que l’intention d’utiliser ces luttes en parasite, comme plateforme pour faire avancer sa propre idéologie. Avec un beau cynisme, À couteaux tirés affirme que « la capacité des subversifs à lancer des luttes sociales » n’est pas précisément remarquable. Il faut donc se jeter sur celles qui peuvent surgir « spontanément » en-dehors du petit cercle des milieux subversifs. Nous ne nous étendrons pas sur ce point et laissons au lecteur le soin de tirer les conséquences de cette position.
Coincé entre « l’attaque diffuse » et la « radicalisation des luttes », l’insurrectionnalisme n’a pas envisagé une voie qui aurait été d’un bien plus grand intérêt : une pratique du sabotage guidée par des considérations stratégiques, elles-mêmes liées à des intérêts collectifs, une pratique qui n’aurait pas forcément besoin qu’existe a priori des mouvements sociaux, mais qui serait en tous cas attentive à leur apparition et respectueuse de leur déroulement.
Après avoir examiné brièvement (et sans prétendre conclure sur ce point) les réponses apportées par l’insurrectionnalisme à la question de la pratique et du sujet révolutionnaires, il nous faut parler d’un autre problème central : l’organisation. En effet, ce sont les idées les plus intéressantes et originales du courant insurrectionnaliste. De plus, dans le cas espagnol, la critique insurrectionnaliste des formes d’organisation traditionnelles et ses propositions concrètes pour les transformer ont eu un fort impact sur notre génération de militants. Ce sont elles qui, de fait, ont le plus favorisé la diffusion de ce discours.
L’insurrectionnalisme est basé sur le concept d’« organisation informelle ». Si l’on suit ses prémisses théoriques, l’organisation informelle n’est pas destinée à durer ni à conquérir le pouvoir, quel qu’il soit. Par conséquent, elle peut se passer de tout l’attirail prosélyte habituel. L’organisation informelle est — pour employer un terme aujourd’hui à la mode — « en construction permanente ». Elle naît des affinités, de la confiance et de la connaissance mutuelle entre camarades. Elle prend forme autour de tâches et de projets ponctuels, d’accords momentanés ou de situations concrètes de conflit. Dans l’organisation informelle, la communication et les décisions communes doivent se faire de manière fluide et non à travers des congrès, des délégations, des réunions périodiques, etc. L’idée phare est de préserver intégralement l’autonomie de chaque groupe et individu, qu’il ne faut pas unifier et ainsi sacrifier sur l’autel de ce que Bonanno appelle « les organisations synthétiques ».
Aussi discutable que tout cela puisse paraître, nous aimerions souligner une série d’implications positives de ce positionnement. Premièrement, il a désacralisé d’un seul coup les formes d’organisation. Pas seulement les formes d’organisation concrètes de l’anarchisme espagnol, mais les formes d’organisation en général, abstraitement. Cela nous a permis d’envisager de nouveau l’organisation comme un moyen et non plus comme une fin en soi. Et donc comme quelque chose qui pouvait et devait évoluer — voire, le cas échéant, disparaître — , suivant les transformations historiques et les conditions de lutte. Les aspects qualitatifs ont repris le dessus, reléguant les questions quantitatives au second plan.
Le problème de l’organisation, qui avait totalement disparu de l’anarchisme espagnol, a ainsi été redécouvert. Des perspectives se sont ouvertes pour expérimenter et créer de nouvelles formes d’organisation.
Deuxièmement, l’organisation informelle exclue tout type de militantisme. Autrement dit : un rapport aliéné au militantisme est exclu. L’organisation informelle ne soumet pas le militant à des rythmes décidés dans des instances de coordination supérieures ; il ne se sent pas en son sein comme un « microbe » devant se montrer digne de la « grandeur » de l’organisation et de son mythe ; elle peut être remise en question à n’importe quel moment. Bref, l’organisation informelle empêche l’apparition d’un fétichisme de l’organisation.
Enfin, l’idée d’organisation informelle soulève une question qui avait été totalement évacuée dans nos milieux, celle de la qualité des relations humaines à l’intérieur de l’organisation. Ce n’est plus grâce à une carte ou à l’adoption de « principes, de tactiques et d’objectifs » que des inconnus deviennent des « camarades ». Pour l’organisation informelle, la solidarité et la camaraderie s’enracinent dans la connaissance mutuelle, directe, à travers la discussion et la collaboration pratique. C’est donc une relation concrète, et non une relation abstraite comme c’est souvent le cas au sein des organisations.
Comme nous l’avons dit, il s’agit ici des effets bénéfiques potentiels de l’idée d’organisation informelle. En règle générale, ils n’ont pas été développés par les textes insurrectionnalistes eux-mêmes, et ont plutôt pris forme dans les expériences de ceux qui ont tenté de mettre en pratique la formule — souvent bien vague — de l’organisation informelle.
La dérive espagnole des idées insurrectionnalistes
Au moment de son arrivée en Espagne, l’insurrectionnalisme était un ensemble d’opinions, élaborées collectivement en Italie et en Grèce, autour desquelles il y avait un certain consensus parmi les camarades gravitant autour. En Italie, ce discours s’était développé par étapes depuis les années soixante-dix, au sein d’un courant de l’anarchisme italien dépositaire de l’expérience de plusieurs générations de camarades. Sans être le nec plus ultra de la pensée révolutionnaire, l’insurrectionnalisme possédait une variété de tons que d’ici nous étions loin de pouvoir apprécier. Autrement dit, il était l’expression théorique d’une expérience vécue dont nous ne maîtrisions pas toutes les références ni les sous-entendus. Pour les Italiens, il était clair que ces idées étaient partie prenante d’une élaboration politique ouverte, en cours, et qu’elles pouvaient donc être discutées et débattues. Mais en Espagne, dès le début, ces idées ont été acceptées en bloc, comme s’il s’agissait d’un corpus doctrinaire complet auquel il ne manquait plus que la mise en pratique : une idéologie de plus. Deux raisons expliquent ce mode de réception aux conséquences si néfastes.
La première est conjoncturelle : l’insurrectionnalisme n’a pas été assimilé graduellement, à travers des débats, mais « a fait irruption » au milieu de l’âpre polémique qui a suivi les faits de Cordoue, ce qui laissait peu de place aux positions nuancées ou intermédiaires. La deuxième est structurelle : c’est le dogmatisme inhérent au mouvement libertaire espagnol, aussi bien dans sa variante traditionaliste que juvénile. Toute nouvelle idée était considérée avec méfiance. On ignorait complètement la nécessité et la valeur de la théorie, ce qui n’est pas étonnant étant donné l’anti-intellectualisme de l’anarchisme espagnol. Dogmatisme et indigence théorique marchaient main dans la main, et elles ont été cause et conséquence de l’absence d’une tradition de débat critique, qui n’a pas rencontré d’espace pour s’épanouir. La première chose qu’apprenait le militant était que le « mouvement » ou « l’organisation » était inamovible, éternel, et sacré, y compris dans ses aspects secondaires. Cette rigidité de l’anarchisme ibérique, son incapacité à intégrer de nouveaux points de vue, a aussi déterminé en partie la violence de la rupture.
Comme nous étions tous plus ou moins marqués par cet anti-intellectualisme, il ne faut pas s’étonner que l’insurrectionnalisme ait immédiatement été réduit à une sorte de caricature de lui-même, utile pour construire en un claquement de doigts une identité collective, de plus en plus auto-référentielle. La manière avec laquelle nous l’avons assimilé révèle les défauts de l’anarchisme espagnol à cette époque — défauts que, logiquement, nous avons reproduits. Dans cette confusion, la mauvaise qualité des traductions des textes italiens (dont certains étaient confus à la base) n’a pas été d’une grande aide ; ils sont arrivés dans un désordre chronologique complet, ce qui a rendu encore plus difficile la compréhension des expériences de lutte dont ils étaient issus.
Pour aborder la critique de l’insurrectionnalisme espagnol, nous utiliserons une contribution locale. Il s’agit du texte 31 tesis insurreccionalistas. Cuestions de organisación (31 thèses insurrectionnalistes. Questions d’organisation), signé Collectivo Nada (Collectif Rien) et publié début 2001. Il fait partie des rares textes espagnols qui sortent du lot. A son échelle, il a contribué à la propagation de l’épidémie de rage parmi les militants désabusés de l’anarchisme officiel. Ce que nous souhaitons aborder ici, c’est moins ce qui y était écrit que ce qui y était éludé, c’est-à-dire la répression : la réponse logique et prévisible de l’État à la mise en pratique de tout ce que le texte soutenait en des termes abstraits. Ce qu’il fallait attendre de l’État une fois passés « l’assaut » et « l’affrontement permanent » était liquidé en un paragraphe de quatre lignes comme une formalité, à l’intérieur d’un texte de 18 pages :«
L’organisation informelle doit se doter des moyens matériels pour combattre la répression. La solidarité avec [les personnes touchées par la répression] doit être sans cesse une priorité, car c’est le seul moyen de défense du révolutionnaire. La solidarité avec les camarades touchés par la répression ne peut être une simple posture ou une activité de circonstance. » (thèse n° 20)
C’est tout. Cet oubli ou, mieux, cette naïveté inquiétante à un moment où de nombreux coups venaient d’être portés, n’était pas une erreur des seuls auteurs des 31 tesis. Elle était générale, et ce que nous lisons dans ce texte est parfaitement symptomatique du degré d’inconscience collective qui était le nôtre : on y est allé sans prévoir le moins du monde le niveau potentiel de la répression qui ferait suite à la mise en pratique de certaines idées. D’où d’innombrables imprudences, manquement aux règles de discrétion et de sécurité, actions bâclées et téméraires. Si les Italiens ont eu leur « montage Marini » qui a été une tentative pour leur régler leur compte d’un seul coup, ici nous avons reçu une série de coups de bâton que nous détaillerons plus bas. De fait, l’épidémie de rage peut être contée comme une énumération de camarades tombés, chacun jalonnant une étape. La répression, à peine prise en compte au départ, a fini par se convertir en acteur principal de l’histoire.
Les 31 tesis n’étaient rien d’autre qu’un plan sur la comète, car il mettait tous ses espoirs dans l’émergence d’hypothétiques « mouvement sociaux autonomes » ultra-radicaux qui ne sont apparus nulle part (sauf peut-être dans les prisons). Mais au moins, les 31 tesis exprimaient leurs aspirations en termes de lutte collective, une démarche de moins en moins courante avec le temps. Il est vrai qu’une fois l’enthousiasme initial passé, il est devenu évident que l’extension de la lutte ne se produirait pas aussi facilement que ce qu’on espérait. Une certaine frustration s’est manifestée quand, après un point culminant marqué par Gênes et l’exécution télévisée de Carlo Giuliani, le tourisme antimondialisation s’est essoufflé et que ses éléments les plus modérés ont réussi à circonscrire les black blocks. Le spectacle de la révolte avait trouvé ses limites. La fin de l’épisode des luttes carcérales de 1999-2002 a contribué lui aussi fortement à ce sentiment. C’est alors qu’on s’est emparé de « l’individu en lutte », du « rebelle social », figure rhétorique qui attendait son heure depuis le début, et qui désormais pointait le bout de son nez pour occuper un rôle de plus en plus important, au détriment des sujets collectifs.
Nous ne savons rien de l’Italie sur ce point, mais dans le cas espagnol, le « rebelle » de l’idéal insurrectionnaliste est un héros tragique. Son héroïsme réside dans un effort ininterrompu pour se libérer de toute adhésion au système. Sa tragédie dérive des conséquences pratiques et directes d’un tel engagement, et d’un rapport de force si inégal qu’il ne laisse aucun espoir. Le « système » est une ombre à frapper, le prétexte à l’aventure personnelle de l’individu en lutte. Ceci explique que tant de textes issus de ce courant soient encore aujourd’hui truffés d’incitations à l’action, à la rupture violente vis-à-vis de la routine quotidienne, à la « cohérence », au dépassement de soi pour s’extraire du troupeau, au courage, etc.
Cet « individu en lutte », dépourvu d’orientations stratégiques et de références collectives, est contraint de rechercher les motifs de sa révolte en son for intérieur. On a assisté à un net tournant subjectiviste dans la pensée anarchiste espagnole. Certains textes et pamphlets, en particulier en provenance des compagnons de route de la FIJL, en sont un bon exemple. La rhétorique hargneuse rituelle des textes et des communiqués a peu à peu adopté un lyrisme subjectiviste de la pire espèce. On citait volontiers, et presque toujours de seconde main, n’importe quel auteur un peu maudit. Mais surtout, on avait recours au pire de l’Internationale Situationniste, c’est-à-dire au mysticisme hédoniste de Vaneigem. Le livre Afilando nuestras vidas (Aiguisant nos vies), publié par la FIJL en 2003, reste un bon témoignage de cet état collectif de confusion mentale, somme de beaucoup de confusions individuelles. En toute logique, l’étape suivante était l’apologie du nihilisme, de l’irrationalité et même du suicide, comme l’ont fait des publications toujours plus illisibles et autoréférentielles.
D’autre part, bien que dans les textes les plus élaborés de l’insurrectionnalisme on ait bien fait attention à préciser qu’« action » ne signifiait pas nécessairement action violente ou illégale, le fait est que l’apologie de l’action en tant que telle a eu pour effet immédiat un fétichisme de la violence qui valorisait l’action illégale au détriment de toutes les autres. Ce fétichisme apparaît clairement dans les illustrations de divers bulletins, truffés de cocktails Molotov et d’armes à feu. Fétichisme d’autant plus navrant que le niveau de violence réellement exercée n’ [18]a jamais été à la hauteur des exhortations écrites à une violence terrible, cataclysmique, totale, qui aurait fait table rase et abattu tous les gouvernements.
Ainsi, quand on a commencé à pratiquer systématiquement « l’attaque diffuse », on croyait sincèrement que ces actions s’expliqueraient d’elles-mêmes et tendraient à s’étendre de plus en plus. La masse anonyme était censée être pleine de saboteurs potentiels qui en avaient assez de l’aliénation quotidienne, qui suivraient notre exemple et, de plus en plus, nous devanceraient. Rien de cela n’est arrivé, et l’attaque diffuse a progressivement dégénéré en une simple manifestation de rage, quand elle n’était pas vandalisme indifférencié, rite d’identification collectif ou, pire, simple passe-temps. Les destructions ont été, elles, considérables, comme en témoignent les nombreuses chroniques « actions » publiées dans divers bulletins, jusqu’au moment où quelqu’un s’est aperçu que la police aussi les lisait avec intérêt. Quant à la participation de militants fortement imprégnés d’idéologie insurrectionnaliste à des luttes sociales concrètes, elle devenait problématique et parfois même néfaste. Le mépris de ces militants envers toute forme de revendication partielle y a contribué, ainsi que l’avant-gardisme consubstantiel à l’idéologie insurrectionnaliste. Exception notable à cette règle, les luttes anti-carcérales qui ont commencé en 1999.
En raison de la très mauvaise adaptation espagnole du discours insurrectionnaliste, la notion « d’organisation informelle » a parfois été remplacée par celle « d’informalité organisatrice », par inversion significative du substantif et de l’adjectif. L’accent n’était plus mis sur l’organisation mais sur l’informel, avec les conséquences qu’il est facile d’imaginer. Il est devenu de plus en plus difficile de parler d’organisation. À notre avis, cela peut s’expliquer par l’expérience de nombreux militants qui, pendant des années, avaient entendu parler de la CNT non pas comme une organisation, mais comme L’Organisation. Les mots ont leur importance, et après la rupture, dans beaucoup de milieux, le dégoût envers les rites et les mythes de l’anarchisme officiel s’est étendu à la notion même d’organisation.
En lien avec elle d’autres notions ont été dévalorisées elles aussi : la diffusion des idées, l’abnégation, l’engagement, la responsabilité, l’effort et le travail en quête d’objectifs librement choisis. La dérive existentialiste déjà mentionnée a également joué un rôle, en particulier un discours autour du « plaisir » — dernière réchauffée de Vaneigem — selon lequel les choses se faisaient par goût ou ne se faisaient pas : voilà où en était arrivée la critique de l’aliénation militante. Finalement, les discours anti-organisation ont creusé des brèches dans un bâtiment déjà fissuré, accélérant l’atomisation et l’isolement.
De plus, « l’informel » s’est étendu à la vie quotidienne. En voulant échapper au travail et à l’exploitation, et plus généralement au « troupeau » pacifié par le système, on est tombé dans des formes de vie collective extrêmement frustes et précaires, dont on a fait conséquemment l’apologie. La critique de la précarité s’est ainsi transformé en un éloge de la vie précaire. Le tout souvent accompagné de l’attirail esthétique correspondant, grâce auquel « l’informel » a nettement pris la forme de cercles fermés de plus en plus étroits et isolés.
De manière générale, chaque énoncé de l’insurrectionnalisme a eu sa traduction grotesque sur le sol ibérique ; c’est du moins le sentiment collectif qui en est resté. Beaucoup de camarades nomment ce phénomène « l’informel mal compris ». Cette expression a eu un certain succès, mais on ne l’a pas examinée de près. Elle présuppose avant tout qu’il y aurait un « informel bien compris » quand bien même personne ne l’a précisément défini et encore moins mis en pratique collectivement, alors qu’on a disposé de nombreuses années pour le faire. C’est qu’il n’y a pas d’« informel » qui vaille, ni bien ni mal compris : ce terme a été mis en avant pour repousser celui « d’organisation ». D’autre part, si les choses ont été « mal comprises », cela signifierait donc que le problème viendrait de nous et de notre contexte, pas du discours insurrectionnaliste tel qu’il est arrivé en Espagne d’Italie, lequel resterait même aujourd’hui hors de soupçon. Nous pensons quant à nous que la plupart des obstacles résidaient en bonne partie dans la faiblesse de ce discours théorique, dans son incapacité à décrire la réalité que nous connaissons, dans sa racine individualiste, son avant-gardisme à peine dissimulé, son imprécision volontaire, son manque de logique et de rigueur. Que dans le contexte italien — par ailleurs tellement idéalisé — ces idées aient été plus fécondes, cela s’explique justement par ceci : le contexte. Un contexte plus riche, plus large, avec un lien entre les générations qui ici faisait défaut, avec une plus grande permanence des luttes, des expériences, etc. Ces idées ne valent pas tellement abstraitement, « à l’état pur », pourtant c’est précisément ainsi que nous les avons reçues : complètement séparées des expériences qui leur donnaient sens.
Cependant, il est pour nous impensable de tout enterrer sous une chape de négativité. On ne le répétera jamais assez : les idées insurrectionnalistes ont eu un rôle positif. Ceux qui les ont adoptés étaient dans le juste : ils ont rompu de nombreux liens qui les entravaient et ont donné une secousse électrique à l’anarchisme officiel, assoupi. L’erreur serait aujourd’hui de persister dans des positions qui ont été éprouvées dans la pratique et y ont trouvé leurs limites. Malgré tout, l’insurrectionnalisme a énoncé certaines vérités qui aujourd’hui sont des avancées irréversibles, insuffisantes en soi, mais nécessaires pour construire du nouveau. Parmi celles-ci, nous avons mentionné l’appréciation de l’organisation comme quelque chose de non-figé, et le refus de l’aliénation militante. Nous voudrions ajouter ici l’idée que dans les conditions actuelles, un combat anticapitaliste et révolutionnaire ne doit pas attendre les « masses », l’adhésion de larges secteurs de la population, ni leur confier toutes ses espérances.



