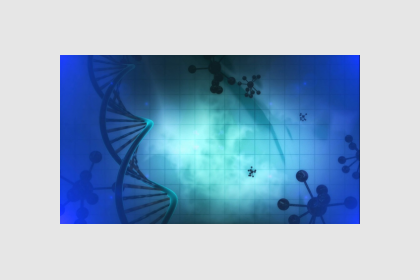Ce texte part d’un objectif : remettre la politique sur ses pieds, la ramener du ciel des idéalités au sol bien réel de la confrontation de classe, du rapport de force direct. Cet objectif constitue une condition nécessaire pour la renaissance d’une pensée stratégique qui ne se paye pas de mots, qui soit un facteur de puissance politique.
Or, de puissance politique, c’est ce dont nous ressentons le manque à chaque instant. Aucune des entreprises politiques dans lesquelles nous nous inscrivons ne semble chanqer quoique ce soit ni au rapport de force avec l’ennemi, ni à nos conditions d’existence. Ce texte se propose de fournir à notre désartoi actuel une généalogie, une histoire, et, dans l’étude de l’avènement de cette époque qui est la notre, il tente de dessiner une stratégie pour remettre la politique sur ses pieds, pour la rendre effectivement praticable et concrète.
COMMENT LA DÉMOCRATIE A TUÉ LA POLITIQUE
La démocratie comme théâtre
Qu’est-ce qu’une politique théâtralisée ? C’est une politique qui ne se propose d’agir que sur le plan médiatique, idéologique, culturel, en bref, c’est une politique symbolique. Elle se situe à un niveau étranger à nos propres conditions d’existence, saturée de tribunes, de clashs médiatiques, de campagnes électorales, de batailles d’opinion mais aussi de happenings symboliques, de manifestations aux airs de défilés, et même de casse contre les “symboles” du capitalisme. La politique s’est réduite à son expression médiatique, aboutissement ultime de toute agir politique.
Cette attitude-là peut être comprise comme une rationalité politique : Elle possède ses concepts stratégiques, son terrain d’affrontement, ses outils . En matière de terrain, nous l’avons dit, celle que nous étudions s’est choisie celui du symbolique. Elle ne mord pas sur les rapports sociaux mais se propose d’agir sur les consciences. Du terrain réel de la lutte de classes, on s’élève - un peu plus près du ciel ! - au terrain abstrait de la conscience, cet artéfact bien particulier de la civilisation bourgeoise, cellule de base de l’affrontement démocratique-électoral. Le nœud stratégique central qui accompagne cette rationalité politique, c’est la bataille culturelle ou bataille des consciences. Dans cette optique, il s’agit de trouver les arguments les plus percutants possibles pour remporter la bataille sur les idées du camp adverse, qui ne serait puissant que grâce à son omniprésence médiatique, se répercutant dans les esprits.
Mais par quel processus la lutte politique s’est-elle ainsi détachée de la vie ? C’est qu’à la faveur d’une longue séquence historique s’étalant sur plusieurs décennies, les partis et syndicats ouvriers, acteurs centraux de la lutte de classe et donc de l’histoire, se sont laissés désarmer. Par quel mécanisme ? En acceptant de réduire la lutte de classes à la question électorale, et de réduire les moyens d’actions possibles à ceux qui sont aménagés et garantis par l’État : en fait, les acteurs historiques ont accepté de donner à leur lutte un caractère strictement délimité par les bornes de la démocratie. Ce qui, positivement, signifie que c’est la démocratie qui fut l’agent historique majeur de la mort de la politique.
Dans ce cadre, l’État a cessé d’être conçu comme l’appareil de la bourgeoisie, et a commencé à être pensé comme un arbitre transpartisan des conflits politiques, permettant, de surplus, une résolution pacifique et réglée de ces conflits, à la faveur d’un processus rationalisé et apaisé. La démocratie, terrain d’affrontement aménagé par l’État, fut acceptée comme telle par les partis et syndicats de la classe ouvrière, qui ne furent pas en reste dans ces processus, en assimilant toute forme d’illégalisme à de l’anarchisme petit-bourgeois, de l’aventurisme, du sectarisme, etc etc.
Mais l’État, non content d’être devenu l’arbitre des conflits historiques, s’est également vu attribuer le privilège d’en être le point d’aboutissement. Toute politique est alors conçue comme devant nécessairement aboutir à un résultat concret, entendez : une victoire électorale ou une loi. Ainsi, tout objectif politique doit prendre une forme reconnue par l’État : une augmentation de budget, une loi pour mieux réglementer tel secteur d’activité, etc etc.
A cet égard, il nous faut dissiper un malentendu. Il ne suffit pas de dire, comme on peut l’entendre assez souvent à gauche, que le problème est qu’on ne fait de la politique que tous les 5 ans à l’occasion des scrutins présidentiels. Il est tout à fait possible d’être tributaire d’une vision démocratiste de la politique sans s’investir dans aucune élection. Certain.e.s s’épuisent en effet à militer, en dehors de toute considération électoraliste, dans des comités, des collectifs ou associations, strictement inoffensifs en ce qu’ils acceptent la démocratie comme l’appareil de gestion et d’expression de toute politique, et donc, corrélativement, l’État comme point d’aboutissement de toute politique. C’est ce nœud, entre état, appareil médiatique et système légal de médiation des conflits, qui constitue un appareil de capture et de neutralisation des subjectivités en lutte.
L’État comme “champ” et autres fadaises sociologiques
Cet état de fait trouve au sein de la gauche ses idéologues zélés, tous inspirés par leur saint patron, Pierre Bourdieu. On nous rebat les oreilles avec l’idée, répétée ad nauseam dans l’Université, que l’État n’a rien de monolithique, qu’il y a une main gauche et une main droite de l’État. Souvent, cette petite leçon de choses s’accompagne d’un petit sermon à l’égard des marxistes : en fait, l’État n’est pas du tout la caricature que Marx en a fait, sa théorie est bien trop simpliste, en vérité l’État serait un champ traversé par des idéologies contradictoires, etc etc, et on croit s’en tirer avec cette petite acrobatie. Oui, il y a bien un État de gauche et un État de droite, oui l’État est une chose complexe qui ne se réduit pas à son appareil de répression, et contient de très nombreuses ramifications et domaines d’intervention, tous structurés par des idéologies propres et parfois contradictoires entre elles. Et alors ?
Il ne suffit pas de prétexter de la complexité de l’État pour prouver que celui-ci est susceptible d’interventions démocratiques et décisives dans la lutte de classe. En effet, la croyance selon laquelle il serait possible de conquérir au sein de l’État des positions de classe constitue une fiction, qui consiste à idéaliser l’État, à le considérer comme un outil neutre en lui-même, simplement soumis dans sa forme et dans sa structure à l’influence de la démocratie. Ici, l’État est conçu comme dépendant largement de la délibération et du débat public, et donc susceptible de se rationaliser progressivement.
Or, l’État n’est pas éthéré, il n’existe pas au dessus des conditions économiques qui le permettent. Il est certes structuré par une rationalisation croissante, mais il dépend, dans sa structure, de la forme prise par le capitalisme à son époque, bien plus que de l’état actuel et contingent du débat public.
Ainsi, le capitalisme dans sa phase fordiste, d’après la seconde guerre mondiale, prenait la forme de grands pôles industriels, nécessitant l’existence d’une classe ouvrière nombreuse et concentrée, dans des usines comprenant parfois des dizaines de milliers d’ouvriers. A ce capitalisme correspondait un certain type d’État, planificateur, associant la classe ouvrière aux bénéfices tirés des progrès économiques de la période, intégrant les syndicats au processus de développement des forces productives, et ayant tout intérêt à fixer la force de travail au sein d’une même usine tout au long de leur carrière.
Au contraire, le capitalisme post-fordiste multiplie les instances de sous-traitance, flexibilise la force de travail, déconcentre la classe ouvrière et tend même à la dissoudre comme classe. L’État qui lui correspond, le nôtre, a pour tâche d’organiser cette mobilité. Il organise les conditions de cette phase du capitalisme : il promeut la formation continue, facilite les licenciements, maintient la force de travail au chômage dans les circuits de consommation (par les allocations)... Il diffère donc dans sa structure et dans ses objectifs de celui qui l’a précédé. Dans cet exemple, on le voit, l’histoire de l’évolution de l’État n’est pas celle d’un changement de paradigme droitier décidé à son sommet, mais elle dépend, autant qu’elle a pour tâche de l’organiser, d’un changement de phase du capitalisme, d’une réorientation stratégique, décidée à un niveau non-démocratique.
A cet égard, la victoire de la gauche en 1981 constitue un exemple paradigmatique de la manière dont la naïveté démocratiste des réformateurs de gauche s’est heurtée à la dureté de la machine d’État, qui a forcé ses maîtres d’alors (le gouvernement de gauche) à exercer une politique selon ses propres conditions, quitte à imposer au pays une crise économique et sociale d’une rare dureté.
Cette expérience aurait dû nous déniaiser sur la possibilité d’un quelconque changement par la voie démocratique. Mais ce n’est pas ce qui eut lieu, loin s’en faut ! Nos social-masochistes de gauche ont redoublé d’efforts pour imposer leur fable sur la main gauche de l’État et tout le tralala démocratique !
Alors, en matière de politique, on n’aura pas mieux que la lutte contre le néo-libéralisme, les apitoiements à n’en point finir sur le pseudo-désengagement de l’État (qui ne s’est pas du tout désengagé mais a simplement changé de forme), et autre niaiseries qui nous feraient rire si elles ne nous menaient pas droit dans le mur.
Contre la gauche, il faut affirmer le plus clairement le possible : aucune politique n’est possible si elle décide d’en passer par l’État, puisque la démocratie n’a aucune prise sur la forme et la structure de ce dernier.
Désarmer la politique
Non contents de se condamner à l’impuissance par leur collaboration avec l’État, les appareils de médiation démocratique (les partis et les syndicats) ont par suite reçu pour tâche de conjurer toute forme de politique qui n’emprunte pas les formes de la démocratie. Ainsi, toute révolte qui sort de ce cadre sera nécessairement étiquetée comme une forme de colère irrationnelle, a-politique. Et on enjoindra les révolté.e.s de se fournir un représentant, de s’assagir en reprenant les voies sacrées de la démocratie : ainsi les gilets jaunes étaient-ils sommés de se constituer en syndicat ou en parti, bref, à rentrer dans le rang. De fait, les instances démocratiques ont un rôle de cadrage de la parole et de l’action politique qui vise à neutraliser les formes non prévues d’émergence de nouveaux antagonismes.
On peut donc caractériser la démocratie comme un appareil de gouvernement, et plus précisément comme un outil d’intégration de la politique à l’État et aux formes politiques qu’il tolère voire encourage. Dans ce cadre, la politique s’inscrit dans un paradigme éducatif. Elle vise à former des individus à l’esprit critique, à leur donner une opinion informée. Les partis politiques doivent s’analyser comme des machines à produire des subjectivités d’un type très particulier : la subjectivité citoyenne. Ce nouveau type de sujet, nécessairement atomisé, se soumet volontiers au processus légal-démocratique, accepte l’État comme médiateur universel, et est doté d’une série d’opinions qui détermineront ses comportements électoraux. Bref, le citoyen accepte de se laisser déposséder de toute agentivité en dehors des cadres qui sont prévus à cet effet.
La démocratie constitue donc un outil, un rouage idéologique du capitalisme de première importance. Elle est ce qui a pour fonction de produire la fiction d’une séparation entre le citoyen et l’individu concret, et donc d’assurer que la politique se situe au niveau symbolique des valeurs et des concepts abstraits. Inversement, elle a pour tâche de conjurer toute politique conséquente, c’est-à-dire toute politique se donnant pour tâche de mordre directement sur les rapports sociaux, c’est-à-dire toute politique qui pratique un antagonisme concret.
Car on ne pratique pas la critique de ces appareils par pur plaisir théorique. Cette critique a une portée stratégique : elle laisse ouverte la pratique d’un nouvel antagonisme débarrassé de ses éléments idéologiques et symboliques.
POURQUOI LA DÉFINITION D’UN NOUVEL ANTAGONISME EST UNE TÂCHE DE PREMIÈRE IMPORTANCE
Mais définir une lutte conséquente n’a rien d’évident. Un certain sens commun militant voudrait que notre ennemi soit tout trouvé : c’est Macron, ceux pour qui il travaille, la “caste”, et puis aussi les flics qui ont pour fonction de le protéger, les “droitards”, les “fafs”... Bref, il ne manque pas d’ennemis à affronter, contre lesquels s’agiter. Tout serait, alors, question de bonne volonté.
Nous ne contestons pas que tous ceux que nous venons de citer soient bien des ennemis. Mais définir un antagonisme ne revient pas à simplement désigner un ennemi, mais à définir un rapport d’affrontement qui nous lie concrètement à cet ennemi. Aucune désignation de l’ennemi n’est neutre, mais oriente toujours une certaine manière de l’affronter.
Par exemple : si on définit notre ennemi comme les 500 familles, c’est à dire si on adopte une définition ultra restrictive de la bourgeoisie, on militera activement pour une meilleure redistribution des richesses, une taxation plus progressive, une indépendance du politique à l’égard des “puissances de l’argent”.. bref on n’ira pas très loin. Si on définit notre ennemi comme étant “la droite” ou “les libéraux”, alors cette définition orientera notre pratique politique vers une certaine conception de la bataille culturelle qui vise à supplanter l’hégémonie médiatique de la droite par une hégémonie médiatique de gauche. De ce fait, on se condamne alors à limiter notre affrontement à un niveau symbolique et médiatique. Mais alors comment se doter d’une définition adéquate de l’ennemi, étant entendu que celui-ci doit définir un antagonisme politique directement praticable ? Il ne s’agit pas de décréter a priori un ennemi à affronter, et donc un antagonisme. Cet antagonisme existe déjà, et il est déjà pratiqué par les fractions d’avant-garde de la lutte de classe. Quelles sont ces avant-gardes ? Les mouvements de révolte qui ont mené les luttes les plus dures, avec le plus haut degré d’organisation, et qui ont donc fait face à la répression la plus féroce.
En l’espèce, pour la période récente, on n’observe rien d’aussi conséquent que le mouvement des Gilets Jaunes et les émeutes pour Nahel, tous deux des mouvements correspondant à des fractions de classe aux situations matérielles les plus dures. Or, ces deux mouvements, bien qu’issus d’univers sociaux différents, ont tous les deux mis en priorité stratégique l’affrontement avec deux ennemis. Le premier d’entre eux est constitué de l’ensemble des appareils de médiation démocratique (les partis et les syndicats de tout bord), et le second, des appareils de répression (la police et la justice).
Il est incontestable que dans ces deux cas, l’exclusion des partis politiques censés les représenter fut une priorité. Elle constituait un appareil de capture des subjectivités en lutte, et était perçue par ces dernières comme des récupérateurs, venus produire une parole à leur propos qui leur était étrangère. A cet égard, les partis politiques et les syndicats constituaient un frein objectif à la constitution d’espaces d’organisation et d’élaboration collectifs. Ils furent donc systématiquement conjurés par ces sujets.
On pourrait dans ce cadre se demander pourquoi la France Insoumise, pourtant favorable à ces deux mouvements, en fut aussi exclue. Pour le cas des GJ en effet, elle leur a fourni un programme politique qui fut repris pour l’essentiel par ces derniers, et dans le cas des révoltes pour Nahel, ce fut le seul parti à refuser d’en condamner les actions. Pourquoi un tel rejet ? C’est que se jouait, dans les tentatives de la FI, une lutte de pouvoir quant à la possibilité pour ces mouvements de définir eux-mêmes leurs propres objectifs, leurs propres stratégies et pratiques de lutte. On ne peut ignorer le fait que ces fractions de classe ont mis en œuvre une politique active, explicite et consciente de distanciation à l’égard des appareils de médiation démocratique, tout comme on ne peut ignorer l’importance stratégique décisive qu’a constituée cette prise de distance.
Il faut également souligner à quel point la police a constitué pour ces mouvements un point de fixation central. Qu’elle soit perçue comme le rempart du pouvoir en place, ou comme un corps à attaquer en soi, il est clair qu’elle fut un formidable levier de radicalisation pratique, un moteur pour les antagonismes politiques qui s’y jouaient.
A cet égard, il faut dissiper le malentendu selon lequel l’affrontement avec la police aurait pour cause sa propre brutalité injustifiée. Dans cette vision des choses, les mouvements sociaux se présentent comme des victimes d’un ordre policier injuste face auquel ils ne font que se défendre. Cette rhétorique est à la fois fausse et stratégiquement inefficace. Aucun acteur politique n’est passif, et la violence politique est toujours le fruit d’une radicalité et d’une volonté politique qui rompent avec l’ordre des choses. Ainsi, la plupart du temps, la police est l’instrument qui empêche la réalisation d’objectifs fixés : tenir une ZAD, bloquer un rond point ou un axe de circulation, accéder à un lieu de pouvoir, etc, et c’est en ceci qu’elle est attaquée.
Dans chacun de ces cas, c’est en fait l’ordre légal-démocratique qui est visé, et la police qui ne fait que le défendre. Le choix de ne pas emprunter les voies de la démocratie parlementaire constitue un acte de rupture et d’affrontement avec la démocratie, qui, elle, mobilise ses forces de police pour faire rentrer la situation dans l’ordre (légal). Tous ces mouvements ont découvert cette vérité simple que toute politique conséquente impliquait une certaine forme de dédain à l’égard des formes sanctifiées de la démocratie, qui le lui rend bien.
Et c’est sur leur chemin qu’ils ont alors croisé la route des appareils répressifs de l’État, qui, en tentant d’empêcher ces mouvements de se développer, leur ont rendu un fier service. Elles ont eu pour effet, dans chaque situation qui le requiert, de déniaiser les éléments de démocratisme qui subsistaient au sein de ces mouvements. Ces derniers, qui a plus d’une reprise avaient initialement adopté une rhétorique citoyenniste, furent facilités dans leur travail de radicalisation par l’action énergique d’une police violente et obtuse, révélant la véritable nature du contrat démocratique qui les liait à l’État, le rapport de solidarité objective, entre démocratie libérale, ordre légal, et répression policière. Car cette dernière n’a rien de fasciste ou d’autoritaire, elle est strictement démocratique. La gauche ferait bien de comprendre cette vérité qui fut bien vite inculquée aux récalcitrant.e.s.
Est-ce pour autant qu’il faille reprendre à notre compte, de manière non-critique, les antagonismes spontanés des mouvements populaires ? N’a-t-on pas au contraire entendu dire que ces mouvements manquaient de conscience de classe ? Que “tout ce qui bouge n’est pas rouge”, et autres pontifications bien avisées ?
Il nous semble bien que oui. Ces mouvements, bien qu’ils n’apparaissent pas conscients à nos marxistes en chaire, ont permis ceci qu’aucun mouvement social de gauche n’avait réussi : ils ont cherché, chacun à leur manière, à se constituer en un sujet politique autonome et non démocratique. Il fallait pour cela poser un antagonisme le plus clair contre les deux appareils qui empêchaient le plus directement la constitution d’un tel sujet : les appareils démocratiques et les appareils répressifs. C’est à la faveur de cette lutte, et uniquement de cette lutte, que fut achevée cette tâche d’une importance prioritaire. Il fallait d’abord combattre ce qui empêchait à des subjectivités en lutte de se constituer en tant que classe, c’est-à-dire en tant que sujet politique qui porte un conflit de classe.
Il est certes beaucoup plus facile de proclamer qu’il eut fallu que ces mouvements s’attaquent prioritairement au capitalisme, tant qu’on ne s’attache pas à définir des manières concrètes de l’affronter, et qu’il sert de mot fourre-tout à celles et ceux qui l’emploient la plupart du temps comme un dogme. On a même vu des gens prétendre s’attaquer à la domination systémique, concept littéralement vide de sens, se distinguant par un niveau d’abstraction stratosphérique. En matière d’ennemis, les appareils répressifs et les appareils de médiation démocratique nous paraissent bien plus concrets et à même de définir une stratégie directement praticable pour la séquence qui est la nôtre.
LES NOUVELLES CONDITIONS DE LA LUTTE DE CLASSE
Evidemment, la constitution d’un sujet politique autonome ne constitue pas un but en soi, mais elle ouvre la voie à de nouvelles formes d’analyse des rapports de classe tels qu’ils se jouent dans l’espace et le temps dans lequel nous nous situons. Il ne s’agit donc pas d’attaquer “le capitalisme”, ce qui ne veut rien dire, mais de définir des formes d’antagonismes politiques possibles qui aient pour base des conflits de classe. Pour le dire autrement : le capitalisme n’est pas une sorte de substance transhistorique partout et toujours égale à elle-même. Il s’identifie avec les phases de son développement actuel, avec la forme historiquement déterminée qu’il adopte, forme elle-même déterminée par la lutte de classe. Et c’est cette forme actuelle qu’il s’agit d’attaquer.
Pour ce faire, il faut accepter de soumettre à examen les conditions de la lutte de classe, sans fétichisme. Disons-le d’un mot : nous doutons de la centralité tactique de la grève dans la lutte de classe en France au XXIe siècle. Cette dernière constitue à gauche un dogme intouchable dont les effets concrets sont souvent peu questionnés. La grève est devenue un outil de manifestation d’une colère politique, elle est décorrélée de tout antagonisme direct à part dans quelques secteurs clés de la logistique. Bref, on peut dire que la grève est devenue symbolique, qu’elle est devenue démocratique. Elle est un droit, quasiment intouchable, mais on peine à voir, dans la majorité des cas, son poids réel dans les rapports de force. Elle a très vite eu besoin d’être complétée par la manif interpro, sorte de défilé symbolique pour montrer sa force. Bref, en l’état, le couple grève-manif constitue un totem démocratiste qui laisse accroire l’idée que toute forme de confrontation n’est que symbolique. On pourra lui substituer une analyse concrète des conditions de l’époque, analyse que nous allons entreprendre de dessiner à grands traits.
En effet, depuis son âge d’or au milieu du siècle dernier, les conditions de la lutte de classe ont grandement évolué. Mais il ne suffit pas de dire que les choses ont évolué, comme si cela suffisait en soi à justifier une réorientation stratégique. Il nous faut analyser ce qui a changé dans la structure productive et nous contraint à une réorientation en réponse à cette dernière.
En la matière, ce qui a changé, c’est la disparition de la concentration ouvrière au sein d’unités productives massives. Les centres manufacturiers qui concentraient la production en un lieu, toutes ces usines grosses de dizaines de milliers d’ouvriers, fers de lance de la production capitaliste et de la combativité ouvrière ont disparu. Elles ont disparu, à la faveur d’une dissémination géographique de la production en unités productives de taille plus réduite, chacune d’entre elles interdépendantes les unes des autres dans un processus productif unique : c’est ce qu’on a appelé l’usine-diffuse, dont la caractéristique première est donc le recours massif à la sous-traitance, et la dislocation du processus productif.
Dans ce cadre, la grève est rendue plus difficile : il est de fait bien plus ardu de se coordonner avec les travailleur.ses des autres unités de production pour impulser une grève qui touche l’ensemble du processus productif. Alors, chaque grève prise isolément a peu de chances de peser, étant donné que l’unité productive dépend en fait elle-même de tout le reste de la chaîne productive, dont chaque maillon peut décider de changer de sous-traitant. Les dégâts que peuvent entraîner un arrêt de la production sont donc minimisés, ce qui entraîne nécessairement une baisse du nombre de grèves ainsi que de leur combativité.
Ce changement de paradigme est lui-même le fruit d’une réorientation stratégique. Il n’a rien de naturel ou de nécessaire, mais correspond à la nécessité, étant donnée l’intensité du conflit de classe dans les années 1960, de défaire les bastions ouvriers, devenus trop dangereux politiquement et trop coûteux économiquement. Mais cette réponse n’est pas elle-même sans faille, elle produit, de ce fait, de nouvelles conditions de la lutte de classe qu’il nous faut analyser. Quelles sont ces conditions ?
Nous l’avons dit, les conflits de classe se jouent moins à l’intérieur des unités productives, puisque le processus de production ne se réduit à aucune d’entre elles. Ce qui implique donc que ce dernier se spatialise, qu’il sort de l’usine pour s’emparer de l’ensemble du tissu urbain. La marchandise réalise sa valeur tout au long d’un cycle qui va de sa production immédiate, à sa circulation et enfin à sa distribution. Ainsi, la valeur de la marchandise dépend de ses conditions de distribution, qu’il faut assurer également, mais qui s’exposent de ce fait à une plus grande fragilité. La filière de la grande distribution illustre parfaitement cela. Elle a pour point de départ une foule de sous-traitants, qui vendent à des enseignes qui ont pour tâche de les distribuer, ponctionnant une marge au moment de cette distribution, en augmentant le prix de la marchandise. Mais cette augmentation du prix n’est pas le fruit d’une rapacité irrationnelle de tel ou tel capitaliste individuel. Elle est le signe du fait que la marchandise se réalise comme marchandise, c’est-à-dire acquiert sa valeur, aussi au moment de sa circulation et de sa distribution. Toutes les conditions de circulation et de distribution d’une marchandise sont des facteurs de sa propre valorisation. D’où le fait qu’une lutte de classe s’y joue, soit strictement individuelle (le vol), soit collective et spontanée (le pillage). A cela, on répond par des agents de sécurité privée pour le premier cas, et par les flics et le RAID pour le second.
Dans ce cadre, c’est la ville, définie comme complexe de circulation et de distribution, qui définit le lieu de valorisation et de réalisation de la marchandise. De ce fait, elle est l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics, qui ont de plus en plus à cœur de la sécuriser. Ce qu’on appelle couramment “l’hystérie sécuritaire” n’a donc pas grand chose à voir avec un phénomène de psychologie collective, elle n’est pas non plus le fruit d’un emballement médiatique. Elle est en vérité si peu médiatique qu’elle est définie dans des livres blancs et des rapports, seuls connus des initiés, puis livrés au ministère de l’Intérieur, qui décide d’une politique que la représentation nationale va s’empresser d’avaliser. Or l’État ne décide pas à lui seul, spontanément de se réformer. On trouve, à la base de cette dynamique sécuritaire, les associations de commerçants, pesant fortement sur les maires de France qui, constitués en groupe politique, pèsent eux-même sur les institutions répressives de l’État par le biais d’intermédiaires, mi-experts mi-hommes de réseaux qui constituent des personnages clés dans ce phénomène, et dont les recommendations ont valeur d’agenda politique de réforme.
Dans ce cadre, les individus sont peu à peu dépossédés de tout pouvoir sur leur environnement direct. La ville, toujours plus sécurisée et surveillée devient l’enjeu d’une lutte de classes toujours plus intense, où les conditions de circulation et de distribution de la marchandise font l’objet d’un soin croissant, et où les subjectivités qui l’habitent sont requises de se comporter uniquement en consommateur.ice.s. Les prolétaires sont ainsi invités à vendre leur force de travail pour reproduire les conditions de circulation et distribution, dans les boulots logistiques, de sécurité privée, de surveillance, d’entretien de la voirie, de vente, etc etc.
Mais alors, un nouvel antagonisme se dessine, celui des luttes de pouvoir sur l’espace, sur le contrôle des conditions de circulation et de distribution de la marchandise. D’où un poids croissant accordé aux actions de “blocage des flux”, comme on aime les appeler. Ce n’est pas un hasard si les Gilets Jaunes se sont prioritairement attaqués à des zones commerciales, des péages, des autoroutes.
Ce faisant, on s’attaque à deux choses distinctes : d’une part, on empêche les conditions de reproduction du cycle productif. Autrement dit, on bloque les axes de circulation qui sont nécessaires pour que l’économie fonctionne. C’est ce que tout le monde a bien compris. Mais d’autre part, on s’attaque aussi au processus de valorisation de la marchandise. En dégradant les conditions de circulation, on détruit les outils de de valorisation de la marchandise : la ville elle-même comme réseau sécurisé de circulation-distribution. On s’attaque du coup à ce qui constitue la marchandise comme marchandise.
Ainsi, le blocage ne se limite pas à son intérêt tactique de court terme, ou en tout cas ne devrait pas s’y limiter. Le “blocage des flux” ne doit pas se calculer simplement en termes de dégats à l’économie. Il doit toujours être l’affirmation d’un certain pouvoir, qui nourrit la formation de subjectivités politiques fortes, nourrit une logique sociale durable, antagonique à celle de l’ordre capitaliste contemporain. Tout blocage possède en lui-même l’affirmation d’une prise de pouvoir sur les conditions de circulation-distribution. Concrètement, la logique des ronds-points incarne parfaitement cela. Les ronds-points n’avaient pas qu’une signification tactique. Ils bloquaient un espace de circulation pour lui substituer un espace politique, destiné à durer dans le temps. Le rond point brisait la monotonie circulaire de la circulation et lui substituait une brèche, une autre temporalité politique qui rompait radicalement avec la temporalité cyclique de la marchandise.
D’une manière analogue, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes procéda selon une logique similaire de spatialisation des enjeux de classe. Il s’agissait à la fois de s’opposer à un projet d’aéroport, donc de s’opposer aux conditions de la circulation, et d’affirmer en lieu et place de ce dernier une logique sociale antagonique, pensée pour durer dans un affrontement direct. Toute ZAD, comme tout rond-point ou place occupée sont des espaces qui se nourrissent, qui tirent leur force de l’antagonisme avec les conditions de production et de reproduction de la marchandise. Il n’est donc pas étonnant que NDDL se soit effondrée à partir du moment où son objectif fut atteint, c’est à dire à partir du moment où aucun antagonisme concret n’était praticable, s’enfermant dans des considérations stériles sur la promotion de modes de vie alternatifs et “en dehors du système”, cherchant ainsi à reproduire leur forme politique comme une coquille vidée des raisons politiques de sa naissance.
Ainsi, un antagonisme se dessine, praticable pour nous dans l’époque dans laquelle nous vivons. Encore faut-il se donner les conditions pour réaliser concrètement des luttes avec ce degré d’ambition pratique. Ici, on parlera de ce que nous pouvons faire pour intervenir de façon décisive dans les luttes de classe. Quel est ce nous ? Depuis quelle position je parle ? Depuis le champ, large et déstructuré, de l’autonomie politique française. Il regroupe l’ensemble des personnes qui s’agitent politiquement dans des cadres non partisans ou syndicaux. Nous pensons que c’est de cette effervescence politique que peut naître la pratique conséquente et ambitieuse d’un affrontement à la hauteur des enjeux des temps actuels.
DU DEMOCRATISME A LA PENSEE STRATEGIQUE
Il s’agit donc de trouver une stratégie pour peser, pour infléchir le cours des choses, dans les mouvements sociaux et en dehors. Mais pour ce faire, il faut bien se résoudre à s’organiser sur une base non affinitaire, et combattre certaines habitudes bien enracinées au sein de nos propres forces, que nous qualifierons d’idéologie affinitaire. Cette posture présuppose qu’il suffit juste à chacun.e de se regrouper entre ami.e.s ou personnes de confiance pour agir dès maintenant. La plupart du temps, elle s’accompagne d’un mépris affiché pour la discussion, lui préférant un passage direct à l’action, considéré comme plus efficace.
Le raisonnement qui sous-tend cette attitude consiste en l’idée que, par la multiplication des petits groupes, des petites actions isolées, on se rapproche toujours un peu plus de la révolution. Cette logique strictement quantitative élude tout questionnement stratégique, au profit d’un activisme infatigable.
Mais ce dernier revient en vérité la plupart du temps à intervenir dans des luttes dont les modalités et les mots d’ordre ont déjà été définis à l’avance par d’autres, que ce soient les partis politiques et les syndicats, les Soulèvements de la Terre, ou les fameuses pages d’appel (CND, Lundi Matin,...). La plupart du temps, la “stratégie” des autonomes consiste à se pointer à ces appels accompagné.e de quelques personnes de confiance, s’habiller en noir, profiter des opportunités qui se présentent pour passer à l’action, et tenter d’échapper aux interventions motorisées de la police. Ainsi, le refus d’investir tout espace de composition signifie donc alternativement la soumission aux “léninistes” et autres “appelos” (pourtant décriés par les autonomes), et l’impuissance face aux forces de répression.
Corrélativement, les groupes autonomes, obsédés par “l’efficacité”, s’investissent la plupart du temps dans des luttes ultra-locales, de soutien à des personnes en situation de grande précarité, souvent surexposées à la violence d’État, mais menées par des associations spécialisées sur ces questions., Si ces luttes sont absolument indispensables en elles-mêmes, l’investissement des groupes autonomes qui décident d’y participer se résume la plupart du temps à une soumission complète, sans aucune forme de questionnement, aux mots d’ordre, modes d’action et agendas politiques des associations et collectifs humanitaires.
De ce fait, ils se soumettent donc à des luttes structurées par l’idéologie humanitaire, consistant à raisonner en termes de populations, à priver les personnes de toute forme d’agentivité en privilégiant une approche gestionnaire des problèmes politiques. Ainsi, ces modes d’action s’intègrent parfaitement au système de valeurs qui fait de la politique une simple activité de militance spécialisée. Enfin, les milieux autonomes sont structurés par des formes d’auto-représentation de soi à caractère performatif. Ainsi, être autonome constitue souvent une identité à performer, une opinion à exprimer, décorrélée de tout choix stratégique concret. On a vu naître des AG autonomes (pas toutes !) qui n’avaient pour autre but que d’exprimer à la face du monde le caractère autonome de leur espace. Ce type d’attitude, typiquement démocrate, consiste à définir comme prioritaires les questions d’opinions et d’identité politique, de valeurs, toute question pratique étant réglée d’avance. Généralement, dans de tels espaces, au terme de quelques heures d’enculage de mouche, on en appelle à la bonne volonté de chacun.e pour aller filer un coup de main sur telle ou telle lutte, de préférence sur un mode culpabilisant. Ce faisant, on élude les questions et les enjeux concrets et brûlants qui s’imposent à nous, et qui impliqueraient de franches confrontations stratégiques.
Cet état de fait, qui n’est le fruit d’aucun individu ou de groupe particulier, résulte au contraire d’une situation objective qui entrave grandement nos capacités d’action : la dissémination des groupes et la nécessité de faire face à la surveillance des forces de police entraîne une certaine forme de réticence à aborder les questions stratégiques concrètes de manière ouverte.
Or, de stratégie, c’est bien ce dont nous avons besoin pour intervenir efficacement. Il nous faut accepter de parler, dans des espaces larges et ouverts, de questions organisationnelles et stratégiques, de confronter des lignes et des hypothèses politiques dans le but d’atteindre l’objectif qu’on se sera fixé. Le langage stratégique est l’inverse du langage démocratique, il n’est pas un langage abstrait et performatif, mais concret.
Parler le langage de la stratégie, c’est structurer nos questionnements autour des enjeux concrets qui s’imposent à nous, c’est réfléchir collectivement aux fins à atteindre et aux moyens à mettre en place pour les atteindre. La langue stratégique n’est pas séparée/opposée aux conditions et aux enjeux de la lutte, mais elle les exprime directement. De ce fait, toute personne qui veut lutter autour d’un objectif défini trouve sa place dans cet espace, elle en parle directement la langue, puisqu’elle partage avec chaque participant.e la même envie de s’organiser.
Un tel langage, adossé à des pratiques d’organisation, est selon nous propice au retour de ce que nous appellerions la subjectivité partisane : une subjectivité qui décide de faire rupture avec les critères de respectabilité et d’expression réglée hérités du démocratisme, une subjectivité qui ne se bat pas pour l’intérêt général, pour sauver le pays, qui ne se borne pas à simplement exprimer une opinion passivement. En bref, une subjectivité qui n’est plus citoyenne.
La constitution d’un tel sujet collectif, qui fait rupture avec la démocratie, nous semble la première des priorités. Elle est la condition d’une autonomie politique de long terme, aussi bien que le moteur d’un antagonisme croissant avec les conditions de reproduction de l’ordre bourgeois. A chaque étape, et donc dès maintenant, il s’agit pour nous de reprendre en main nos conditions d’existence, de refuser la passivité politique consubstantielle à l’ordre démocrate qui nous domine. Seul le langage stratégique, par son caractère concret et direct, est à même d’accomplir cette tâche.
A l’horizon de cette tâche, c’est la distinction entre politique et production elle-même qui s’abolit, et donc la possibilité d’une pratique sociale révolutionnaire qui se dessine.
A L’HORIZON : L’INDISTINCTION ENTRE POLITIQUE ET PRODUCTION
En effet, la pratique d’un langage le plus concret possible rompt la distinction démocratique entre citoyen.ne et producteur.ice. L’ordre démocratique opère selon un schéma qui divise entre d’une part une sphère citoyenne, dans laquelle les individus agissent selon des valeurs, des opinions, des convictions, bref une sphère idéale comme lieu de la politique ; et d’autre part la sphère de la production, plus concrète, où l’on travaille. L’ordre productif a besoin des sujets-citoyens pour se maintenir. Ceux-ci lui assurent de leur totale passivité, de leur stricte incompétence à propos de toute question concrète, laissant à l’économie le soin de s’assurer de nos conditions d’existence, pendant que nous sommes occupé.e.s à traiter de questions abstraites.
De ce fait, c’est la domination technique du capitalisme sur nos corps qui perdure, puisque nous ne pouvons reproduire nos conditions d’existence que par l’intermédiaire des processus productifs constitués par l’ordre capitaliste, ce qui produit en nous une idée de sa toute puissance, de son indépassabilité, et donc renforce notre propre passivité politique.
Contre cette dynamique de dépossession croissante de nos corps et de notre puissance d’agir, il faut affirmer que la politique se mêle de ce qui ne la regarde pas, qu’elle aille voir dans les processus productifs, les procédés techniques, qu’elle doit y intervenir de manière décisive. Ce qui signifie également qu’il faut cesser de considérer tout système productif comme neutre en lui-même. la forme des processus productifs est déterminée par la lutte de classe, elle a des effets concrets sur nos corps, sur nos agentivités politiques, sur nos capacités de mobilisation, et c’est donc pour ça que l’on doit s’en mêler.
A cet égard, il convient de dissiper un malentendu qui voudrait que la révolution ne soit qu’un pur acte de destruction de l’ordre capitaliste, à opérer une fois pour toutes pour reconstruire sur ses ruines un monde nouveau. Contre cette vue de l’esprit, il faut au contraire affirmer qu’elle constitue le remplacement d’un principe social de production par un autre. Quel est celui qui domine ? C’est l’économie politique, ce sont les reconfigurations permanentes de l’ordre productif par les mouvements du capital, acteur principal de l’histoire s’il n’était contesté par une classe ouvrière porteuse d’un principe social antagonique. Quel est ce principe social antagonique ? Selon nous, c’est la dictature politique exercée sur la production, autrement dit, l’idée que toute question productive est soumise à libre délibération par celles et ceux qui décident collectivement de pourvoir à leurs conditions d’existence.
Celles et ceux qui voudraient que la révolution signifie la gestion automatisée de l’ensemble du processus productif pour maximiser notre bien-être ne sont que des économistes et des démocrates à courte-vue. La dictature de la politique sur la production constitue l’activité la plus exténuante qui soit, mais elle ne souffre d’aucune alternative possible en dehors de la dictature de l’économie politique.
A terme, la possibilité s’ouvre de se reconstruire collectivement comme sujet politique actif, capable d’agir directement et librement sur ses conditions d’existence. Un tel sujet rompt nécessairement avec l’atomisation et la passivité que l’ordre capitaliste nous inculque. Au sein de ce dernier, chacun.e est à sa place, isolé des autres, dominé par une rationalité productive qui le dépasse et à laquelle il ne peut qu’obéir pour gagner son pain quotidien. La politique doit permettre au contraire de se saisir collectivement dans ses conditions d’existence, de rompre la division des tâches en corps de métier séparées et spécialisés.
Il nous faut donc parler une nouvelle langue, ni celle de la démocratie et de ses idéalités, ni celle de la rationalité économique, une langue à construire dans des espaces de discussion, dans lesquels les questions de ligne ont toujours des conséquences concrètes, où plus personne n’a d’opinion, de conviction dans le ciel pur des idées mais des stratégies et des tactiques concrètes, rediscutables à tout moment. C’est cette langue qui constitue un préalable à la constitution et à la pratique d’une temporalité révolutionnaire.
EN GUISE DE CONCLUSION
A cet égard, il nous faut dissiper un dernier malentendu en guise de conclusion. Si nous refusons la démocratie, ce n’est pas à la suite d’un positionnement politique en lui-même, comme les milieux d’ultra gauche sont susceptibles d’en produire à foison. Nous ne sommes pas contre la démocratie en soi, car après tout un telle chose n’existe pas. Ce à quoi nous nous opposons, ce n’est pas à une certaine idée abstraite, mais à un appareil concret, que nous avons appelé l’appareil démocratique, et qui naît à une certaine époque pour des raisons très précise.
Quant à savoir si nous refusons toute démocratie, ce genre de question ne nous intéresse pas. La forme assembléiste suppose des modalités de prises de décision qui la rapprocheraient probablement de ce qu’on pourrait appeler une pratique démocratique, mais elle en refuse d’autres : le formalisme à outrance, la délégation pour tout et rien, l’idée qu’une AG soit représentative de quoique ce soit. Nous ne croyons pas à toutes ces fables. Pour nous, les espaces de composition sont de simples outils pour nous construire comme sujets politiques, ils ne survivent pas par leur forme mais par leur ambition, la qualité de leur discussion, la croyance dans les stratégies politiques qui s’y dessinent.
C’est à cette fin que ce texte paraît, pour être discuté et servir d’élément de positionnement pour qui décide de s’en saisir dans des espaces d’élaboration stratégique collective. Il en appelle d’autres, qui le contestent, le complètent, ou le combattent, peu importe, tant qu’ils servent eux aussi à nourrir le débat stratégique plus que nécessaire pour notre camp.