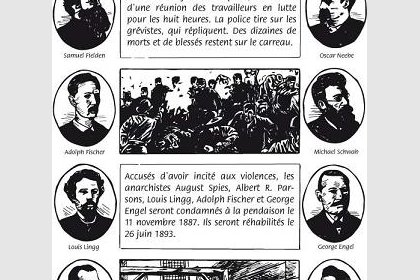Au travail !
À mesure que l’on s’enfonce dans la crise du Covid-19, il devient clair que l’effondrement à court terme de la production mondiale dépassera l’ensemble des récessions qu’ont connu les 150 dernières années – soit toute l’histoire du capitalisme. L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que la crise va détruire 195 millions d’emplois. Ainsi, après avoir longuement traité la pandémie sous l’angle épidémiologique et sanitaire, l’attention des médias se concentre désormais davantage sur la question de la relance de la machine économique. S’il nous faut encore faire le deuil de nos morts, le temps semble être venu de discuter des mesures nécessaires pour garantir la survie de l’économie qui, sous le capitalisme, est fondée sur la production et le travail. Depuis le Royaume-Uni où j’écris cet article, faire « retourner la Grande-Bretagne au travail » est le nouveau mantra du gouvernement, bien que le Premier ministre Boris Johnson lui-même soit encore en convalescence du virus. Cette question est au cœur des débats partout dans le monde depuis que la pandémie a mué d’une menace sanitaire en une menace économique. Pourtant, faire « retourner le monde au travail » tout en maintenant la distanciation sociale n’est pas chose aisée. Le capitalisme mondialisé est fondé sur l’interaction sociale permanente. À vrai dire, la mondialisation consiste précisément à supprimer toute distanciation sociale, entre les travailleur·euses comme entre les nations, les marchés, les marchandises et leurs acheteurs. Mais il serait suicidaire de maintenir cette proximité des rapports sociaux aujourd’hui, et c’est ce paradoxe qui fonde l’impasse de la crise du Covid-19.
Une crise de la reproduction sociale inédite à l’heure de la pandémie
En définitive, avant de devenir une crise de production, la pandémie en cours a engendré une crise systémique de la reproduction sociale. Comme l’avance Tithi Bhattacharya [1], la pandémie révèle la centralité des activités reproductives dans le fonctionnement du capital. Partout dans le monde, cette crise met également en lumière la valeur du travail du care et les inégalités dans l’accès aux soins. En tout point, il s’agit d’une crise sans précédent de la reproduction.

La pandémie comme crise de la reproduction sociale
Pour la théoricienne féministe Nancy Fraser, le capitalisme dans ses différentes phases a toujours été soutenu par divers régimes de reproduction sociale ; autrement dit, diverses séries de relations sociales structurelles capables d’assurer la reproduction du capital. À titre d’exemple, dans la plus grande partie du monde occidental, la séquence néolibérale a vu l’émergence d’un régime de reproduction sociale marchandisé – bien que, comme la pandémie le montre clairement, la menace qu’elle fait peser sur la vie varie significativement selon les systèmes de santé en place au niveau national, avec de grandes différences entre, par exemple, le système privatisé étasunien et le système public des pays européens comme l’Italie, l’Allemagne ou la France. L’essor et l’établissement du régime néolibéral de reproduction n’a pas seulement été un outil pour le développement du modèle de production néolibéral – avec, par exemple, l’entrée massive des femmes dans le marché du travail – au contraire, il a été constitutif de ce dernier. Il s’ensuit que la présente crise n’est pas « juste » une crise de production ; il s’agit plus profondément d’une crise de la reproduction sociale. Les crises capitalistes ont toujours entraîné l’émergence de nouveaux régimes de reproduction sociale. Toutefois, il s’agit ici d’une crise extraordinaire dans la mesure où, pour protéger la vie des travailleur·euses, il est nécessaire de saper la base économique constitutive du capitalisme, sans aucune autre alternative. C’est précisément pour cette raison que les appels à « retourner au travail » restent flous sur les mesures sanitaires à mettre en place pour permettre cette reprise dans de bonnes conditions. Cette crise est inédite en raison d’au moins trois facteurs, à savoir l’impossibilité d’exploiter la force de travail, la confusion du temps de travail rémunéré et du temps de reproduction et la gestion politique de la mort à grande échelle.
Inexploitabilité
Notons tout d’abord que, dans le monde entier, la crise actuelle empêche massivement l’exploitation capitaliste de la force de travail. L’adage tristement célèbre disant que sous le régime capitaliste « il vaut mieux être exploité que ne pas l’être » n’a jamais été aussi véridique. La majorité de la population du globe subsiste en vendant sa force de travail et l’en empêcher la condamne à la misère, Covid-19 ou pas. Une autre particularité de cette crise par rapport aux précédentes est qu’aujourd’hui, le capital ne peut plus se délester des pertes financières sur le dos des travailleur·euses ou de l’État. C’est ce qu’il s’était produit lors de la crise de 2008, quand les gouvernements nationaux ont renfloué les caisses des banques occidentales tandis que les travailleur·euses (du Nord comme du Sud) furent abandonné·e·s à la merci de la récession économique. Les plus chanceux furent contraints de payer des impôts plus élevés avec des salaires plus bas, tout en subissant les coupes budgétaires des services publics. Mais d’autres y ont laissé leur(s) emploi(s) et parfois leur logement hypothéqué en subprime. Pour le moment, le capital ne peut pas faire de la crise actuelle une crise du travail. Des milliers d’usines sont à l’arrêt total et la production de la plupart des biens et services non essentiels a été suspendue. Le marché a été véritablement déserté par les patrons et les employé·e·s qui ont dû battre en retraite pour se retrancher chez eux. C’est la première fois dans l’histoire du capitalisme qu’une crise n’est pas déclenchée par la destruction de capitaux (physiquement ou par l’effet des marchés financiers). Bien sûr, les marchés ont été impactés par la situation, mais il n’y avait pas de guerre ou de krach boursier à son origine. Pourtant, l’effondrement économique semble global. C’est ce qui arrive lorsqu’un système mondial est privé de sa principale ressource : l’exploitation. La pandémie révèle ainsi le caractère névralgique du travail humain dans la production de valeur. Comme Silvia Federici [2] l’a démontré, le corps humain et la force de travail qu’il recèle est la machine la plus puissante que le capitalisme a « inventée ».
Ironie du sort, puisque le capital ne parvient pas à tirer profit de la crise de la reproduction à laquelle nous faisons face aujourd’hui, il marchandise la reproduction sociale afin de trouver de nouvelles sources de profit et multiplie les déclarations politiques pour asseoir sa légitimité électorale. Ainsi, au Royaume-Uni, la production des précieux respirateurs nécessaires aux services de réanimation semble avoir été retardée car le gouvernement n’arrivait pas à décider quelle entreprise serait chargée du marché public. De son côté aux États-Unis, Trump tente d’apaiser les craintes de la population et de relancer l’économie en présentant l’hydroxychloroquine comme un remède contre le Covid-19 (et ce malgré le manque évident de preuves scientifiques). Au final, ce jeu politico-financier s’exerce contre les travailleur·euses du secteur de la santé qui, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Iran ou en Inde, manquent d’équipement pour assurer la base de la reproduction : sauver des vies.

Confusion entre salariat et reproduction
Un second facteur est spécifique à cette crise : l’effacement de la frontière entre le travail salarié et le temps reproductif. Ce phénomène caractérise déjà le travail informel dans les pays du Sud, où il n’est pas rare que les familles des travailleur·euses hébergent une grande variété d’activités à destination des marchés intérieur et international. Néanmoins, le procès qui a engendré l’effacement de la frontière entre travail et non-travail pour toute la population confinée est sans précédent. La quarantaine a révélé la gravité des inégalités socio-économiques du monde capitaliste. Alors que l’on nous répète sans arrêt de rester chez nous, la première inégalité notable est celle qui frappe les personnes sans-abris ou non-véhiculé·e·s. Les images dramatiques des SDF de Las Vegas installé·e·s et séparé·e·s sur des parkings, celles de millions de travailleur·euses migrant·e·s indien·ne·s contraint·es de rejoindre leur village à pied suite à la suspension des transports publics ou leur expulsion de zones industrielles, autant d’exemples qui montrent que « restez chez vous » ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et quand bien même, celles et ceux qui sont assez chanceux pour avoir un logement peuvent aussi se retrouver complètement isolé·e·s, dans une situation critique. Les médias occidentaux se focalisent sur la situation des employé·e·s de la classe moyenne qui jonglent entre leur emploi et l’école à domicile pour leurs enfants (situation dans laquelle je m’inscris en tant qu’universitaire privilégiée), mais ils omettent de préciser qu’en réalité, bon nombre de travailleur·euses ont perdu leur travail. D’autres personnes peuvent se retrouver dans un environnement domestique dangereux – la proportion des violences domestiques dans le monde a explosé pendant la pandémie – ou simplement dans des logements insalubres où la survie même, plutôt que la combinaison travail-enseignement à domicile, est un véritable défi. Sans surprise, l’expérience du confinement est grandement déterminée par la classe, le genre et la race et témoignent de la réalité suivante : nous ne sommes pas tou·te·s dans le même bateau. Mais sous le capitalisme, nous ne l’avons jamais vraiment été. Le confinement lui-même n’est possible qu’en tant qu’il est discriminatoire : en quarantaine chez nous, nous sommes incapables de subvenir à nos propres besoins. Nous ne pourrions pas survivre sans les ouvrier·ère·s, les travailleur·euses logistiques, les fermier·ère·s de l’agroalimentaire. Beaucoup de ces travailleur·euses essentiel·le·s ne touchent pas le salaire minimum, et pourtant iels garantissent notre reproduction en période de confinement.

La réponse politique à un taux de létalité tragique
Le taux de létalité, le nombre de victimes et l’envergure des stratégies mises en place pour y faire face témoignent du caractère inédit de la situation. La crise sociale à laquelle nous faisons face a cela d’exceptionnel qu’elle requiert littéralement le sacrifice de certain·e·s individus pour l’affronter. Mais n’allons pas non plus sous-entendre que le monde capitaliste a fait grand cas de la vie des travailleur·euses jusqu’ici. À titre d’exemple, souvenons-nous qu’il était courant d’exploiter jusqu’à la mort les esclaves noirs. Quant au prolétariat industriel leur espérance de vie est bien inférieure à la moyenne nationale et leur taux d’exposition aux maladies professionnelles largement supérieur. Pourtant, c’est la première pandémie que le capitalisme mondialisé a connue qui semble véritablement menacer tout le monde – on serait tenté de la comparer à la grippe espagnole mais, à l’aube du XXe siècle, le monde n’était pas autant interconnecté et avancé sur le plan médicalqu’aujourd’hui. Et ce n’est certainement pas Boris Johnson qui nous contredira sur ce point.
Mais le nombre de morts ne fait pas disparaître les privilèges de classe dans l’accès aux soins. Si nous savons que d’ordinaire le spectacle capitaliste continue quoi qu’il arrive, aujourd’hui plus que jamais son programme nécropolitique choisit directement qui poursuivra ou non la représentation. Aux États-Unis, par exemple, les Noirs sont beaucoup plus exposés au Covid-19. En comparaison au reste de la population américaine, ils sont plus souvent davantage précaires ou en mauvaise santé. Ils sont également davantage susceptibles de souffrir de diabète, d’hypertension ou de maladies cardiaques – des facteurs aggravant le Covid-19 – et d’être refusés à l’entrée des hôpitaux parce qu’ils n’ont pas d’assurance maladie privée. Les discriminations, le validisme et l’âgisme latent dans le pays se sont exprimés dans les discussions autour des capacités d’accueil des hôpitaux. Souvenons-nous par ailleurs que, pour le système de santé néolibéral, le droit à la vie est établi selon un modèle méritocratique, proportionnellement à la productivité du sujet. Ce paradigme a permis de justifier aisément le taux de mortalité particulièrement élevé chez les personnes âgées, dont le décès était soi-disant inévitable et dû à des pathologies de santé plutôt qu’au virus lui-même. Mais une personne âgée heurtée par une voiture en traversant la route ne meurt pas de vieillesse, même si elle marche lentement. On a assisté à la mise en place de véritables politiques hobbesiennes dans les pays qui manquaient d’appareils respiratoires et de lits en réanimation. Au Royaume-Uni, des médecins sont allés jusqu’à prescrire ouvertement des ordonnances de « ne pas réanimer » (Do Not Resuscitate – DNR) aux personnes autistes adultes ou aux enfants malades. Dans la catastrophe, homo homini lupus – « l’homme est un loup pour l’homme ». Partout dans le monde, les discriminations dans l’accès aux soins s’ajoutent à l’approfondissement plus global des inégalités. Dans les pays du Sud, les populations semblent davantage menacées par les conséquences sociales du Covid-19 (les graves difficultés d’accès aux produits de première nécessité engendrent des risques de sous-alimentation) que par le virus en lui-même. En Inde, par exemple, le confinement coupe les vivres des millions de travailleur·euses de l’économie informelle. La pandémie accentue également les discriminations entre les castes : accusés de ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale, les Dalits [3] ont subi de multiples agressions. Au Kenya, la fermeture des marchés informels peut entraîner une grave augmentation du taux de pauvreté et du gaspillage des stocks alimentaires. On s’inquiète également des moyens de subsistance des travailleur·euses informel·le·s. En Amérique latine, ce sont ironiquement les mafias qui assurent les services essentiels dans les bidonvilles et organisent le confinement, pour réduire le taux de mortalité parmi « leurs » pauvres.
Un nouveau monde ou un autre cauchemar ?
Le confinement, l’effondrement du calcul de la rémunération à l’heure qui distingue travail et temps de reproduction, la nécropolitique et ses centaines de milliers de victimes, tels sont les caractéristiques d’une crise de la reproduction inédite dans l’histoire du capitalisme récent. On n’en voit pas encore la fin et nous osons à peine l’imaginer. Pour Arundhati Roy [4], les pandémies nous obligent à repenser nos sociétés ; elles sont un pont entre le passé et une nouvelle ère. Allons-nous retenir la leçon ou continuer comme avant ? Le prochain mode de reproduction sociale du capitalisme cessera-t-il enfin d’être fatal à celles et ceux qu’il reproduit, même en temps de crise ? On peut l’espérer. Pourtant, les débats en cours sur les modalités du déconfinement – portant sur « l’immunité collective » et l’introduction de passeports d’immunité – suggèrent déjà qu’il n’y aura que davantage de frontières dans le monde de demain. Mais cette fois, les individus seront divisés en fonction du potentiel économique qu’ils représentent pour le système reproductif. On assistera alors à l’avènement d’un nouveau critère d’inégalités socio-économiques, basées sur le "capital immunitaire".
⁂
Alessandra Mezzadri est une économiste féministe de la School of Oriental and African Studies de Londres, où elle exerce en tant que maîtresse de conférence en étude du développement. Son enseignement et ses recherches sont centrés sur les chaînes de marchandises mondiales, le travail informel, les normes du travail et l’esclavage moderne, le féminisme dans une approche fondée sur le développement et la reproduction sociale et l’économie politique de l’Inde. Elle est l’autrice de The Sweatshop Regime : Labouring Bodies, Exploitation, and Garments ‘Made in India) (CUP ; 2017), et Marx in the Field (ed.)(Anthem, forthcoming).