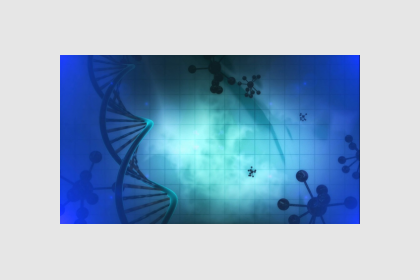Le macronisme : néo-fascisme ? Autoritarisme ?
Même un centriste bon teint comme de Courson s’émeut de la dangereuse pente qu’est en train d’emprunter Macron.
Si on s’en réfère à une définition courante, le fascisme est la rencontre entre le populisme, le nationalisme et le totalitarisme au nom d’un idéal collectif suprême, l’Homme nouveau, avec sa pureté nationale et raciale. Il se caractérise également par une toute puissance de l’État. On sait bien que la politique de Macron vise surtout à dépecer l’État, du moins dans le domaine économique.
Le fascisme entendait également lutter contre l’individualisme au nom d’une masse incarnée par le Chef, quand Macron glorifie les entrepreneurs individuels, les premiers de cordée, allant par exemple jusqu’à refuser les projets collectifs sur la Zad après l’abandon du projet d’aéroport.
Le constat : le macronisme est un autoritarisme
La définition de Linz
Le sociologue politique espagnol Juan Linz a, dans les années 60, effectué un énorme travail sur la notion d’autoritarisme politique.
Pour lui, les régimes autoritaires sont « des systèmes politiques caractérisés par un pluralisme politique limité, non responsable, dépourvus d’idéologie directrice élaborée mais reposant sur une mentalité caractéristique, sans volonté de mobilisation extensive aussi bien qu’intensive si ce n’est à certains moments de leur développement, et dans lesquels un leader ou parfois un petit groupe exercent un pouvoir dont les limites formelles sont mal définies bien qu’elles soient en fait très prédictibles. »
Reprenons patiemment les différents éléments de cette définition au prisme de l’année macronienne écoulée.
« Pluralisme politique limité » : Le ministère de l’intérieur, sur son site Internet, distingue 17 « nuances » pour donner les résultats du 1er tour des législatives de 2017, y compris des « divers », droite ou gauche. Pourtant, dans les cafés, dans les micro trottoirs, pour expliquer l’abstention, autour de nous, on entend volontiers que « gauche et droite c’est pareil », qu’ils font la même politique etc… Et ce depuis des années, peut-être depuis 1983 et le virage politique de Mitterrand.
Guy Hermet, dans un article sur Linz, parle d’un « pluralisme ouvert aux seuls secteurs disposés à accepter l’équilibre social existant, mais excluant [ou ridiculisant, comme cela s’est produit avec Philippe Poutou dans un célèbre talk show ou plus récemment avec les moqueries de certains éditorialistes sur les prestations télévisées de gilets jaunes] tous les éléments enclins à modifier cet équilibre. »
Et, dans le champ médiatique, cela fait penser à la terrible démonstration du film « Les nouveaux chiens de garde », avec ses débats factices entre experts aux idéologies supposément contradictoires.
« Non responsable » : Cet élément semble plus problématique au vu des mécanismes constitutionnels prévoyant une responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Cependant, on a vu que les motions de censure ont fort peu de chances d’être couronnées de succès. Et de fait, depuis l’élection de Macron, il est frappant d’entendre parler de « députés godillots », « aux ordres », se contentant de respecter la discipline de vote LREM, voire reprenant in extenso les éléments de langage produits pour eux.
Depuis l’affaire Benalla, cela va même plus loin : s’exprimant pour la première fois sur le sujet, devant un parterre de députés amis, le président a estimé être « le seul responsable ». Or, il est précisément, du fait de son statut, le seul à ne pas l’être…
« Dépourvus d’idéologie directrice élaborée mais reposant sur une mentalité caractéristique » :
Nous avons évoqué plus haut le « gauche et droite c’est pareil » à l’œuvre depuis des décennies. Macron en a certainement tiré les leçons en se revendiquant « ni de gauche ni de droite » lors de sa campagne (on est cependant certainement tous d’accord pour estimer que sa 1re année de pouvoir a tendance à pencher). Le pragmatisme entreprenarial est mis en avant, contre les idéologies. Et c’est bel et bien la mentalité du « 1er de cordée » qui est à l’honneur (on se rappellera aussi de cette banderole en manif : « Nous ne serons jamais des winners, connard ! », difficilement imaginable en d’autres temps).
Guy Hermet explique d’ailleurs : « Ou bien les secteurs qui leur sont acquis le sont par avance, en vertu précisément d’une « mentalité » qui les y prédispose, ou bien ils ne peuvent demeurer qu’ennemis, irrécupérables, rebelles à toute mobilisation, au regard de dispositions mentales inversées par rapport à celles des soutiens de l’autoritarisme. » On retrouve ici la stigmatisation des zadistes, des « crasseux », des « casseurs », des « feignants », des « racailles de banlieue », de « ceux qui ne sont rien »…
Etonnamment, la définition de Linz n’évoque pas explicitement la répression. C’est pourtant un des éléments qui pourrait venir immédiatement à l’esprit lorsque l’on parle de régime autoritaire. Guy Hermet est plus explicite : « Faute de pouvoir envisager la possible conversion du secteur ennemi, la répression autoritaire a son élimination au besoin physique comme objectif exclusif limité. » On pense évidemment ici aux plus de 300 blessés recensés par David Dufresne depuis le début du mouvement des gilets jaunes, à l’état d’urgence dans le droit commun, à longue liste de violences policières bien souvent mortelles, à la main arrachée de Maxime sur la Zad, aux manifestants de 2018 criminalisés car ils avaient le malheur d’avoir des lunettes de piscine pour se protéger de gaz lacrymo particulièrement virulents, un pull noir, des gants ou une clé Ikéa dans leur sac, aux lycéens d’Arago parqués 48h dans des cars de police sans pouvoir boire, manger, uriner, à leurs parents inquiets et sans nouvelles. Nous parlons ici du travail répressif des forces de l’ordre. Benalla, pur produit du macronisme et de sa mentalité, n’a fait que les singer.
« Sans volonté de mobilisation extensive aussi bien qu’extensive si ce n’est à certains moments de leur développement » :
C’est-à-dire lors des élections. Là où les totalitarismes exerçaient une terreur universelle et une menace permanente et latente sur l’ensemble de la population afin qu’elle ne fasse plus qu’une derrière la Nation incarnée par le Chef, l’autoritarisme, qui se contente de réprimer les ennemis, s’accommode très bien de l’indifférence du reste de la population. Nulle volonté de diffuser l’État et son dogme, mais plutôt un « État bunker ».
« Dans lesquels un leader ou parfois un petit groupe exercent un pouvoir dont les limites formelles sont mal définies bien qu’elles soient en fait très prédictibles » : A l’heure où ces lignes sont écrites, l’affaire Benalla est encore dans toutes les têtes, nul besoin d’expliciter davantage.
Les raisons : du despotisme doux à l’autoritarisme qui matraque
Si nous reprenons ces caractéristiques de l’autoritarisme développées plus haut, force est de constater que nombre d’entre elles étaient déjà partiellement d’actualité, il y a des décennies. Nous pensons à la présidence de Nicolas Sarkozy, mais aussi à la répression des mouvements sociaux lors de la Loi travail en 2016. Comme nous l’avons vu plus haut, l’absence de différenciation idéologique n’est pas nouvelle, et la question de la légitimité peut également se poser avec une abstention toujours plus importante.
Peut-être alors l’autoritarisme macronien était il en germe depuis longtemps, l’épisode Macron ne constituant que le moment de floraison, ou, en étant plus pessimiste, seulement celui du bourgeonnement ?
C’est sans nul doute maintenant qu’il est important de relire Tocqueville, cet aristocrate, qui, au début du XIXe siècle, connaissait la démocratie mieux que quiconque.
Dans De la Démocratie en Amérique (1835), il mettait en garde contre certaines faiblesses de la démocratie telles qu’elle se mettait en place outre atlantique, pouvant mener à ce qu’il appelait un « despotisme doux » :
« Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance, il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser, et la peine de vivre ? »
En lisant ces lignes, on ne peut que penser au si doux développement de l’État Providence. Et à sa mort programmée depuis que la doxa du néolibéralisme s’impose un peu partout. Ce savant équilibre, décrit par Tocqueville, est déjà du passé. Le despotisme n’est plus vraiment doux, l’État se désengage, que chacun se débrouille. La prospérité n’est plus, depuis quarante ans que la Crise est érigée en mode de gouvernement.
Or, le despotisme doux a pour conséquence que les citoyens sont « préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n’aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d’eux à la prospérité de tous. Il n’est pas besoin d’arracher à de tels les droits qu’ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. L’exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. (…) Les citoyens qui travaillent ne voulant pas songer à la chose publique, et la classe qui pourrait se charger de ce soin pour remplir ses loisirs n’existant plus, la place du gouvernement est comme vide. Si à ce moment critique, un ambitieux habile vient à s’emparer du pouvoir, il trouve que la voie à toutes les usurpations est ouverte. Qu’il veille quelque temps à ce que tous les intérêts matériels prospèrent, on le tiendra aisément quitte du reste. Qu’il garantisse surtout le bon ordre. »
Résumons : les citoyens ne s’intéressent plus qu’aux jouissances matérielles et ont désinvesti le domaine politique, perdant du même coup toute légitimité à l’exercer du fait de leur peu d’expérience. Or, les jouissances matérielles deviennent de plus en plus difficiles à acquérir. La concurrence entre individus se fait de plus en plus forte, et l’insécurité de ces richesses devient de plus en plus flagrante. L’équilibre social du despotisme doux semble bien précaire. Comment résistera t-il ? Interrogeons une fois de plus Tocqueville : « Les hommes qui ont la passion des jouissances matérielle découvrent d’ordinaire comment les agitations de la liberté troublent le bien-être, avant que d’apercevoir comment la liberté sert à se le procurer ; et, au moindre bruit des passions publiques qui pénètrent au milieu des petites jouissances de leur vie privée, ils s’éveillent et s’inquiètent ; pendant longtemps, la peur de l’anarchie les tient sans cesse en suspens et toujours prêts à se jeter hors de la liberté au premier désordre. Je conviendrai sans peine que la paix publique est un grand bien ; mais je ne veux pas oublier cependant que c’est à travers le bon ordre que tous les peuples sont arrivés à la tyrannie. Il ne s’ensuit pas assurément que les peuples doivent mépriser la paix publique ; mais il ne faut qu’elle leur suffise. Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l’ordre est déjà esclave au fond du cœur. Elle est esclave de son bien-être, et l’homme qui doit l’enchaîner peut paraître. »
Nous avons parlé plusieurs fois ici du désengagement de l’État. Cependant, s’il est un domaine où il semble se renforcer, c’est bien dans le maintien de l’ordre ! Il n’y a plus de carotte, uniquement le bâton. Le despotisme n’a plus rien de doux, il est devenu un autoritarisme. Un autoritarisme qui n’a pas peur, comme le montrait Guy Hermet plus haut, de réprimer durement les quelques citoyens qui n’ont pas renoncé à se mêler de politique, peu enclins à se contenter des jouissances matérielles, et peu réceptifs à la mentalité des « winners ». Car le Pouvoir compte bien sur la tétanisation de tous les autres, inquiets de leur biens, pour ne pas les soutenir.
L’issue : les zones d’autonomie politique
S’appuyer sur Tocqueville peut poser question. A lire certains commentateurs, la source de tous les maux décrits par lui serait l’Egalité. De même, il est possible de lire sous sa plume des passages d’une rare violence contre le socialisme naissant. Pourtant, force est de constater que sa pensée est un tantinet plus complexe.
Tocqueville ne voit qu’une solution pour éviter les dangers qu’il décrit : l’association.
« Il est clair que, si chaque citoyen, à mesure qu’il devient individuellement plus faible, et par conséquent plus incapable de préserver isolément sa liberté, n’apprenait pas l’art de s’unir à ses semblables pour la défendre, la tyrannie croîtrait nécessairement avec l’égalité. »
Pour lui, « l’association libre des citoyens pourrait remplacer la puissance individuelle des nobles [des sociétés aristocratiques] et l’État serait à l’abri de la tyrannie. »
Il est évident, du début du XIXe siècle duquel il écrit, qu’il ne fait nulle référence à loi de 1901 qui régit le secteur associatif en France depuis lors, avec une certaine rigidité toute étatique. Qu’entend-il par là ?
Pour Cyrille Ferraton, Tocqueville décrit des « associations volontaires constituées sur une base locale. » Elles reposent sur l’égalité, mais aussi la liberté (nulle contrainte chez Tocqueville, ce qui explique peut-être sa méfiance face à certains socialistes). La doctrine de « l’intérêt bien entendu », sur laquelle Tocqueville s’appuie, permet de garantir la liberté politique par la gestion collective et concertée de l’intérêt général : « Ainsi, le pays le plus démocratique de la terre se trouve être celui de tous où les hommes ont le plus perfectionné de nos jours l’art de poursuivre en commun l’objet de leurs communs désirs. » Ou encore : « Il n’y a rien que la volonté humaine désespère d’atteindre par l’action libre de la puissance collective des individus. »
La pratique associative constitue également un apprentissage, un développement du pouvoir d’agir en tant que citoyen : « On s’occupe d’abord de l’intérêt général par nécessité, et puis par choix ; ce qui était calcul devient instinct ; et, à force de travailler au bien de ses concitoyens, on prend enfin l’habitude et le goût de les servir. »
Nous n’allons pas ici tenter de démontrer que Tocqueville était un zadiste qui s’ignorait. Cependant, nous partons du postulat que la vie sur la ZAD de NDDL, avant sa normalisation forcée, ressemblait beaucoup au fonctionnement décrit plus haut. Point de culte de la consommation et des biens matériels, auto-gouvernement sur les bases de la liberté et de l’ égalité (lutte contre toutes les dominations). L’autonomie politique, sur la ZAD ou au Chiapas, au Rojava, sur des territoires donnés, constitue un essai de démocratie résolument non autoritaire, où liberté, égalité et solidarité sont étroitement entremêlées sans plus se menacer mutuellement comme le craignait Tocqueville. Elle n’est ni despotisme doux, ni autoritarisme. Elle est gestion collective des biens communs. Elle fait du débat entre personnes résolument différentes libres et égales la clé de voûte de l’auto-gouvernement. Les règles existent, mais elles ont été construites collectivement. Un passage sur la zad suffit à être impressionné par le degré d’organisation sur place : même au plus fort des expulsions, quand les grenades lacrymogènes saturaient l’air, que les blessés affluaient, un repas était servi aux plusieurs centaines de personnes présentes.
La vie en zone d’autonomie politique, même limitée dans le temps, constitue une expérience marquante, un apprentissage personnel aussi bien que collectif. Elle bouleverse bien des certitudes, ouvre des portes et aussi le champ des possibles. Celles et ceux qui ont fait cette expérience en reviennent profondément changés. Des curieux deviennent soudain d’infatigables militants, d’autres créeront dans leur quartier des zones d’autonomie. Plus ces zones seront présentes, partout, plus elles trouveront de nouveaux défenseurs.
Les rond-points des gilets jaunes, mais aussi le municipalisme libertaire constituent également des expériences de zones d’autonomie politique.
Cependant, le despotisme, comme on le voit aujourd’hui avec la destruction méthodique de tout ce qui est collectif, « voit dans l’isolement des hommes le gage le plus certain de sa propre durée, et il met d’ordinaire tous ses soins à les isoler. (…) Il appelle esprits turbulents et inquiets ceux qui prétendent unir leurs efforts pour créer la prospérité commune, et changeant le sens naturel des mots, il nomme bons citoyens ceux qui se renferment étroitement en eux-mêmes. »
Il existe un autre ouvrage important de Tocqueville : son dernier. Il y délaisse ses habits de sociologue philosophe pour endosser ceux de l’historien. Dans l’Ancien Régime et la Révolution, il s’emploie à montrer que la Révolution française, loin d’être une rupture, n’est que la traduction en actes d’idées qui s’étaient répandues sous l’Ancien régime. La Révolution est ainsi vue comme l’ajustement de la politique sur la société, l’éclatement d’une structure qui n’était déjà plus d’actualité. A nous donc de continuer à créer des zones d’autonomie politique, ici, maintenant et partout, malgré la répression ! La révolution tant attendue n’en sera que facilitée.