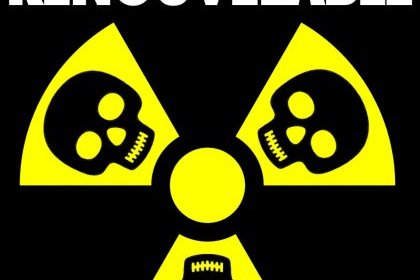Parmi la vingtaine d’assignations à résidence prononcées, depuis fin novembre, à l’encontre de militants politiques sans aucun lien avec la moindre mouvance de l’islam radical, sept ont contesté cette décision devant la justice administrative, en déposant un « référé-liberté » (une procédure d’urgence pour mettre fin à un préjudice immédiat en terme de libertés publiques).
Un seul de ces recours a été examiné sur le fond, à Melun, même s’il a été rejeté en première instance. Dans les six autres cas, le juge administratif n’a même pas pris la peine d’instruire la plainte et les a tout simplement rejeté par « ordonnance », procédure express « sans instruction contradictoire ni audience ». Comme quoi, l’urgence de l’État est à sens unique, puisque le « référé-liberté » est la seule procédure possible en pareil cas pour une personne dont les droits fondamentaux sont violés par une décision administrative arbitraire.

Nous ne nous amuserons pas ici à autopsier le jugement du Conseil d’État (CE) du 11 décembre, qui a donc rejeté les recours des sept assignéEs en usant d’expéditifs « copié-collé » dans chacune des décisions. (Si ça vous amuse, rendez-vous sur la page mis en ligne vendredi soir par la « haute » juridiction.)
Le rapporteur public - terme concacré en pareil cas au magistrat représentant de l’État, sorte de super avocat-général qui parle au nom du ministère public lors des audiences d’appel devant le CE - a pris au mois une heure pour exposer ses conclusions qui n’ont surpris personne. Une plaidoirie soporifique qui a demandé, au final, le rejet en bloc des recours et qui, par extension, a légitimé les assignations à résidence. Argument repris par le CE dans sa décision :
« Le Conseil d’État a estimé, en l’état de l’instruction, que chacune des sept mesures d’assignation à résidence dont il était saisi traduisait, compte tenu du comportement de la personne concernée et de la mobilisation particulière des forces de l’ordre, une conciliation entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public qui ne portait pas une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Il a donc jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de mesures de sauvegarde. »
Le rapporteur s’est tout de même permis de souffler dans les bronches des juges des référés qui, en première instance, ont classé les recours d’un revers de main, sans instruction, genre : « Circulez manants, il n’y a rien à voir ! ». Il a rappelé que le « référé-liberté », en pareil cas, aurait du être examiné dans les formes, et sur le fond, en audience, et que la rejeter sans débat par ordonnance n’était pas conforme ! Le CE, qui le dit avec des termes un peu plus fleuris :
« a estimé qu’un recours contre une assignation à résidence justifie en principe que le juge des référés se prononce en urgence, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, [qu’il] doit rechercher si les motifs ayant justifié l’assignation et les modalités de l’assignation ne sont pas manifestement illégaux [et qu’il] peut ordonner toute mesure pour mettre fin à une illégalité manifeste, notamment en modifiant les modalités de l’assignation. »
Un élément collatéral de ce jugement quasi-collectif, qui sera sans doute jugé réjouissant pour les amoureux de l’État de droit, a conduit le CE à enjoindre le Conseil constitutionnel (CC) à examiner (selon la procédure dite QPC) « l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui fonde le pouvoir d’assignation à résidence du ministre de l’intérieur ». Le premier sinistre Valls avait en effet demandé aux parlementaires, lorsqu’ils ont prorogé l’état d’urgence pour les trois prochains mois, de ne pas saisir le CC par souci de patriotisme sécuritaire. Là, il n’y coupera pas. Mais seuls les doux rêveurs peuvent imaginer que cette autre « haute » juridiction soi-disant indépendante puisse juger ces assignations comme contraires à la Constitution.
Finalement, sans rentrer dans les détails de la loggorhée judiciaire, le débat s’est cristalisé autour des notions de « privation » ou de « restriction » des libertés qu’entraînerait l’assignation à domicile. Au bout d’une plombe de palabres, le rapporteur public, qui sera suivi intégralement par le CE, a finalement jugé qu’il s’agissait d’une simple « restriction », et qu’en l’espèce cela ne contrevenait pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Extrait :
« 24. Considérant, d’une part, que si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et en tout état de cause, [le requérant] ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre ; »
Enfin, dernier point utile à mentionner à ce stade, les bases légales sur lesquelles le ministère s’est reposé pour justifier les assignations. À savoir les fameuses "notes blanches", selon le terme utilisé du temps des Renseignements généraux, c’est à dire des éléments récoltés par les seuls services de renseignement, extraits choisis des fichiers policiers les plus occultes - appelons-les plutôt les "notes grises". Elles ont été avalisées par le CE sans aucune réserve : "aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif".
Il faut dire aussi que la modification de la loi sur l’état d’urgence a donné un peu plus de latitude à la répression pour accuser quelqu’un.une sans preuves. Jusqu’ici, la loi permettait d’assigner à résidence les personnes « dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». Alors que la nouvelle rédaction du 20 novembre 2015 utilise des formules autrement plus floues. L’assignation devient justifiée sur toute personne « à l’égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité ». Il n’y a donc plus besoin de faits concrets, ou même "d’indices graves et concordants" (termes du code pénal), mais seulement de "sérieuses raisons de penser" (!) que quelqu’un.une constitue une "menace" au point de le.la priver de sa liberté d’aller et venir… De plus, c’est son "comportement" qui est visé - et donc, par extension, ses opinions, pensées, projets - ou prétendus tels par la flicaille administrative - et non plus son ou ses "activités" politiques. Une assignation à résidence est une arrestation préventive qui ne dit pas son nom, une privation des libertés les plus fondamentales, qui institue comme alpha le procès inéquitable et comme omega la présomption de culpabilité. Point barre. Le reste n’est qu’enrobage. Il est finalement très instructif de constater que la social-démocratie de 2015 s’avère plus crasse que la IVe République qui venait de sauter à pieds joints dans le bourbier algérien !
Vive l’état d’urgence à la sauce socialo-patriotique !
(Signé : un témoin anonyme de l’audience du 11 décembre)