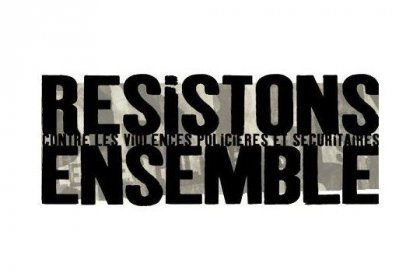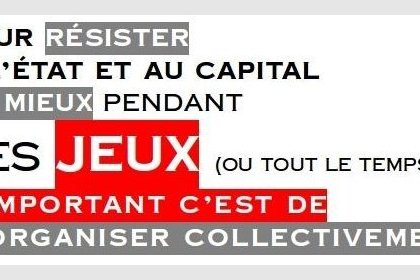L’émission (1 heure 20 minutes) comporte :
Un rappel des mobilisations pré-1968 autour de l’institution judiciaire, centré autour de l’erreur judiciaire (affaire Dreyfus, affaire Durand) et des prisonniers politiques (anarchistes, militants anticolonialistes), et des critiques pré-1968, centré autour de l’idée de justice de classe, sans pour autant (en-dehors des anarchistes) de soutien aux prisonniers de droit commun, assimilés au « lumpenprolétariat » ;
Une analyse du tournant de mai-juin 1968 et de ses suites, avec un passage d’une défense des prisonniers politiques (militant d’extrême gauche emprisonné) à une défense de l’ensemble des prisonniers et de leurs luttes (GIP) ;
Une présentation de la critique post-1968 des « institutions disciplinaires » (prisons, asiles, armée, foyers de travailleurs, foyers de jeunes filles, orphelinats, collèges, lycées, famille, usines) et de leurs rapports de « domination rapprochée » (Memmi) ;
Une discussion des héritages anarchistes des critiques anticarcérales des années 1968 ;
Un exposé des critiques post-1968 de l’idée maoïste de « justice populaire » ;
Une analyse des institutions disciplinaires comme tentatives de modelage, de redressage et de normalisation des comportements considérés comme déviants aux moyens d’un pouvoir discrétionnaire fait de punitions et de gratifications ;
Une discussion des positions anticarcérale maximaliste (abolition des prisons) et anticarcérale minimaliste (défense des droits des prisonniers) et de leur articulation ;
Une analyse du passage d’une critique moralisatrice des bourgeois comme « déviants » au nom d’une « moralité ouvrière » à une critique des normes au nom des « déviants » contestant l’ordre normalisateur des institutions disciplinaires ;
Une description du passage d’une punition d’un seul délit à une punition du délit et du délinquant (qu’il s’agit, par conséquent, de redresser dans une institution disciplinaire) ;
Une discussion de l’évolution de l’articulation des nouvelles critiques sociales (homosexuelles, féministes, antiracistes, anticarcérales, antipsychiatries) aux théories marxistes et anarchistes ;
Une analyse de l’extension des biais de l’institution judiciaire (impunité des bourgeois, mais également des violeurs et des auteurs de crimes racistes) ;
Un résumé des débats dans l’extrême gauche et au sein du féminisme autour du viol au cours des années 1970 ;
Une analyse contextualisée du débat post-1968 autour de l’autorisation (ou non) des relations sexuelles entre majeurs et mineurs, et des problèmes structurels (domination adulte) que de telles relations impliquent tendanciellement ;
Une conclusion autour de l’évolution de ces critiques, de ces tensions (luttes antirépressions pénales et luttes de répression des crimes sexuels), de ces questions (tournant sécuritaire-punitif des politiques publiques) et des alternatives au tout-judiciaire (autodéfense féministe) depuis une quarantaine d’années ;
Une ouverture au sujet de la justice zapatiste et zadiste, et de l’impérieuse nécessité d’une transformation sociale pour faire émerger une autre forme de justice.