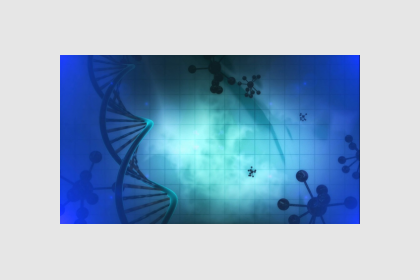A sa parution en 2018, la traduction française du livre de Peter Gelderloos Comment la non-violence protège l’État avait fait un certain bruit. Et pour cause : ce que beaucoup de militant-e-s (dont je faisais partie) jugeaient jusque-là évident – à savoir que nos luttes devaient être menées pacifiquement – était ouvertement mis en cause.
Lorsque j’ai lu le livre, il y a deux ans, je me souviens l’avoir trouvé déroutant. Je ne savais tout simplement pas quoi penser des arguments de Peter Gelderloos. Devais-je me laisser convaincre ? Fallait-il que je renonce à mes positions non-violentes ?
Récemment, je me suis donc mis en tête de le lire une seconde fois, avec la ferme intention de me faire un avis plus tranché.
La conclusion à laquelle je suis parvenu est la suivante. J’étais dans l’erreur : la non-violence est effectivement une position intenable. Cependant, la proposition alternative de Peter Gelderloos (selon laquelle, pour faire simple, un mode d’action est légitime dans la seule mesure où il est efficace) me paraît, elle aussi, poser certains problèmes.
Dans ce petit texte j’essaie d’expliquer les raisons pour lesquelles cette position me semble être la plus juste et de proposer quelques pistes de réflexion pour résoudre ces problèmes.
Celles et ceux qui n’ont pas encore lu le livre y trouveront également un résumé de la thèse qu’il défend et des principaux arguments qui la soutiennent.
La notion de non-violence
Avant toute chose, il me semble important de revenir sur la notion de non-violence, au sens où Peter Gelderloos l’emploie dans le livre, car elle peut porter à confusion.
Nous utilisons parfois ce mot pour désigner la position des militant-e-s qui refusent, à titre purement personnel, d’utiliser la violence. Ce n’est pas à cette position que le livre s’attaque :
Rappelons un point crucial : les critiques de ce livre ne visent pas des actions spécifiques ne faisant pas montre d’une attitude violente, comme un rassemblement pacifique, pas plus qu’elles ne visent des activistes spécifiques qui choisissent de se consacrer au travail non combatif, comme le soin ou la construction de relations communautaires [1].
Pour Peter Gelderloos, la non-violence est autre chose. Elle est la position de celles et ceux qui affirment que tou-tes-s les militant-e-s doivent s’abstenir de recourir à la violence, faute de quoi elles/ils ne peuvent pas être considéré-e-s comme des allié-e-s :
Lorsque je parle des pacifistes et des partisans de la non-violence, je fais référence à ceux qui tentent d’imposer leur idéologie au mouvement tout entier, et de dissuader d’autres activistes de s’impliquer de manière plus militante (y compris à l’aide de la violence), ou qui refusent de soutenir d’autres activistes en raison de leur forme de militantisme [2].
A cette position, l’auteur oppose le principe de la « diversité des tactiques ». Ce principe est relativement simple : toutes les tactiques qui sont efficaces doivent pouvoir être utilisées, qu’elles soient violentes ou non :
Nous pensons que les tactiques doivent être choisies en fonction des situations particulières et non pas d’un code moral universel immuable. Nous pensons aussi que les moyens expriment les fins, et nous ne voulons pas que nos actions perpétuent immanquablement une dictature ou une forme de société qui ne respecte pas le vivant et la liberté [3].
Bien entendu, si nous jugeons que certaines de ces tactiques sont trop radicales pour nous, nous ne sommes pas tenu-e-s de les utiliser nous-mêmes. Mais nous sommes tenu-e-s, au moins, de laisser la liberté aux autres militant-e-s de les choisir et de rester solidaires avec elles/eux lorsqu’elles/ils le font.
Les arguments du livre contre la non-violence (et pour la diversité des tactiques)
Maintenant que j’ai clarifié la notion de non-violence, je voudrais exposer rapidement l’argumentaire qu’utilise Peter Gelderloos pour critiquer cette position et défendre celle de la diversité des tactiques.
Chaque chapitre du livre profère une accusation particulière à l’encontre de la non-violence. Celle-ci est ainsi taxée successivement d’être « inefficace », « stratégiquement inférieure », « étatiste », « raciste », « patriarcale » et « un leurre ». A travers toutes ces critiques, c’est un seul et même argument que l’auteur étire tout au long du livre. Cet argument peut être résumé de la façon suivante :
(1) Nous devons choisir le mode de lutte le plus efficace pour lutter contre l’État, le capitalisme, le patriarcat et le suprémacisme blanc.
(2) La non-violence implique que nous ne devons employer que des tactiques pacifiques pour lutter contre l’État, le capitalisme, le patriarcat et le suprémacisme blanc.
(3) Or, les tactiques pacifiques sont inefficaces lorsqu’elles ne sont pas couplées à d’autres tactiques plus radicales.
(4) La non-violence n’est donc pas le mode de lutte le plus efficace pour lutter contre l’État, le capitalisme, le patriarcat et le suprémacisme blanc. Le mode de lutte le plus efficace est la diversité des tactiques.
(5) Par conséquent, nous devons rejeter la non-violence et choisir la diversité des tactiques.
L’essentiel des développements du livre sont consacrés à démontrer le point (3). Pour ce faire, Peter Gelderloos analyse de nombreux épisodes de l’histoire des mouvements sociaux. Ce travail d’enquête est, d’ailleurs, l’un des principaux intérêts de l’ouvrage. Il remet en cause la vision dominante que l’on donne souvent de certains combats politiques emblématiques du passé.
Ainsi, à propos du combat pour l’indépendance de l’Inde – qui, dans l’imaginaire collectif fut gagné exclusivement par le recours à des tactiques pacifiques –, il écrit :
En Inde, la non-violence n’était pas universelle. La résistance contre le colonialisme britannique était suffisamment diversifiée pour que la méthode gandhienne puisse être considérée comme une des formes du militantisme populaire. Dans le cadre de leur falsification méthodique et universelle, les pacifistes expurgent ces autres formes de résistance de l’histoire qu’ils rapportent, et prétendent que Gandhi et ses disciples constituaient la colonne vertébrale et la tête de la résistance indienne. Les leaders importants comme Chandrasekhar Azad, qui combattit les colonisateurs britanniques les armes à la main, et les révolutionnaires comme Bhagat Singh, qui gagna le soutien des masses en posant des bombes et en commettant des assassinats dans une lutte pour « renverser le capitalisme étranger et indien », sont ignorés [4].
De la même manière, il déconstruit la représentation commune, largement mythifiée, du mouvement pour les droits civiques dont le révérend Martin Luther King fut l’une des principales figures :
La croyance commune […] veut que le mouvement contre l’oppression raciale aux États-Unis ait été principalement non-violent. Au contraire, bien que des groupes comme le Southern Christian Leadership Conference (SCLC) de Martin Luther King Jr. aient eu beaucoup de pouvoir et d’influence, les pauvres Noirs, qui constituaient la base populaire du mouvement, gravitaient autour de groupes militants révolutionnaires comme la Black Panther Party. Selon un sondage Harris de 1970, 66% des Afro-Américains affirmaient que le Black Panther Party les rendait fiers, et 43% que le parti incarnait leurs propres convictions [5].
L’ouvrage s’appuie également sur d’autres exemples moins connus. Il cite notamment le cas des Industrial Workers of the World (IWW), un syndicat anarchiste américain très actif au début du XXe siècle et qui, à partir du début des années 1910, décida de ne plus entreprendre aucune action illégale (notamment des actions de sabotage). Malgré cette décision, le pouvoir américain de l’époque n’hésita pas à le réprimer durement. Cette répression fut payante puisqu’il put rapidement faire emprisonner des centaines de membres et parvint ainsi à briser la dynamique favorable dont bénéficiait le mouvement. Cet exemple est intéressant parce que la répression des anarchistes pendant cette période a également concerné d’autres groupes (comme les anarchistes italiens de la Nouvelle-Angleterre) qui, eux, n’avaient pas renoncé à l’usage de la violence. Et, d’après Peter Gelderloos, elle a donné sur ces autres groupes, des résultats beaucoup plus mitigés [6].
Pour donner un dernier exemple, il mentionne aussi la manière dont les pouvoirs publics américains ont réussi, à partir des années 1970, à utiliser la non-violence comme un moyen de garder les mouvements sociaux sous contrôle, parfois même avec la complicité de certain-e-s militant-e-s pacifistes :
Au cours des années [suivant la période 1960-1970], la police a développé des stratégies de contrôle, via des polices de proximité, afin d’améliorer son image et son contrôle sur les communautés potentiellement subversives qui s’organisaient, ainsi que des tactiques de contrôle des foules orientés vers la désescalade. Les descriptions de ces tactiques reflètent exactement les recommandations des pacifistes concernant la « bonne » façon de tenir une manifestation. La police autorise des formes mineures de désobéissance tout en maintenant une communication avec les meneurs de la protestation, sur lesquels ils font pression par avance afin d’amener la manifestation à se policer elle-même. Les « peace marshals » (équivalent de nos « services de sécurité », NdT), les auxiliaires de police et les autorisations de défiler sont autant d’aspects de cette stratégie […] [7].
Pourquoi cet argument nous donne de bonnes raisons de rejeter la non-violence
L’argumentaire de Peter Gelderloos montre, de façon à mon avis convaincante, que beaucoup de croyances très communes concernant l’efficacité relative des tactiques violentes et non-violentes sont des légendes.
En effet, tout porte à croire que, au moins dans la plupart des cas, lorsque les tactiques pacifiques sont employées seules - c’est-à-dire, sans qu’on y ajoute des méthodes plus offensives - elles sont complètement inefficaces.
La non-violence ne peut donc conduire qu’au maintien du status quo. Et, ce seul fait nous donne une bonne raison de la refuser.
L’ordre du monde est injuste et doit être transformé. Dans ce contexte, si nous estimons que la seule stratégie acceptable est une stratégie complètement inoffensive, alors nous devenons les défenseurs des systèmes d’oppression que nous devrions combattre.
En d’autre termes, la non-violence nous interdit, de fait, de mener une lutte juste et légitime et, en cela elle est profondément critiquable.
Les limites d’une approche centrée sur l’efficacité tactique et stratégique
Jusqu’ici, je n’ai abordé que l’aspect négatif de la thèse de Peter Gelderloos (la non-violence doit être rejetée). Mais cette thèse a aussi un aspect positif (la diversité des tactiques doit être acceptée). Et, sur ce second point, l’argument me paraît beaucoup plus fragile.
Certes, le livre montre de façon convaincante que la non-violence est inefficace. Mais cela ne permet d’étayer que le point (3) de l’argument. Comme j’ai essayé de le montrer un peu plus haut, cela suffit probablement à rejeter la non-violence. Mais cela ne suffit pas à démontrer que la diversité des tactiques est un principe juste. Pour que cette démonstration soit faite, il faut aussi que les points (1), (2) et (4) soient corrects.
Or, je pense que le point (1) soulève une difficulté : il implique que la légitimité d’un mode d’action militante dépend entièrement et exclusivement de son efficacité, ce qui est manifestement faux.
En effet, si cela était vrai, alors nous ne pourrions pas expliquer pourquoi certaines tactiques - comme par exemple, tuer des personnes opprimées et imputer cet acte à nos ennemi-e-s - sont inacceptables quelle que soit leur degré d’efficacité. C’est donc bien que l’efficacité ne fait pas tout. Il doit y avoir d’autres paramètres à prendre en compte. Nous voudrions certainement demander par exemple : qui est la cible ? quel est la nature de l’objectif poursuivi ? quel résultat sera obtenu pour quel niveau de violence ? etc.
Peut-on trouver une meilleure approche ?
Toutes ces critiques appellent une question : comment peut-on espérer trouver une meilleure réponse au problème de la légitimité du recours à la violence ?
Je pense que la bonne démarche consiste à partir de l’idée selon laquelle tout recours à la violence est en soi problématique et nécessite, en conséquence, une justification particulière. Toute la question est alors de savoir quelles conditions doivent être réunis pour que cette justification existe.
Je n’ai pas la réponse mais je suis persuadé que nous pouvons inventer collectivement des principes d’action sur la base desquels il nous serait possible d’établir si une action violente est acceptable ou non, dans chaque cas où cela est nécessaire.
Il me semble même que c’est ce que nous avons fait jusqu’ici. Le principe de diversité des tactiques auquel Peter Gelderloos se réfère est, à l’origine, issu du mouvement altermondialiste de la fin des années 1990 et du début des années 2000 [8].
Il était alors conçu comme un moyen de permettre à des militant-e-s dont les cultures politiques étaient différentes de lutter ensemble. Les manifestant-e-s se répartissaient entre différentes « zones » (le black block, le pink block, etc.) en fonction du type d’actions qu’ils étaient près à mettre en oeuvre. Certains groupes privilégiaient des manières de lutter très offensives alors que d’autres ne menaient que des actions pacifiques et non-violentes. Mais le plus important était que tous soient solidaires et respectueux des choix des un-e-s et des autres.
Dans ce contexte particulier, je ne doute pas que la diversité des tactiques soit un bon principe. Ce qui me gêne, c’est que l’on en fasse le principe unique sur lequel devrait reposer toute notre éthique du recours à la violence.
On peut, bien-sûr, m’objecter que ces réticences sont un peu théoriques. Aujourd’hui, nous ne posons pas de bombes, nous de commettons pas d’attentats et, plus généralement, nous ne faisons rien qui pose de sérieuses questions morales au nom de l’efficacité. Dès lors, ne pouvons-nous pas nous contenter du principe de diversité des tactiques ?
Cette objection n’est pas complètement infondée. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est assez proche de celui dans lequel le principe de diversité des tactiques a été inventé. En pratique, il est donc certainement suffisant pour nous permettre de lutter ensemble malgré nos divergences.
Malgré tout, je pense qu’il n’est pas inutile que nous nous interrogions sur ses limites et que nous poursuivions nos réflexions sur l’usage de la violence. Je vois deux principales raisons à cela :
1) La situation actuelle n’est pas immuable. Il y a même toutes les raisons de penser que les luttes sociales monteront en intensité dans les années ou décennies qui viennent. Il se peut donc que nous soyons, un jour, confronté-e-s à des situations nouvelles face auxquelles nous ne pourrons plus nous reposer uniquement sur le principe de diversité des tactiques. Si ce jour doit arriver, le fait d’avoir déjà réfléchi au problème nous sera profitable.
2) Beaucoup de partisan-e-s de la non-violence le sont pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’efficacité, mais plutôt avec le souci de respecter un code moral particulier (souvent inspiré par des auteurs comme Tolstoï ou Martin Luther King). Par conséquent, si nous voulons les convaincre qu’elles/ils doivent se montrer plus tolérant-e-s vis-à-vis de modes d’actions alternatifs, nous avons certainement intérêt à explorer le problème du recours à la violence dans toute sa complexité. Leur faire voir que la non-violence est inefficace ne suffira pas. Nous devons leur opposer des arguments plus forts que cela : nous devons essayer de leur montrer que la violence satisfait toutes les conditions qui la rendent moralement justifiée dans un ensemble de cas où elles/ils pensent qu’elle ne l’est pas.
Mais qu’est-ce que la violence ?
Pour finir, j’ai conscience que l’approche alternative que je viens de décrire n’est pas encore parfaitement satisfaisante car elle laisse une question importante en suspens : qu’est-ce qu’une action violente ?
Répondre à cette question n’est pas si évident, comme Peter Gelderloos ne manque pas de le souligner dans le livre :
Lors d’un atelier que j’ai animé sur les défauts de la non-violence, j’ai organisé un petit exercice pour démontrer à quel point la notion de violence est vague. J’ai demandé aux participants, un mélange de personnes soutenant la non-violence et d’autres une diversité de tactiques, de se placer à un endroit si les actions de la liste que je leur lisais leur paraissaient violentes, et à un autre si elles leur semblaient non violentes. Les actions s’étalaient de l’achat de vêtements fabriqués dans un atelier clandestin, un loup qui tue un daim, ou le fait de tuer quelqu’un sur le point de faire sauter une bombe au milieu d’une foule, et ainsi de suite. Il n’y a eu presque aucun consensus ; certaines actions étaient considérées comme violentes par certaines personnes et non violentes par d’autres [9].
Il estime d’ailleurs que c’est une raison de plus pour ne pas accorder trop d’importance à la question la violence dans le cadre de la poursuite de nos luttes :
Est-il sensé de fonder l’essentiel de notre stratégie, de nos alliances et de notre engagement autour d’un concept tellement flou qu’on ne peut trouver deux personnes pour s’accorder sur ce qu’il signifie ? [10]
Toutefois, cette idée ne me paraît pas très convaincante. Tout ce que montre l’exercice auquel Peter Gelderloos fait référence, c’est qu’il y a plusieurs manières d’interpréter la notion de violence [11]. Mais ce constat vaut également pour bien d’autres notions sur lesquelles nous nous basons pour déterminer notre engagement, nos stratégies et nos alliances : l’anarchisme, le capitalisme, l’égalité, la justice, l’autorité ou même tout simplement la gauche et la droite. Faut-il conclure que nous avons tort de nous référer à ces notions ? Évidemment non.
Voici une proposition alternative qui me paraît plus raisonnable : la question de la violence est importante pour la définition de nos stratégies, de nos alliances et de nos engagements. Aussi, nous devons discuter des conditions dans lesquelles son usage est justifié. Ceci indiqué, lorsque nous voulons prendre position ou avoir une discussion sur ce sujet, il nous appartient de préciser ce que nous entendons par « violence ». Nous ne pouvons pas nous contenter de brandir ce terme de façon abstraite sans dire ce qu’il signifie pour nous. L’objet d’une discussion sur l’usage la violence est de déterminer quelles actions, précisément, sont légitimes et quelles actions ne le sont pas. Une telle discussion ne peut donc être fructueuse que si les participant-e-s ont, peu ou prou, la même chose en tête au moment où elles/ils échangent.
Bien-sûr, cela s’applique aussi à moi, qui suis en train d’écrire sur ce sujet. Voici donc ce que je peux dire : habituellement, lorsque je parle de violence dans le cadre d’une discussion sur l’action militante, j’ai essentiellement à l’esprit des actions destinées à blesser physiquement d’autres personnes. Toutefois, lorsque j’ai rédigé cet article, j’en ai retenu une conception un peu plus large. Je voulais que l’approche que j’y propose soit valable également pour d’autres types d’actions qu’on qualifie parfois de violentes comme le sabotage, la casse et, plus généralement, tous les actes qui ont pour but de créer des dégâts matériels. Ceci précisé, je n’irais pas jusqu’à dire que des paroles un peu véhémentes ou des pancartes affichant des messages offensants sont des actes violents, au sens où je l’entends ici. S’il fallait les considérer comme tels, alors je ne pense pas que les conclusions de cet article leurs seraient applicables.
Conclusion : ce qu’apporte le livre
Pour finir, je voudrais faire un point sur ce qu’apporte le livre. J’ai essayé de montrer que la thèse qu’il défend est incomplète, mais je ne veux pas lui retirer ses nombreux mérites.
Le livre montre - à celles et ceux qui veulent bien l’entendre - que la position de la non-violence ne tient pas, ce qui est déjà beaucoup. Qui plus est, il attire notre attention sur une question importante qui n’était plus guère discutée : celle de la légitimité du recours à la violence.
C’est à nous, maintenant, de poursuivre la réflexion.