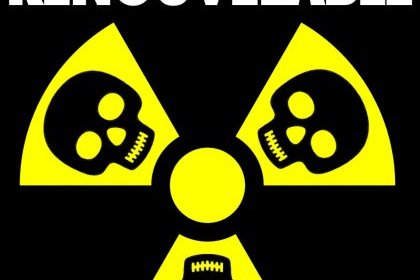En septembre 2019, Greta Thunberg concluait ainsi son allocution au siège des Nations unies à New York : « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux ! Des gens souffrent, des gens meurent ! (…) Les jeunes commencent à voir votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. Et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis : nous ne vous pardonnerons jamais ! (…) Le changement arrive, que vous le vouliez ou non. »
Une allocution au ton alarmiste qui, à défaut d’avoir ému les dirigeants du monde (surtout ceux des pays du Nord, enfermés dans leurs forteresses de certitudes) est d’ores et déjà entrée dans l’histoire comme l’illustration indéniable de la nécessité, pour nous, de passer à l’étape supérieure.
Parce que les dirigeants et les structures qu’ils dirigent, comme nous allons voir, ne peuvent être voués qu’à être des obstacles au progrès, et le rôle historique d’agent salvateur dans la crise climatique (catégorie construite par analogie à celle d’agent révolutionnaire dans la lutte des classes) se situe en réalité en dehors de ces structures de pouvoir, loin des dorures des institutions bourgeoises ou de la lumière des projecteurs de plateaux de télévision. Cet agent salvateur, c’est nous. Cet agent salvateur a déjà commencé à se mettre en mouvement, le mouvement écologiste, mais il lui incombe d’adopter la vision la plus claire qui soit sur les moyens de mener son combat à l’enjeu sans précédent. La manière la plus appropriée qui soit à mon sens pour entamer cette réflexion est de se tourner vers l’actualité politique la plus récente, vers la bataille de Sainte-Soline.
Ainsi, je vais donc structurer l’exposition de mes réflexions en quatre parties : tout d’abord, je me livrerai à une description de la bataille de Sainte-Soline et penserai stratégiquement ce que représente cet événement politique ; ensuite, je traiterai de la violence politique en interrogeant la nécessité, la possibilité de son emploi dans notre combat ; puis, je me tournerai vers le passé afin de révéler les enseignements de la lutte menée par nos aînés, de leur manière de penser leur combat pour la cause de l’émancipation ; enfin, je m’interrogerai sur la praticité, la crédibilité d’un projet de construction d’une vaste organisation de résistance, m’apparaissant hautement nécessaire pour planifier un usage de la violence politique dont nous aurions besoin.
Que s’est-il passé à Sainte-Soline ?
Il y a quelques jours, le 29 et 30 octobre 2022, nous avons assisté à des affrontements dans les Deux-Sèvres, dans la commune de Sainte-Soline. Une bataille à travers champs opposait les forces de répression à des militants écologistes s’élevant contre un projet de mégabassines, une nouvelle technologie écocide utilisée à des fins de privatisation de la ressource naturelle suprême : l’eau.
Forts de leur nombre et de leur détermination, ils étaient entre cinq et sept mille et venus de tous horizons, les militants sont parvenus, au terme d’un long jeu du chat et de la souris, à pénétrer dans le site et, dès le lendemain, à le saccager.
S’en est aussitôt suivi, comme il fallait s’y attendre, le déploiement d’une vaste opération de diffamation menée par le système politico-médiatique avec pour seul but d’invisibiliser les enjeux politiques de la bataille en détournant l’attention du public sur les méthodes employées par les plus offensifs et radicaux des militants. C’est ainsi, à la suite du vacarme idéologique alimenté par des hordes éditocrates, qu’est apparu, dans la bouche de l’abject ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, la catégorie d’« écoterrorisme ». Bien sûr, en vertu de la fonction qu’occupe ce faquin et du parcours qui est le sien, mais aussi des claires convergences d’intérêts comme de propriété unissant médias dominants et sphères financières, il ne fallait pas vraiment s’attendre à autre chose qu’un déversement d’ignominies rhétoriques de la sorte de la part du gouvernement des riches ou de la presse du capital, comme à chaque mouvement conséquent effectué par la classe ou la contre-hégémonie.
Voici donc pour le topo. C’est ce que nous retiendrons de cet événement politique, pour le moment du moins (le collectif Bassines non merci a d’ores et déjà annoncé que si le chantier de mégabassines reprenait, il appellerait, avec les Soulèvements de la Terre, à d’autres mobilisations).
Bien évidemment, ce n’est pas ce qui m’a amené à prendre la plume aujourd’hui et à m’adresser à vous en ces termes. Car Aristote avançant que la philosophie commence avec l’étonnement, j’ai été particulièrement frappé par ce que je considère non seulement comme l’événement politique le plus éloquent du temps post-Covid (avec le mouvement actuel de grèves nationales entamé en cette rentrée sociale), mais aussi et surtout comme l’acte de naissance de ce qui a vocation, je l’espère, à croître en quantité comme en qualité et à représenter le nouveau spectre qui s’élèvera pour consumer le vieux monde des flammes ardentes de sa colère. Je m’explique. Pour quelles raisons ce qui s’est passé à Sainte-Soline est singulier et représentera un précédent pour la gauche selon moi ? Quelles conclusions stratégiques notre camp doit-il tirer de ce fait politique ?
Premièrement, parce qu’il s’agit de la première fois qu’est réellement organisée et appliquée une vraie diversité de tactique sur un théâtre d’opération identifié. Deuxièmement, parce qu’il s’agit de la première fois que le sabotage, c’est-à-dire l’atteinte ciblée à la propriété privée et sa destruction stratégique, se révèle au grand jour comme un moyen d’action non seulement hautement légitime mais terriblement efficace. Troisièmement, parce que c’est la première fois que les appareils répressifs et idéologiques d’État franchissent de telles limites dans leur réaction au mouvement et à la cause écologiste (dans l’histoire récente, seuls les Gilets jaunes sur la question sociale en avaient été capables).
La gauche (définie comme contre-hégémonie, processus dynamique d’opposition progressiste à l’hégémonie en vigueur, au bloc historique actuel, aux moyens de production et de reproduction du système capitaliste néolibéral) opérant un tournant majeur en exposant aux yeux de tous, par l’événement politique que représente cette démonstration de force, sa cohésion politique (diversité de tactiques organisée), son efficacité tactique (mise en défaite des forces ennemies et prise de l’objectif, aussi ardue soit l’opération) ainsi que sa capacité de déstabilisation de l’ordre établi (ce dernier étant forcé de recourir, dans la parole comme dans le geste, à l’usage d’armes inédites).
Légitime et nécessaire, elle l’était depuis un certain temps, envisageable et possible, l’opposition violente (voire même armée) à large échelle à l’État bourgeois et au capital le devient de plus en plus, et la bataille de Sainte-Soline est ce que j’identifie comme la démonstration de force d’un secteur de la gauche de la gauche de la gauche qu’il nous tarde de structurer.
En effet, « Méditations écoterroristes », le titre en indiquait la couleur. Car si l’objet de mon propos se tourne vers les moyens utilisés par le mouvement dans sa lutte, le fond de mon propos est bien de méditer la question de la violence politique, de la violence en politique, de l’usage de la violence à des fins politiques, qui se pose, je crois, plus que jamais à notre camp alors que nous avons démontré notre capacité d’action et tandis que la crise climatique s’aggrave de jour en jour. Dans les lignes qui vont suivre, je m’astreindrai donc à poursuivre cette piste de réflexion et à tenter de trouver des réponses, sans avoir peur de poser la question de la nécessité, de la possibilité, pour nous, de l’usage planifié de la violence politique, de la lutte armée.
Quid de la violence politique ?
L’autre jour, j’interrogeais un libraire. Du haut de son grand âge, il me répondait que la violence en politique (distincte par son caractère révolutionnaire de la violence légale émise par l’État ; révolutionnaire en le sens qu’elle s’oppose frontalement à une société, aux institutions de sa reproduction, dans le but de lui substituer une autre société et d’autres institutions plus justes) ne trouve sa justification que lorsque les moyens légaux ont été préalablement épuisés. C’était déjà la réponse donnée par Herbert Marcuse en 1979, même s’il me semble que cette réponse puisse être aisément admise par le sens commun, compréhensible par tout un chacun.
Mais dans la mesure où les gouvernements, qui sont ici les institutions censées légiférer pour empêcher la catastrophe, sont en fait composés par et sont soumis à la bourgeoisie, sont faits par et pour cette classe dominante dont la responsabilité dans la crise est largement documentée, comment la lutte dans le cadre de la légalité (dans et avec les institutions établies) ou de la non-violence (dans le respect et l’obéissance aux institutions établies) pourrait constituer l’horizon indépassable de nos modes d’actions ? De plus, il faut considérer l’enjeu spécifique qui est celui de la cause écologiste, de la responsabilité particulière du mouvement écologiste, c’est-à-dire non seulement de se battre pour l’émancipation, l’amélioration de la condition des dominés (comme ont pu le faire les incarnations précédentes de la gauche dans l’histoire) mais de préserver les conditions d’habitabilité de la planète et, donc, de perpétuation de notre propre espèce. En somme, face à l’impasse de la légalité en vigueur et l’importance de l’enjeu qui s’impose à nous, il me paraît par conséquent très difficile de ne penser la situation historico-politique autrement qu’en les termes suivants : c’est la révolution ou l’extinction. La victoire ou la mort. Littéralement.
La révolution ? Bien sûr, l’évaporation de la perspective immédiate, voire lointaine, d’émergence d’une situation prérévolutionnaire puis de l’éventuel éclatement d’une révolution prolétarienne dans les sociétés capitalistes avancées (en France, je pense, au moins depuis l’échec de Mai 68) est hautement considérable et a à être profondément méditée. Non moins nécessaire, la révolution appartient désormais, je crois, au passé. Toutefois, même si la perspective de renversement de l’État bourgeois s’éloigne au fur et à mesure que se perfectionnent ses appareils répressifs et idéologiques (jamais policiers et militaires n’ont disposé d’armes aussi sophistiquées ; jamais les masses n’ont été aussi détournées de leurs propres intérêts par, disons, les barreaux dorés de la société d’abondance, de consommation), il faut demeurer lucide sur la capacité de nuisance que pourrait avoir l’apparition, la structuration et la mise en action à large échelle d’un flanc radical, d’une fraction non seulement subversive mais offensive au sein de la contre-hégémonie.
Tournons-nous vers le passé.
Comme le demande le géographe suédois et militant écologiste Andreas Malm dans Comment saboter un pipeline (2020), ma principale source d’inspiration pour la rédaction de ce présent article, comment peut-on imaginer le mouvement des droits civiques arracher la loi de 1964 sans son flanc radical le faisant apparaître comme un moindre mal aux yeux du pouvoir d’État ? Andreas Malm écrivait : « Ce flanc était associé à la violence noire, éternel cauchemar de la psyché américaine blanche. (…) Au cours des années 1950 et 1960, [alors que des émeutes urbaines en série causaient d’innombrables pertes financières] le curseur de la modération [la fenêtre d’Overton] s’est déplacé rapidement, les radicaux d’autrefois — les leaders des droits civiques qui poussaient à enfreindre la loi — finissant par apparaître raisonnables et mesurés. Auprès de la menace de révolution noire — le Black Power, le Black Panther Party, les mouvements de guérilla noirs — l’intégration semblait un prix à payer tolérable. Sans Malcolm X, il n’y aurait peut-être pas eu de Martin Luther King (et inversement). »
Dépassant l’exemple du mouvement pour les droits civiques, Malm poursuivait : « La théorie de l’influence du flanc radical vaut bien au-delà de la lutte des Africains-Américains. L’histoire de la politique ouvrière dans l’Europe occidentale du XXe siècle pourrait être écrite sous ce jour. Le droit de vote, la journée de travail de huit heures, les rudiments de l’État social, les progrès du mouvement ouvrier réformistes auraient été inconcevables sans son flanc gauche (et oriental). »
En quelques sortes, dans les coordonnées historico-politiques du mouvement actuel de grèves nationales pour la hausse des salaires, l’intersyndicale et ses revendications réformistes auraient peut-être plus à valoir qu’il n’y parait au black bloc, ses slogans et modes d’action radicaux. Dans les coordonnées de la lutte écologiste, la Nouvelle union écologique et sociale aurait en fait plus à valoir qu’il n’y paraît aux actions d’une Fraction armée verte et aux conséquences de flambées d’émeutes urbaines.
Ensuite, Malm se tournait vers l’exemple remarquable de l’Afrique du Sud : « Il a fallu un peu plus que le désinvestissement pour faire tomber l’apartheid. Un peu plus que la désobéissance civile aussi : dans les années 1950 et 1960, le Congrès national africain (African National Congress, ANC) avait essayé les boycotts de bus, les grèves, les destructions publiques de passeports intérieurs, les campagnes contre la ségrégation dans les trains et les bureaux de poste pour découvrir qu’elles n’aboutiraient qu’à une répression terrassante. Après le massacre de Sharpeville, les dirigeants de l’ANC ont compris qu’ils devaient faire monter la pression et ils ont formé Umkhonte we Sizwe, le "Fer de lance de la nation" (ou MK). C’est Nelson Mandela qui a poussé à cette réorientation : "Notre politique visant à créer un État non racial par la non-violence n’a[yant] abouti à rien", "nous avions à reconsidérer notre tactique. À mon avis, nous achevons un chapitre sur cette question de la politique de non-violence", a-t-il soutenu lors d’une série de réunions secrètes en 1960 et 1961, comme il l’a rapporté par la suite dans son autobiographie. Ayant rallié ses camarades à la nouvelle ligne, Mandela a été nommé premier commandant de MK. »
De nos jours, dans la situation historico-politique de la lutte écologiste mais aussi plus largement alors que les luttes sociales peinent depuis plusieurs décennies à déboucher sur des réelles avancées, je pense qu’il n’est pas déraisonnable de dire que nous avons essayé tout ce qu’il était possible d’essayer. De plus, je pense qu’il n’est pas déraisonnable non plus, face à la multiplication des jets de peinture, de sauce tomate et autres sur des œuvres d’art au nom de la cause, d’affirmer qu’il devient de plus en plus difficile d’imaginer ce qu’imagineront les dogmatiques de la non-violence pour s’auto-persuader de l’efficacité stratégique de leurs modes d’actions et s’empêcher de voir l’évidence. (Bien sûr, aussi froid et peu fétichisé doit être le rapport de la politique à l’art et honorable soit le geste de sacrifice effectué par ces militants écologistes.)
Dans Un long chemin vers la liberté (1994), Mandela écrivait : « Notre stratégie consistant à faire des raids sélectifs contre des installations militaires, des centrales électriques, des lignes téléphoniques, et des moyens de transport ; des cibles, qui non seulement entraveraient l’efficacité militaire de l’État, mais qui en plus effraieraient les partisans du Parti national [la droite, favorable à la conservation de l’apartheid] feraient fuir les capitaux étrangers et affaibliraient l’économie. Nous espérerions amener le gouvernement à la table des négociations. On donna des instructions strictes aux membres de MK : nous n’acceptions aucune perte de vies humaines. Mais si le sabotage ne produisait pas les effets escomptés, nous étions prêts à passer à l’étape suivante : la guerre de guérilla et le terrorisme. »
Ainsi, face à l’absence de résultats de l’action non-violente, par ces mots, Mandela décrivait le passage de son mouvement de la protestation à la résistance, c’est-à-dire d’un mode plaintif à un mode offensif d’action et donc au sabotage. Ce que les politistes Mohammad Ali Kadivar et Neil Ketchley dans leur article « Sticks, Stones and Molotov Cocktails : Unarmed Collective Violence and Democratization » (2018) appellent la violence collective non armée : la violence politique pratiquée par des civils usant d’armes improvisées, le plus souvent à la main. En somme, Mandela planifie le sabotage et n’envisage la guérilla qu’en dernier recours (même si, conceptuellement, une campagne de sabotage massive menée par le MK et dont nous aurions, à mon sens, besoin aujourd’hui dans nos combats écologiques et sociaux, est seulement distincte d’une guerre de guérilla par son caractère non-meurtrier).
J’aimerais beaucoup que ce même genre de conclusions, ici et maintenant, soit tiré à plus large échelle qu’au sein de la seule gauche de la gauche de la gauche. Et ceci avant qu’il ne soit trop tard, non seulement parce que les dirigeants et les institutions bourgeoisies n’auront rien fait ou, plus exactement, auront tout fait pour conserver le statu quo, mais peut-être aussi et surtout parce que des foules de militants ne se seront pas battus, ou, plus exactement, croyaient ou se disaient à eux-mêmes qu’ils se battaient. Il est urgent d’avoir ce genre de discussion, de poser la question en ces termes et d’envisager la nécessité, la possibilité, de notre passage à l’étape supérieure et, je l’espère, la reproduction du geste effectué avec bravoure par nos aînés.
Comme l’affirmait la regrettée Ulrike Meinhof en 1968 : « Protester, c’est dire que je n’aime pas ça. Résister, c’est faire cesser ce que je n’aime pas. Protester, c’est dire que je refuse de continuer à ça. Résister, c’est m’assurer que tous les autres cessent d’y participer aussi. »
Quelle praticité pour une Fraction armée verte ?
Dans la lutte, les paroles ne coûtent rien, seules les actions comptent. Alors, comment incarner dans la pratique ce que j’appelle de mes vœux pour la contre-hégémonie ? Dans l’époque contemporaine et l’histoire récente de la gauche, le black bloc s’est imposé comme la principale incarnation de l’usage de la violence politique (du moins dans les pays du Nord, car certaines guérillas demeurent actives dans le Sud global mais sont désormais, pour la plupart, que l’ombre de ce qu’elles ont été). Cependant, ma conviction est que le black bloc, qu’il soit agissant en milieu urbain (comme lors de presque toutes les grandes manifestations parisiennes depuis plusieurs années) ou rural (comme lors de manifestations d’opposition à des grands projets à la campagne, à Sainte-Soline contre les mégabassines par exemple) est un mode d’action très efficace, mais non moins limité. En effet, s’il s’agit pour nous à plus ou moins court terme de mener des opérations de sabotage à large échelle, il me semble difficile d’envisager leur structuration autrement qu’autour ou par un groupe autonome clandestin organisé de manière paramilitaire, sorte de nouvelle Action directe plus grande et moins meurtrière. Parce que le black bloc c’est bien, mais le MK, le Black Panther Party ou même la Résistance (car au vu de l’enjeu climatique exposé plus haut, la comparaison me paraît hautement appropriée), en termes organisationnels, sont peut-être préférables.
Voici ce qu’écrivait Auguste Blanqui dans Instructions pour une prise d’armes (1868), dans une perspective révolutionnaire de réflexion des conditions de victoire d’une insurrection dans sa tentative de renversement de l’État bourgeois certes (qui n’est, selon moi, plus d’actualité pour le moment, comme je l’ai expliqué plus haut), mais qui n’en reste pas moins pertinent pour saisir le clivage tactique police/black bloc comme un clivage non seulement politique répression/opposition mais aussi organisationnel logos/pathos : « L’armée n’a sur le peuple que deux grands avantages, le fusil Chassepot et l’organisation. Ce dernier est immense, irrésistible. Heureusement on peut le lui ôter, et dans ce cas, l’ascendant passe du côté de l’insurrection. Dans les luttes civiles, les soldats, sauf de rares exceptions, ne marchent qu’avec répugnance, par contrainte ou par eau-de-vie. Ils voudraient bien être ailleurs et regardent plus volontiers derrière que devant eux. Mais une main de fer les retient esclaves et victimes d’une discipline impitoyable ; sans affection pour le pouvoir, ils n’obéissent qu’à la crainte et sont incapables de la moindre initiative. »
Ensuite, Blanqui se lançait dans un éloge des insurgés : « (…) Dans les rangs populaires, rien de semblable. Là on se bat pour une idée. Là on ne trouve que des volontaires, et leur mobile est l’enthousiasme, non la peur. Supérieurs à l’adversaire par le dévouement, ils le sont bien plus encore par l’intelligence. Ils l’emportent sur lui dans l’ordre moral et même physique, par la conviction, la vigueur, la fertilité des ressources, la vivacité de corps et d’esprit, ils ont la tête et le cœur. Nulle troupe au monde n’égale ces hommes d’élite. »
Enfin, il concluait en les termes suivants : « Que leur manque-t-il pour vaincre ? Il leur manque l’unité et l’ensemble qui fécondent, en les faisant concourir au même but, toutes ces qualités que l’isolement frappe d’impuissance. Il leur manque l’organisation. Sans elle, aucune chance. L’organisation, c’est la victoire ; l’éparpillement, c’est la mort. »
À défaut d’avoir constaté la formation et la mise en action à large échelle de ce genre d’organisation dans l’époque contemporaine (à la gauche de la gauche, la chute du Mur et, donc, la regrettable destitution du marxisme-léninisme dans les pays du Nord comme doctrine hégémonique dans la contre-hégémonie, aura sûrement eu comme conséquence la génération d’un vaste affect de méfiance dans notre camp à l’égard des grandes doctrines et surtout des grandes organisations, ceux toujours désireux de s’investir dans l’épreuve de force avec l’État bourgeois n’en exceptant pas, ce qui a provoqué la naissance et le développement du black bloc — mode d’action offensif spontané par excellence — au début des années 1980 puis dans le courant des années 2000, période durant laquelle la gauche des pays du Nord était comme orpheline, se cherchait elle-même et avait à se réinventer), on aura pu en voir une remarquable ébauche dans la littérature. En effet, dans La Zone du Dehors (1999), le romancier de science-fiction Alain Damasio dépeignait les péripéties de protagonistes engagés dans la « Volte », une sorte de rébellion animée par une sensibilité anarchiste et aux membres luttant tant bien que mal pour renverser l’ordre établi dans une société de contrôle à son paroxysme en l’an 2084, les technologies de surveillance et de répression devenues omniprésentes.
Cela dit, je pense qu’il existe une contradiction entre la clandestinité et l’horizontalité dans la résistance. Cette contradiction réside à mon sens dans l’inégalité d’influence que possèdent les membres vis-à-vis de leur ancienneté dans l’organisation, de leur proximité avec le ou les individus à l’initiative de la création de l’organisation, et de leur place dans ce qu’il faut bien appeler la chaîne de commandement indispensable à toute organisation de ce type, en tant que les informations sensibles ne pouvant être en permanence transmises à tous les membres de l’organisation. Par ailleurs, les personnages principaux du roman ne constituant en fait rien d’autre, dans l’organisation, que le « Bosquet », une sorte de cercle restreint dont les membres sont les proches amis du défunt fondateur de l’organisation et qui décide des gestes effectués par l’organisation (la planification de chaque opération, notamment — même si les membres de la Volte se réunissent dès que possible en des assemblées générales pour débattre des grandes orientations prise par l’organisation). Me considérant personnellement comme appartenant au courant de pensée et à la tradition marxiste, je ne suis pas véritablement opposé à ce genre de dispositions en ce que je les identifie comme nécessaires au bon fonctionnement d’une organisation de ce type, dont nous avons besoin. Toutefois, conscient de la situation politique de mes potentiels interlocuteurs dans la « mouvance anarcho-autonome » qui se compose majoritairement d’individus de sensibilité anarchiste sceptique à l’égard de toute hiérarchie voire organisation, comme d’activistes dont les habitus militants se sont principalement formés dans le cadre du black bloc ou des mobilisations pro-ZAD et sont donc accoutumés à leur spontanéité, leur décentralisation, et il m’est impossible de ne pas anticiper les discordes organisationnelles à venir et la difficulté de la réalisation de mes vœux, même si je demeure, au fond, bien sûr, optimiste sur nos capacités de prise de maturité politique et d’apprentissage de la praxis par la praxis.
(N.B. : Pour autant, il ne s’agit pas pour moi, comme pour Blanqui ou Meinhof, d’organiser de manière unilatéralement hiérarchique, totalement verticale, cette potentielle organisation et d’avoir ainsi l’ambition de strictement copier-coller le fonctionnement de l’Armée française dans nos luttes ou de refonder l’Armée rouge en Europe de l’Ouest. En effet, pour prendre un exemple autre que littéraire et davantage concret (même si les conditions objectives de la classe et de la contre-hégémonie dans l’État mexicain du Chiapas sont bien sûr radicalement différentes de celles des sociétés capitalistes avancées, des pays du Nord comme la France), l’Armée zapatiste de libération nationale m’apparaît comme un modèle organisationnel hautement pertinent, ses membres étant agis par la doctrine zapatiste, d’inspiration anarchiste et altermondialiste, et se subjectivant comme tels, tout en incarnant leur pratique politique d’une manière proche des guérillas marxistes-léninistes sud-américaines du siècle précédent. Parce qu’au sein de l’EZLN, une chaîne de commandement existe et est reconnue comme telle, cependant, les chefs y sont conçus comme les serviteurs politiques de leurs subalternes militaires, d’où le fameux grade de « sous-commandant » et le slogan de l’autonomie zapatiste : « Le peuple commande et le gouvernement obéit. »).
Arrivé ici, il ne me reste plus qu’à présenter mes excuses, ne pouvant traiter davantage le sujet qui a occupé ce présent texte sans lui faire dépasser une longueur excédant de trop loin la taille standard d’un article. Je voudrais donc insister sur le fait que, aussi sensible soit le sujet de ce texte, je suis est amplement conscient de l’existence de la multitude d’objections considérables à la thèse que j’ai formulée et défendue ici et qu’elle serait susceptible de susciter des conversations passionnantes mais non moins nécessaires au sein de la contre-hégémonie. Enfin, à défaut de pouvoir évoquer ces objections et de détailler mes réponses à celle-ci, la meilleure chose que je puisse faire est de citer mes sources d’inspiration pour la rédaction de cet article. Les voici : Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm, Instructions pour une prise d’armes d’Auguste Blanqui, mais aussi Comment la non-violence protège l’État ? (2005) de Peter Gelderloos, Sortir de notre impuissance politique (2020) de Geoffroy de Lagasnerie et La violence oui ou non : une discussion nécessaire (1987) de Günther Anders.
Côme Supervielle.