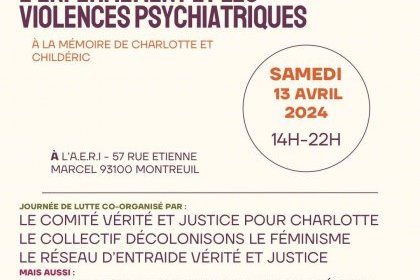Cet entretien, et celui avec Maeva, addictologue, ont été réalisés le 26 mars 2020 (à l’époque le département du 93 n’était pas encore aussi touché qu’aujourd’hui par l’épidémie) et d’abord diffusés sur Radio Canut.
« Le risque, c’est que certains patient·e·s attendent le dernier moment avant de se présenter aux urgences dans un état avancé »
On vit une crise sanitaire qui est totalement inédite. On a des épidémies de grippe saisonnière, avec des afflux de patient·e·s dans les hôpitaux, mais évidemment, ça n’a rien de comparable à ce que l’on vit là. Aujourd’hui, la grande majorité du fonctionnement de tous les hôpitaux en région parisienne tourne autour de la prise en charge des patient·e·s infectés par le coronavirus. Il y a vraiment une portion marginale laissée pour s’occuper des autres urgences parce qu’il y en a toujours : des crises d’asthme, des infarctus, mais c’est très marginal. Le risque, c’est que certains patient·e·s qui ont des maladies chroniques et qui peuvent présenter des épisodes d’accélération, d’exacerbation, attendent le dernier moment avant de se présenter aux urgences dans un état avancé. C’est assez imprévisible.
« Les épidémies saisonnières de grippe mettent déjà l’hôpital en tension »
Quel que soit le système de soins de base, on aurait pris cette vague de plein fouet. Néanmoins, on paie des années de gestion catastrophique de l’hôpital. Dans les six dernières années, il y a eu 14 500 lits d’hospitalisation qui ont été fermés à l’hôpital public.
La gestion de l’hôpital est devenue un hôpital-entreprise avec des considérations qui sont essentiellement financières et non plus centrées sur l’humain et la qualité du soin. Ça diminue d’autant plus les possibilités d’absorber ce genre d’événements, quand bien même il est d’une telle ampleur et il est inédit. Chaque année, il y a des épidémies de grippe saisonnière. Alors que c’est quelque chose qui revient cycliquement et qui est prévisible, ça met les hôpitaux en tension. Le niveau de tension est incomparable, mais c’est quand même quelque chose qui désorganise temporairement le nombre de passages aux urgences et donc les possibilités de trouver des lits en aval pour les urgentistes.
Il est devenu intolérable pour les décisionnaires qu’il y ait des lits vides, des lits qui puissent absorber un afflux de patient·e·s imprévu, qu’il y ait des machines qui soient là sans servir. On doit toujours être à flux tendu, on doit toujours faire avec quatre personnes ce qu’on faisait avant avec cinq. On nous met une pression infernale pour à chaque fois réduire la durée de séjour, faire de la médecine ambulatoire… sauf que c’est en contradiction avec la démographie française. Il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a des besoins de soins sur des malades complexes, ce qu’on appelle des polypathologies, comme c’est souvent le cas chez les sujets âgés : des gens qu’on ne peut pas opérer un jour et renvoyer chez eux le lendemain. Ce sont des patient·e·s qui demandent du temps, qui ont besoin d’éducation thérapeutique parce qu’elles et ils sont porteur·euse·s de maladies chroniques.

Prendre ce temps, c’est quelque chose qui est très mal valorisé dans la tarification à l’acte (la TAA). Depuis la loi Bachelot, on est soumis·e·s à une tarification à l’acte avec une enveloppe globale fixée d’avance. C’est un système forcément inflationniste : si l’activité augmente, chaque acte est progressivement dévalorisé et pour continuer à recevoir la même dotation, il faut faire toujours plus, plus, plus d’activité. C’est un modèle qui ne peut pas tenir sur le long terme. Quand on est au pic épidémique de la grippe, le fonctionnement du SAMU, des urgences, est extrêmement compliqué.
Cette pandémie, aucun système de soins dans le monde n’aurait eu assez de marge pour la supporter sans difficulté. L’idée n’est pas de dire qu’il faut s’équiper en matériel, en personnel, et en capacité de coucher les malades pour absorber des événements imprévisibles et d’une telle ampleur. Néanmoins, ça agit comme un révélateur de l’état dans lequel est notre système de santé. Parce que si on avait quand même un peu plus de marge, on serait dans une difficulté moins grande, la saturation des hôpitaux serait arrivée moins vite, évidemment.
Il y a d’autres pays, en Allemagne, par exemple, où si on fait un ratio nombre de lits de réanimation sur population, ils et elles sont beaucoup mieux loti·e·s que nous. Ce sont des choix politiques, et donc économiques, qui ont été faits en amont [1].
« Ce qui fait défaut pour armer de nouveaux lits de réanimation, c’est le personnel »
Ce qui fait défaut pour armer de nouveaux lits de réanimation, ce n’est pas tant de trouver du matériel et des respirateurs. Il y a eu des commandes faites un peu en amont et il y a des solutions d’urgence comme réquisitionner les respirateurs des écoles et des cliniques vétérinaires, adaptables pour la médecine humaine. C’est vraiment un problème de personnel. Il faudrait trouver des infirmiers et des infirmières aptes à exercer en réanimation. Que ce soit à l’hôpital public ou dans les structures privées qui disposent de lits de réanimation, on essaie par tous les moyens de recruter des infirmiers et des infirmières en urgence, mais on n’en trouve pas, ou pas assez. Là encore, si on partait d’une situation de base avec des équipes plus fournies qui ne soient pas déjà essorées, on aurait évidemment plus de marge de manœuvre.
Une des principales difficultés pour recruter dans l’hôpital public, c’est la rémunération très peu attractive du personnel non médical : infirmiers, infirmières, aide-soignant·e·s. Le salaire des infirmiers et infirmières arrive en vingt-sixième position parmi les pays de l’OCDE [2]. Ils et elles sont vraiment très mal payé·e·s par rapport au service rendu. Comme c’est aussi le cas de beaucoup de Français et de Françaises.
On comprime de plus en plus les équipes, on leur demande de faire de l’efficience, toujours plus d’efficience. Ce qui veut dire travailler dans des conditions de plus en plus désagréables, supprimer les pauses, déborder sur le temps de travail sans jamais récupérer. Si vous passez de 8 patient·e·s dont vous avez la charge à 11 puis 15, vous faites les choses de plus en plus vite, donc vous avez moins de temps pour vous poser avec les patient·e·s, pour discuter de leur maladie, pour essayer de calmer leur angoisse pour les soulager.
Dans une journée normale, si deux patient·e·s décompensent en même temps, ça désorganise la journée de travail du personnel. Si les effectifs ne sont pas calculés au plus juste, les autres peuvent compenser. Mais si les autres sont déjà eux-mêmes ou elles-mêmes dans un planning tendu, la journée déborde : les transmissions sont faites après et ce sont des heures supplémentaires qui ne sont jamais récupérées.

Les conditions de travail se dégradent pour un salaire qui n’est pas mirobolant. Donc les jeunes infirmiers et infirmières font quelques années à l’hôpital public, parce que c’est formateur, parce que c’est un endroit où ils et elles trouvent du travail au sortir de l’école de formation en soins infirmiers. Et après, ils et elles vont soit travailler dans des structures privées, soit faire du libéral, soit faire autre chose. Finalement, de moins en moins d’infirmiers et d’infirmières font et terminent leur carrière à l’hôpital public.
J’ai travaillé dans un service de pneumologie où j’ai d’abord été étudiant en médecine, puis interne, puis médecin titulaire. Il y avait au début de ma carrière des infirmières qui avaient travaillé 20 ou 30 ans en pneumologie. Elles avaient des compétences propres à leur lieu d’exercice, qui n’étaient pas forcément reconnues. Quand on a fait 20 ou 30 ans en pneumologie, quand on a fait 20 ou 30 ans dans un service de chirurgie orthopédique, etc., on développe des compétences spécifiques. Maintenant, l’idée, c’est qu’elles soient polyvalentes.
Comme les équipes sont de plus en plus comprimées et les conditions de travail de plus en plus difficiles, il y a des arrêts de travail. Au bout d’un moment, comme il n’y a plus de marge puisque les effectifs sont calculés au plus juste, s’il y a des arrêts de travail, c’est vraiment problématique. On doit donc avoir un pool d’infirmières polyvalentes mobilisé d’un service à un autre. Aujourd’hui, dans le service de pneumologie, les infirmières restent deux ou trois ans, et puis elles partent, parce qu’il y a beaucoup de travail, probablement trop, dans des conditions perpétuellement dégradées, pour un salaire qui est sous-évalué.
« Vous êtes des héro·ïne·s » alors que ça fait plus d’un an que plein de services sont en grèves partout en France, qu’on a annoncé ce genre de risques »
On n’est pas des héro·ïne·s. C’est notre métier, pratiqué dans des circonstances exceptionnelles et vraiment inattendues, mais, malgré tout, ça reste notre métier. Et on le fait, je ne dirais pas avec plaisir, parce que ce n’est pas un plaisir d’accueillir des gens malades et parce que les journées sont difficiles, de plus en plus difficiles. Il y a plein de gens qui sont dans des états sévères. Aujourd’hui dans mon service, on en a transféré trois en réanimation, c’est comme ça tous les jours. Ce n’est pas un plaisir, ce ne sont pas des conditions de travail où on a le temps de faire du soin personnalisé. Vraiment, là, on essaie de parer au plus urgent.
« Vous êtes des héro·ïne·s » alors que ça fait plus d’un an que plein de services sont en grève partout en France, qu’on a annoncé ce genre de risques. On n’avait pas annoncé une pandémie, mais depuis un an les revendications des différents collectifs interurgences, des collectifs inters-hôpitaux et des syndicats portent sur des conditions qui se dégradent depuis de nombreuses années. C’est aussi la faute des précédents gouvernements : ils ont tous été sur la même ligne. La loi Bachelot avec l’instauration de la TAA, ça été une accélération. Mais, même avant ça, le virage avait été enclenché puisqu’il y avait eu déjà énormément de fermetures de lits. On faisait du soin de moins bonne qualité, de qualité insuffisante par rapport à ce qui devait être. Tout à coup, le président et son gouvernement se réveillent : on est des héro·ïne·s, on est magnifiques, on part à la guerre… c’est ridicule !
On n’a pas trop le temps, là, de s’arrêter à ce genre de choses, il y a des patient·e·s par milliers et il faut d’abord qu’on les prenne en charge. C’est ça l’urgence et les journées en ce moment sont difficiles. Celles à venir vont l’être encore plus, tant en termes de fatigue que de risques d’avoir à faire des choix éthiques difficiles et d’avoir à choisir si on a vraiment une saturation du système. Si on en arrive là, cela va être difficile à supporter pour les équipes. Donc là on a vraiment d’autres chats à fouetter, mais il faut le noter dans un coin. Et après il faudra demander des comptes.

Pendant plus d’un an, la réponse à nos revendications a été : pas de réponse ou des mesurettes qui faisaient l’effet d’une rustine. Tout à coup, le président dit que tous les moyens nécessaires seront débloqués et que la santé n’a pas de prix. Les promesses n’engagent que ceux qui les croient, mais on ne manquera pas de lui rappeler toutes ses citations in extenso, et notamment celle où il dit que la santé n’a pas de prix. Ça n’est pas valable que pendant une pandémie, c’est valable tout le temps.
Ce n’est pas une guerre. Ce qui serait plus adapté ce serait de parler de médecine de catastrophe. Il faut se calmer avec ce genre d’imagerie. Mobiliser le patriotisme comme ça, c’est une excuse pour faire passer des lois qui vont encore plus casser le Code du travail et précariser certains secteurs. Et, évidemment, si on proteste contre ça, on va être taxé d’anti-France. Le ressort du patriotisme, c’est de faire taire la critique parce qu’il faudrait que tout le monde converge dans une même direction.
« On se remobilisera après, une fois qu’on pourra recommencer des activités un peu plus normales »
Ce genre de crise, ça peut aussi être l’occasion de repenser nos modes de fonctionnement. Pourquoi on a des défauts d’approvisionnement en masques ? Parce que tout a été délocalisé en Chine en termes de production et que, quand la Chine s’est arrêtée, les productions de masques se sont arrêtées aussi. La production locale ça coûte plus cher, mais ça a aussi certains avantages. Une fois que cette crise sera passée, il faudra se poser les bonnes questions. Il faudra revenir vers nos dirigeant·e·s et leur demander des comptes et voir ce qu’on peut changer.
Ça fait chaud au cœur d’entendre des applaudissements et les encouragements. Faut pas oublier que tout est politique et donc que le nerf de la guerre c’est des moyens, du personnel, des lits d’hospitalisation, du matériel c’est-à-dire de l’argent. Donc il ne faut pas hésiter à afficher non seulement son soutien, mais aussi de vraies revendications politiques. Ça peut être en les criant, ça peut être en les affichant. J’ai vu quelques pancartes comme ça, ça me fait encore plus chaud au cœur, finalement.

Et il ne faudra pas l’oublier après. Les problèmes structurels de l’hôpital public persisteront après cette pandémie. Il faudra continuer à appuyer ces demandes, ces revendications. Il faut soutenir aussi les autres personnes qui travaillent dans les secteurs en tension, qui n’ont pas le choix de télétravailler : les pompier·ère·s, les ambulancier·ère·s, toutes les personnes dans l’alimentation, du producteur·trice jusqu’à la caissière ou au caissier et la liste n’est pas exhaustive. Ils et elles travaillent dans des conditions de protection souvent très loin d’être optimales.