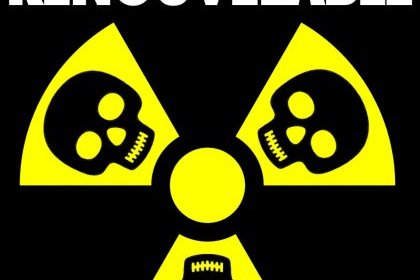Paru à l’origine sur le site de Bureburebure.info
Un petit extrait de l’article ci-dessous. Il est possible de télécharger l’intégralité de l’article mis en brochure ici :
Version page par page : les bas-fonds du capital
Version livret par ici : les bas-fonds du capital- livret
Le site de Z par ici : http://www.zite.fr/
« C’est dans la mine que la production continue apparut pour la première fois »
C’est d’abord à partir de l’Europe que les métaux, exploités depuis l’Antiquité, ont commencé à irriguer le capitalisme naissant : dès le XVe siècle, les mines allemandes étaient en plein essor, et l’immense fortune des Fugger a été accumulée grâce aux mines de cuivre et de plomb d’Autriche et d’Espagne. D’après l’historien Lewis Mumford, les lourds investissements nécessaires au développement de système de pompage, de ventilation et de transport ont dès cette période donné à ces entreprises plusieurs traits caractéristiques de l’industrie du XIXe siècle : sociétés par actions et propriétaires absents, expropriation des ouvriers-proriétaires devenus simples salariés et « suppression des pouvoirs corporatifs par coalition des propriétaires de mines et de la noblesse féodale ». Dès le milieu du XVe siècle, le statut des mineurs, travailleurs « libres », c’est-à-dire non protégés, préfigure celui des salariés déshérités du XIXe.
En 1950, Lewis Mumford considère que la nature même de l’activité des mineurs de fond a façonné jusqu’au visage du travail industriel : un « assaut sans défaillance contre l’environnement physique », une besogne répétitive, coupée des cycles vitaux et tout entière tournée vers la productivité. « La mine est le premier environnement complètement inorganique créé par l’homme et dans lequel il vit », écrit l’historien, le « triomphe du “milieu conditionné” » : « le jour a été aboli et le rythme de la nature brisé (…). La production continue, de jour et de nuit, est ici apparue pour la première fois. (…) Dans les galeries et les couloirs souterrains de la mine, rien ne distrait le mineur (…). Ici, c’est le cadre restreint du travail, du travail rébarbatif, sans répit, concentré. »
Plongés dans l’enfer d’un travail qui prend bel et bien les traits d’une malédiction, les mineurs tendent à vouer leurs gains à des cultes magiques d’invocation de la richesse qui font écho à celui de l’activité minière : « Débarrassé de son travail, le mineur risque sa chance aux cartes, aux dés, aux courses, dans l’espoir qu’il en recevra le gain rapide qui lui évitera les efforts pénibles de la mine. »
Ainsi, conclut l’historien, « les pratiques de la mine ne restent pas en sous-sol. Elles affectent le mineur lui-même et elles altèrent la surface de la Terre. » Dans l’Amérique conquise par les Européens, c’est sur le modèle de l’extraction de métaux précieux que se sont constituées les grandes économies de plantation apparues à partir du XVe siècle : sucre, cacao, tabac, café, caoutchouc, etc. C’est précisément cette exportation des pratiques et des finalités de l’extraction minière, du sous-sol vers le sol, que désigne le terme « extractivisme », apparu en Amérique latine dans les années 2000. Qu’il s’agisse de minerais, de pétrole, de bois, de soja, de maïs, ou de noix de cajou, ces productions ont en commun de viser à extraire un maximum de ressources en un temps minimal, au prix d’une transformation radicale du milieu et à un rythme incompatible avec le renouvellement naturel. Destinées à l’approvisionnement d’un marché mondial, ces denrées ont toujours une dimension abstraite, éloignée de la subsistance immédiate de celles et ceux qui les produisent, d’emblée conçues en termes de rendement financier et de retour sur investissement : si l’or, l’argent ou l’étain ne se mangent pas, on ne peut pas plus espérer vivre sur la base d’un régime de caoutchouc, d’huile de palme ou de cacao. Comme les métaux précieux, ces biens n’ont d’autre lien avec la subsistance que les salaires versés à leurs producteurs et productrices pour acheter les marchandises qui en découlent.
Pilier de la société extractiviste, véhicule historique du capitalisme industriel, qui lui doit sa monnaie, ses armes, ses machines (à commencer par la machine à vapeur, mise au point pour le pompage des mines de charbon) et toute la puissance de son productivisme hors-sol, l’industrie minière semble pourtant frappée d’invisibilité. Bien sûr, elle représente depuis les origines la part maudite de la civilisation - jusqu’à la fin du Moyen Âge, aucun individu libre n’était jamais entré dans une mine, où seuls travaillaient esclaves, prisonniers de guerre et repris de justice. Aujourd’hui encore, les 23,7 millions d’individus qui y descendent, des adolescents congolais aux mineurs boliviens, ont un statut social qui les prive de toute visibilité dans l’espace public. Et ce d’autant plus que les mineurs du secteur informel ou illégal, dit « small scale mining », composent l’immense majorité de ce cortège de travailleurs et de travailleuses : leur nombre est estimé à 20 millions.
Mais la mine a fini de disparaître de l’imaginaire collectif des pays riches au cours des cinquante dernières années, quand la division mondiale de la production et la révolution informatique ont permis à leurs habitant.es de s’imaginer que la société industrielle s’était dématérialisée, faisant place à une société de l’informatique aux technologies si miraculeuses qu’elles tombaient du ciel - ou du « cloud ».