Article initialement publié sur le blog Agitations
Nous proposons ici la traduction d’un article coécrit par un collectif d’épidémiologues, de biologistes et de mathématiciens marxistes étasuniens, qui revient en détail sur les causes structurelles de la pandémie du nouveau coronavirus que nous traversons, et qui n’a rien d’une catastrophe naturelle inévitable. S’échappant de la temporalité de l’urgence imposée par la totalité des gouvernements, il invite à repenser la sécurité sanitaire sur le long terme afin de prévenir l’émergence de nouvelles maladies mortelles.
Pour un éclairage sur la situation française en particulier et la gestion de classe de l’épidémie, nous invitons à lire notre article sur le sujet.
NB : Afin d’alléger la lecture, nous avons fait le choix de ne pas reproduire l’ensemble des sources scientifiques et renvoyons à la version originale du texte pour pouvoir les consulter.
(Image de la bannière : Atlas of Places – Iowa, USA)
Evaluation
Le Covid-19, la maladie engendrée par le coronavirus SARS-CoV-2, deuxième syndrome viral aigu apparu depuis 2002, est dorénavant officiellement une pandémie. En cette fin mars, des villes entières sont confinées et, l’un après l’autre, des hôpitaux passent en alerte rouge alors que les vagues de patients déferlent.
La Chine, où l’épidémie initiale se résorbe, reprend un peu son souffle. Il en va de même pour la Corée du Sud et Singapour. L’Europe, en particulier l’Espagne et l’Italie, mais de plus en plus d’autres pays aussi, ploient déjà sous le nombre de décès alors que l’épidémie n’en est qu’à ses débuts. L’Amérique du Sud et l’Afrique commencent déjà à accumuler les cas, certains pays se préparant mieux que d’autres. Pour les États-Unis, qui font office de baromètre en tant que pays le plus riche de l’histoire de l’humanité, les jours à venir s’annoncent sinistres. On estime que l’épidémie ne devrait pas atteindre son pic dans le pays avant le mois de mai, et les travailleur·euse·s du secteur de la santé ainsi que les usager·ère·s des hôpitaux s’empoignent pour avoir accès à des stocks d’équipement de protection individuelle qui vont s’amenuisant. Des infirmier·ère·s, à qui les CDC (les centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ont adressé l’effroyable recommandation d’utiliser des foulards et des écharpes en guise de masques, ont d’ores et déjà déclaré que « le système [était] condamné ».
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral continue à surenchérir pour l’acquisition de matériel médical, face à des États qu’il a refusé d’équiper au départ à ses frais. Il a aussi annoncé un renforcement des contrôles frontaliers en guise d’action de santé publique alors que le virus fait rage et qu’on le traite mal à l’intérieur même du pays. Une équipe d’épidémiologistes de l’Imperial College a estimé que la meilleure campagne d’atténuation – aplanir la courbe prévue des cas cumulés par une mise en quarantaine des cas détectés et la distanciation sociale des personnes âgées – conduirait tout de même à 1,1 million de morts aux États-Unis et nécessiterait près de 8 fois le nombre de lits en réanimation actuellement disponibles dans le pays. La suppression de la maladie, visant à éradiquer l’épidémie, conduirait à des mesures de santé publique comparables à celle de la Chine, quarantaine des patients (et des membres de la famille) et distanciation sociale pour tou·te·s, y compris la fermeture des institutions. Dans cette projection, le nombre de morts étasuniens serait ramené à près de 200 000.
Le groupe de l’Imperial College estime qu’une campagne parvenant à éradiquer la maladie devrait durer au moins 18 mois, entrainant une récession économique et un déclin des services publics. L’équipe suggère de contrebalancer les exigences en matière de contrôle sanitaire et économique en faisant alterner les périodes de quarantaine, déclenchées en fonction du niveau d’occupation des lits en réanimation.
D’autres, occupés à établir des modèles, sont allés dans le sens contraire. Un groupe dirigé par Nassim Taleb, célèbre pour sa théorie du « cygne noir », affirme que le modèle de l’Imperial College ne tient pas compte de la géolocalisation des contacts et de la surveillance porte-à-porte. Leur contre-argument ne tient pas compte du fait que l’épidémie a passé outre la volonté de nombreux gouvernements d’établir ce genre de cordon sanitaire. Ce n’est qu’avec le recul de l’épidémie que de nombreux pays envisageront de telles mesures comme appropriées, de pair, espérons-le, avec un test fonctionnel et précis. Comme l’a dit un petit malin : « Le coronavirus est trop radical. Il faut aux États-Unis un virus plus modéré auquel on peut répondre de façon graduée. »
Le groupe de Taleb souligne le refus de l’équipe de l’Imperial de rechercher sous quelles conditions le virus pourra être éradiqué. Pareille extirpation [extinction locale NdA] ne signifie pas une absence de cas, mais un confinement suffisant de sorte que les cas isolés ne soient pas susceptibles de se propager. Seuls 5 % des sujets au contact d’un malade en Chine ont été par la suite infectés. Concrètement, l’équipe de Taleb donne la faveur au programme d’éradication chinois, allant assez vite pour éliminer l’épidémie sans se lancer dans un marathon de danse oscillant entre contrôle sanitaire et approvisionnement de l’économie en main-d’œuvre. En d’autres termes, l’approche rigoureuse (et faisant un usage intensif de ressources) dégage sa population d’un confinement long de plusieurs mois – voire même de plusieurs années – que recommande l’équipe de l’Imperial aux autres pays.
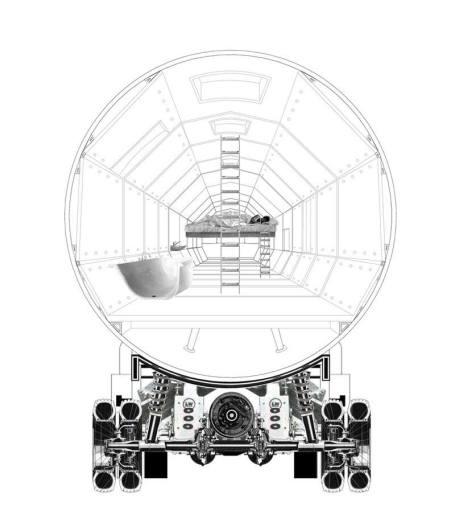
Le mathématicien épidémiologue Rodrick Wallace, l’un d’entre nous, renverse complètement la table des modélisations. Les modélisations d’urgence, pour nécessaires qu’elles soient, passent à côté de l’origine, géographique et temporelle, de l’épidémie. Les causes structurelles font tout autant partie de l’urgence. Les prendre en compte nous permet de comprendre quelle est la meilleure réponse en allant au-delà d’un simple redémarrage de l’économie qui est à l’origine des dégâts.
« Si l’on donne aux pompiers des ressources suffisantes, écrit Wallace, dans les conditions normales, la plupart des feux, le plus souvent, peuvent être maitrisés avec un minimum de pertes et de dommages. Pourtant, cet endiguement repose de façon critique sur une activité bien moins romantique, mais non moins héroïque, à savoir les continuels efforts de régulation qui visent à limiter les dangers des constructions par l’évolution des règlementations et leur application, et qui garantissent aussi que pour tout le monde la lutte contre les incendies, l’assainissement et l’entretien du bâti disposent des ressources nécessaires aux niveaux suffisants…
Le contexte joue dans la pandémie, et les structures politiques actuelles qui permettent à des multinationales agricoles d’accaparer leurs profits tout en externalisant et en socialisant les coûts, doivent se soumettre à une “application des règles” qui réinternalise ces coûts si l’on veut éviter des pandémies véritablement et massivement meurtrières dans un futur proche. »
L’échec dans la préparation et la réaction face à l’épidémie n’a pas commencé qu’en décembre quand les pays du monde entier n’ont pas été capables de réagir lorsque le Covid-19 s’est répandu hors de Wuhan. Aux États-Unis par exemple, il n’a pas commencé quand Donald Trump a démantelé le comité de préparation au risque pandémique au sein de son équipe de sécurité nationale ou quand il a laissé vacants 700 postes dans les CDC. Il n’a pas non plus débuté avec l’échec de l’administration fédérale à prendre des mesures sur la base d’une simulation pandémique de 2017 qui montrait que le pays était insuffisamment préparé. Pas plus au moment où, comme le disait une dépêche de Reuters, les États-Unis « avaient supprimé un poste d’expert du CDC pour la Chine, plusieurs mois avant l’irruption du virus », même si l’absence d’un expert étasunien au contact de la réalité du terrain chinois aux premiers stades de l’épidémie a très certainement affaibli la réaction des États-Unis. L’échec n’a pas non plus commencé avec la malencontreuse décision de ne pas utiliser les dispositifs de test déjà mis à disposition par l’OMS. Les retards dans l’information des premiers moments de l’épidémie combinés au raté total en matière de test se traduiront très certainement en de nombreuses vies perdues, probablement des milliers.
Les échecs ont été en fait programmés il y a des dizaines d’années, quand les intérêts communs en matière de santé publique ont été à la fois négligés et privatisés. Un pays assujetti à un traitement épidémiologique individualisé et en flux tendu – une contradiction pure et simple – avec à peine suffisamment de lits et d’équipements hospitaliers pour les opérations normales est, par définition, incapable de mobiliser les ressources nécessaires pour se lancer dans une éradication sur le mode chinois.
Reprenant le point de vue de l’équipe de Taleb sur les stratégies de modélisation en des termes plus ouvertement politiques, le spécialiste de l’écologie des maladies Luis Fernando Chaves, autre coauteur du présent article, convoque les biologistes dialectiques Richard Levins et Richard Lewontin afin de souligner que « laisser parler les chiffres » ne fait que masquer tous les présupposés que ceux-ci contiennent au préalable. Des modèles comme celui de l’étude de l’Imperial limitent ouvertement la portée de l’analyse à des questionnements étroitement délimités qui cadrent avec l’ordre social dominant. Ils s’interdisent délibérément d’envisager les forces du marché plus largement à l’œuvre dans les épidémies et les décisions politiques sous-jacentes aux interventions sanitaires.
Consciemment ou pas, les projections qui en découlent font passer la sécurité sanitaire de tou·te·s au second plan, y compris les milliers de gens les plus vulnérables, qui risquent de mourir si un pays se livrait à ce va-et-vient entre contrôle sanitaire et économie. La vision foucaldienne d’un État agissant sur sa population pour son intérêt propre ne fait qu’actualiser, même si c’est sous une forme plus bénigne, la poussée malthusienne du gouvernement conservateur britannique en faveur d’une immunité collective, une idée dorénavant reprise par les Pays-Bas – permettant au virus de se répandre sans restriction parmi la population. Rien de concluant n’est avancé, si ce n’est un espoir idéologique que l’immunité collective garantirait l’arrêt de l’épidémie. Le virus peut complètement évoluer et ressurgir depuis la couverture immunitaire de la population.
Intervention
Quelles seraient alors les mesures à prendre ? Tout d’abord, nous devons comprendre qu’en réagissant à l’urgence de la bonne façon, nous nous confrontons à la fois à la nécessité et au danger.
Il faut que nous nationalisions les hôpitaux comme l’a fait l’Espagne en réponse à l’épidémie. Il faut accroitre massivement les tests et leur fréquence, comme le Sénégal l’a fait. Il faut socialiser les produits pharmaceutiques. Il faut assurer aux équipes médicales la meilleure protection pour ralentir l’érosion du personnel soignant. Il faut octroyer le droit de réparer les respirateurs et le reste de l’équipement médical. Il faut commencer à produire en masse des cocktails d’antiviraux tels que le Remdesivir et la chloroquine, cet antipaludéen à l’ancienne (de même que tout médicament prometteur) pendant que nous menons des études cliniques pour tester s’ils auront une efficacité hors du laboratoire. Il faudrait mettre en place un calendrier qui 1) contraindrait les entreprises à produire les respirateurs nécessaires et les équipements de protection individuelle dont ont besoin les travailleurs médicaux et 2) accorder la priorité aux zones où les besoins sont les plus importants.
Il nous faut mettre sur pied un corps pandémique massif pour fournir la main-d’œuvre – de la recherche au soin – qui réponde au niveau des exigences que le virus (et tout autre pathogène à venir) fait peser sur nous. Faire correspondre le nombre de cas à celui des lits dans les services de soins intensifs, le personnel et l’équipement nécessaire de sorte que la suppression puisse combler l’écart actuel dans le nombre de cas. En d’autres termes, nous ne devons pas nous résigner à seulement survivre au bombardement en cours du Covid-19 pour revenir au suivi des contacts et au confinement des cas pour amener la maladie en dessous de son seuil épidémique. Il faut embaucher suffisamment de gens pour identifier tous les foyers de Covid-19, l’un après l’autre et dès maintenant, puis leur fournir l’équipement de protection nécessaire, comme les masques appropriés. Ce faisant, il nous faut suspendre une société organisée autour de l’expropriation, depuis les propriétaires fonciers jusqu’aux sanctions prises à l’encontre d’autres pays, de sorte que les gens puissent survivre à la maladie et à son remède.
Toutefois, jusqu’à ce qu’un tel programme soit mis en place, la populace dans sa grande majorité est largement abandonnée. Tandis qu’une pression constante doit être exercée sur des gouvernements récalcitrants, dans l’esprit d’une tradition de mobilisation prolétarienne en grande partie disparue et vieille de 150 ans, les gens ordinaires valides devraient rejoindre les groupes d’entraide mutuelle et les organisations de quartier qui font leur apparition. Les professionnels de santé qui ne sont pas indispensables à leurs organisations devraient former ces groupes pour éviter que des actes de bienveillance ne contribuent à la diffusion du virus.
L’importance que nous accordons aux origines structurelles du virus pour la planification d’urgence nous donne un moyen de faire passer la protection des gens avant les profits à chaque avancée.
Un des nombreux dangers tient à la normalisation de la « folie furieuse » [littéralement, la folie des chauves-souris, NdT] en vigueur à l’heure actuelle, une dénomination toute trouvée étant donné le syndrome dont souffrent les malades – la proverbiale fiente de chauve-souris qui se retrouve dans leurs poumons. Il faut nous rappeler du choc que nous avons éprouvé quand nous avons appris qu’un autre virus SRAS était sorti de son habitat sauvage et qu’il s’était répandu dans toute l’humanité en l’affaire de 8 semaines. Le virus est apparu à une extrémité d’une ligne d’approvisionnement régionale en alimentation exotique, parvenant à déclencher une chaîne d’infections entre humains à l’autre extrémité, à Wuhan, en Chine. De là, l’épidémie s’est diffusée à la fois localement et a embarqué dans les avions et les trains, se répandant sur toute la planète à travers un réseau organisé autour des escales de voyageurs et le long d’une hiérarchie allant des petites aux grandes villes.

Outre les descriptions du marché alimentaire d’animaux sauvages sous un angle typiquement orientaliste, on s’est peu employé à répondre à la question la plus évidente. Comment le secteur des nourritures exotiques a-t-il pris une importance telle qu’il pouvait proposer ses produits en parallèle d’animaux d’élevage plus traditionnels sur le plus grand marché de Wuhan ? Les animaux n’étaient pas vendus depuis l’arrière d’une camionnette ou dans une ruelle. Songez aux permis et aux paiements que cela implique (et à la dérégulation qui s’y rattache). L’alimentation à base d’animaux sauvages constitue un secteur de plus en plus formalisé qui va bien au-delà des poissonneries, toujours plus capitalisé par les mêmes sources qui soutiennent la production industrielle. Même si le volume de ce qui est produit n’est absolument pas comparable, la distinction entre les deux tend dorénavant à disparaître.
Cette géographie économique présente des chevauchements qui s’étendent du marché de Wuhan à l’arrière-pays où les denrées alimentaires exotiques ou traditionnelles sont produites en bordure d’un espace naturel sauvage qui se rétrécit. La production industrielle gagnant sur ce qui reste de forêt, l’approvisionnement en aliments sauvages doit se faire toujours plus loin afin de collecter ces mets délicats ou en raflant ce qui reste disponible. En conséquence de quoi, le plus exotique des pathogènes, dans le cas présent le SRAS-2 dont les chauves-souris sont porteuses, se retrouve dans un camion, que ce soit dans les animaux destinés à la consommation ou les travailleurs qui les manipulent, occupant la place du mort dans un véhicule parcourant une circonférence périurbaine élargie, avant de débouler sur la scène mondiale.
Infiltration
La compréhension de ce lien doit être approfondie, si l’on veut planifier la suite de cette épidémie et comprendre comment l’humanité s’est laissé piéger de la sorte.
Certains agents pathogènes émergent tout droit des centres de production. Des bactéries d’origine alimentaire comme la salmonella ou le campylobacter viennent immédiatement à l’esprit. Mais bien d’autres, comme le COVID-19, trouvent leur origine aux frontières de la production capitaliste. En effet, au moins 60% des nouveaux agents pathogènes humains apparaissent par propagation depuis les animaux sauvages vers les communautés humaines locales (avant que les plus aptes ne se répandent sur le reste de la planète).
Un certain nombre de pontes du domaine de l’écosanté, dont certains sont financés pour partie par Colgate-Palmolive et Johnson & Johnson, sociétés à l’origine de la déforestation au bénéfice de l’agroalimentaire, ont mis au point une carte du monde basée sur les épidémies précédentes (remontant jusqu’en 1940) qui indique les zones où de nouveaux agents pathogènes sont le plus susceptibles d’apparaitre. Plus la couleur est chaude sur la carte, plus de chances il y a de voir un nouvel agent pathogène émerger à l’avenir. Mais en mêlant de telles géographies absolues – rouge vif en Chine, Inde, Indonésie et dans certaines parties de l’Amérique latine et de l’Afrique – la carte de cette équipe manque un point crucial. En se concentrant sur les zones d’épidémie, elle ignore les relations que partagent les acteurs économiques mondiaux et qui façonnent les épidémies.
Les intérêts du capital impliqué dans les transformations, provoquées par le développement de la production, de l’utilisation des sols et l’émergence de maladies dans les régions sous-développées du monde, récompensent les démarches qui mettent en cause les populations indigènes et leurs us culturels réputés « sales » dans la propagation des épidémies. La préparation de la viande de brousse et l’enterrement à domicile sont deux pratiques accusées de favoriser l’émergence de nouveaux agents pathogènes. A contrario, le repérage des géographies relationnelles transforme tout à coup New York, Londres et Hong Kong, cœurs stratégiques du capital mondial, en trois des pires points chauds de la planète.
Les zones d’épidémies, de l’autre côté, ne sont plus réparties selon les politiques traditionnelles. L’échange écologique inégal – qui impose les pires dégâts de l’agriculture industrielle aux pays du Sud – ne se contente plus de dépouiller les pouvoirs locaux de leurs ressources au profit de l’impérialisme d’État, il se transforme en nouveaux complexes de circuits de marchandises à toutes les échelles. L’agroalimentaire reconfigure ses activités extractivistes en réseaux discontinus dans l’espace, sur des territoires d’échelles différentes. Un ensemble de « Républiques du soja » soutenues par les multinationales, par exemple, s’étendent de la Bolivie au Brésil, en passant par le Paraguay et l’Argentine. Cette nouvelle géographie est incarnée par les changements dans les structures de gestions des entreprises, la capitalisation, la sous-traitance, les substitutions dans les chaînes logistiques, l’affermage, le regroupement transnational des terres. À cheval sur les frontières nationales, ces « États marchandises », qui franchissent avec flexibilité les frontières politiques et écologiques, produisent de nouvelles épidémiologies sur leur tracé.
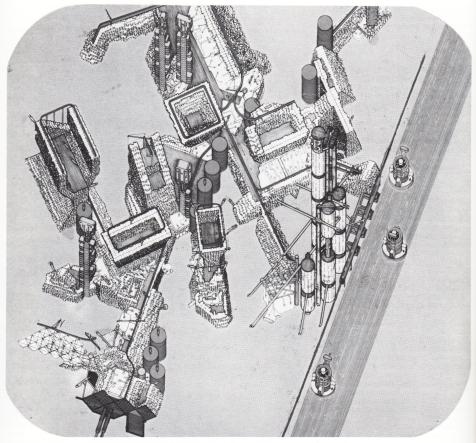
À titre d’exemple, malgré un mouvement général de la population des zones rurales marchandisées vers les bidonvilles urbains, toujours en cours à l’échelle mondiale, la séparation entre ville et campagne, qui occupe bien des discussions à propos de l’émergence de nouvelles maladies, ne tient pas compte de la main d’œuvre qui va travailler à la campagne et de la croissance rapide de villes rurales qui se transforment en desakotas (villes villages) ou zwischenstadt (entre-villes) périurbains. Mike Davis et d’autres ont montré comment ces nouveaux paysages urbanisés agissent à la fois comme marchés locaux et hubs régionaux pour la circulation des marchandises agricoles mondiales. Certaines de ces régions sont même devenues « postagricoles ». En conséquence, la mécanique des maladies forestières, source première des agents pathogènes, n’est plus limitée aux seuls arrière-pays. Les épidémiologies associées sont elles-mêmes devenues relationnelles, se faisant ressentir à travers le temps et l’espace. Un SRAS peut soudainement se propager aux habitants d’une grande ville, quelques jours seulement après être sorti de l’antre de chauves-souris.
Les écosystèmes dans lesquels ces virus « à l’état sauvage » étaient pour partie endigués par la complexité de la forêt tropicale sont radicalement uniformisés par la déforestation menée par le capital et à l’autre extrémité du développement périurbain, par les déficits en matière de santé publique et de systèmes sanitaires. Alors que de nombreux agents pathogènes selvatiques [relatifs à la forêt vierge équatoriale, NdA] périssent aux côtés de leurs espèces hôtes, un sous-ensemble d’infections qui, autrefois, s’éteignaient rapidement en forêt, ne serait-ce qu’en raison du taux irrégulier de rencontres avec leurs espèces hôtes typiques, se propagent maintenant dans les villes, parmi les populations humaines sensibles dont la vulnérabilité est amplifiée par les programmes d’austérité et le manque de régulation à cause de la corruption. Même si des vaccins efficaces sont disponibles, les épidémies actuelles sont caractérisées par une étendue, une durée et un dynamisme accrus. Ce qui autrefois n’était qu’une contagion locale est aujourd’hui une épidémie qui se diffuse parmi les réseaux mondiaux du transport et du commerce.
D’anciens classiques comme Ebola, Zika, la malaria et la fièvre jaune, qui ont relativement peu évolué, ont pris, par ce seul effet de parallaxe (un changement du seul contexte environnemental), une tournure dramatique pour devenir des menaces régionales. Ils ont cessé de se répandre parmi les villageois·e·s isolé·e·s pour infecter maintenant des milliers d’habitant·e·s de métropoles. Dans un autre sens écologique, même les animaux sauvages, qui sont des réservoirs de ces maladies de longue date, en subissent les conséquences. Du fait de leur nombre réduit et dispersé par la déforestation, les singes endémiques du Nouveau Monde sensibles à la fièvre jaune sauvage, à laquelle ils sont exposés depuis au moins un siècle, perdent leur immunité grégaire et meurent par centaines de milliers.
Expansion
L’agriculture marchande, par sa seule expansion mondiale, sert à la fois de moteur et de nœud par lequel les agents pathogènes de diverses origines migrent des réservoirs les plus reculés vers les plus importants centres de la population mondiale. C’est ici, en cours de route, que les nouveaux pathogènes s’immiscent dans les ghettos dorés de l’agriculture. Plus les chaînes logistiques reliées entre elles sont longues et la déforestation associée vaste, et plus les agents pathogènes zoonotiques qui entrent dans la chaîne alimentaire sont divers (et exotiques). On compte, parmi les pathogènes d’origine agricole et alimentaire, émergents ou réémergents, qui trouvent leur source hors du champ anthropogénique, Campylobaster, Campylobacter, Cryptosporidium, Cyclospora, Ebola Reston, E. coli O157:H7, la fièvre aphteuse, l’hépatite E, Listeria, le virus Nipah, la fièvre Q, Salmonella, Vibrio, Yersinia, et une variété de nouveaux virus influenza, dont les H1N1 (2009), H1N2v, H3N2v, H5N1, H5N2, H5Nx, H6N1, H7N1, H7N3, H7N7, H7N9 et H9N2.
La totalité de la chaîne de production, même si ce n’est pas intentionnel, est organisée autour de pratiques qui accélèrent l’évolution de la virulence des agents pathogènes et la transmission qui s’ensuit. La culture de monocultures génétiques – animaux et plantes alimentaires ayant des génomes quasi identiques – élimine les pare-feux immunitaires qui, dans les populations plus diverses, ralentissent la transmission. Les agents pathogènes peuvent maintenant évoluer rapidement parmi les génotypes communs de leurs hôtes. Tandis que la promiscuité réduit la réponse immunitaire.
La plus grande taille et densité de population des animaux d’élevage facilite une plus importante transmission et la récurrence des infections. Le rendement élevé, propre à toute production industrielle, fournit un flot continu d’hôtes sensible au niveau de l’étable, de la ferme et de la zone, supprimant ainsi tout plafonnement à la progression de la mortalité des agents pathogènes.
Regrouper ensemble de nombreuses bêtes valorise les souches les plus aptes à les consumer. L’abaissement de l’âge de l’abattage – à six semaines chez les poulets – permet de sélectionner les agents pathogènes capables de survivre aux systèmes immunitaires les plus solides. L’élargissement géographique de la portée du commerce et de l’exportation d’animaux vivants a accru la diversité des segments génomiques que les agents pathogènes associés échangent, augmentant le rythme auquel les agents exploitent leurs possibilités évolutives.
Alors que les agents pathogènes progressent par ces multiples voies, il n’y que peu ou pas d’interventions, même à la demande de l’industrie, si l’on écarte tout ce qui est mis en œuvre pour sauver les marges fiscales trimestrielles de l’urgence soudaine d’une épidémie. La tendance est à la diminution des inspections gouvernementales dans les exploitations agricoles et les usines de transformation, à la législation contre la surveillance gouvernementale et les rapports des militant·es d’ONG, et à la législation contre la couverture médiatique des détails des épidémies – même mortelles. Malgré de récentes victoires contre les pesticides ou la pollution au lisier, le commandement privé de la production reste centré sur la recherche de profit. En conséquence, les dommages causés par les épidémies sont externalisés vers le bétail, les cultures, la faune, les travailleur·euse·s, les gouvernements nationaux, les systèmes de santé publique et les systèmes agraires alternatifs à l’étranger, et tout ceci est une question de priorité nationale. Aux États-Unis, le CDC signale que les foyers d’épidémies d’origine alimentaire se multiplient, en termes de nombre d’États touchés et de personnes infectées.
Autrement dit, l’aliénation qu’est le capital joue en faveur des agents pathogènes. Alors que l’intérêt public est évincé à l’entrée des fermes et des usines alimentaires, les agents pathogènes passent au travers de la biosécurité que l’industrie est prête à financer, pour se retourner vers le public. La production quotidienne constitue un lucratif risque moral qui se nourrit de la santé commune.

Libération
Il y a une ironie certaine et révélatrice à voir New York, l’une des plus grandes villes du monde, placée en confinement contre le Covid-19, à plus d’un océan de distance de la source du virus. Des millions de New-Yorkais·e·s se terrent dans un parc immobilier placé jusqu’à peu sous la supervision d’une certaine Alicia Glen, qui fut jusqu’en 2018 la déléguée municipale en charge du développement foncier et économique. Glen est une ancienne cadre de Goldman Sachs, à la tête du groupe d’investissements urbains de l’entreprise, chargé de financer les communautés que les autres entités de la firme maintiennent socialement à l’écart.
Glen ne peut bien entendu pas être tenue pour responsable de l’épidémie, mais elle symbolise une connexion particulièrement frappante. Trois ans avant d’être embauchée par la ville, au cours d’une crise du logement et d’une importante récession à laquelle la municipalité avait largement contribué, son ancien employeur, de pair avec JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo & Co. et Morgan Stanley, se sont vu attribuer 63 % des refinancements fédéraux d’urgence. Goldman Sachs, débarrassée de ses faux frais, s’est employée à diversifier ses portefeuilles d’actions en sortie de crise. Goldman Sachs a fait main basse sur 60 % des titres de Shuangui Investment and Development, une composante du géant chinois de l’agrobusiness qui a racheté l’entreprise états-unienne Smithfield Foods, le plus grand producteur de viande de porc du monde. Pour 300 millions de dollars, il a aussi raflé dix fermes aviaires de Fujian et Hunan, province voisine de Wuhan située bien à l’intérieur de la zone de capture des animaux sauvages consommés dans la ville. En s’associant à la Deutsche Bank, l’entreprise a aussi investi 300 millions de dollars dans l’élevage porcin dans les mêmes provinces.
Les relations géographiques que nous venons d’exposer se sont mises à circuler à contre-courant. Il y a en ce moment une pandémie qui frappe les administré·e·s de Glen, un appartement après l’autre, dans tout New York, plus grand épicentre du Covid-19. Mais il nous faut admettre que parmi l’ensemble des causes de l’épidémie, New York a au départ joué un rôle, même si en l’espèce la part des investissements de Goldman Sachs peut paraître mineure pour un système de la dimension de l’agriculture chinoise.
Les accusations xénophobes, depuis le « virus chinois » de Trump et au sein de tous les milieux libéraux, dissimulent les directions mondiales combinées de l’État et du capital. Les « frères ennemis », ainsi que Marx les nommait. Les morts et les dégâts subis par les travailleur·euse·s sur le champ de bataille, dans l’économie et dorénavant sur leurs lits, se débattant pour reprendre leur souffle, sont des manifestations tout autant de la concurrence entre des élites à la manœuvre pour des ressources naturelles qui s’amenuisent que des moyens communs de division et d’asservissement de la masse de l’humanité broyée dans les rouages de ces manigances.
Incontestablement, une pandémie engendrée par le mode de production capitaliste dont l’État est censé se charger peut ouvrir une perspective que les gestionnaires du système et ceux qui en bénéficient peuvent faire fructifier. À la mi-février, cinq sénateurs étasuniens et vingt députés ont liquidé pour des millions de dollars leurs actions dans des entreprises susceptibles d’être affectées par la pandémie à venir. Ces politiciens ont basé leurs transactions passées dans l’ombre sur des informations tenues secrètes, alors même que certains élus continuaient à reprendre publiquement les mots d’ordre du régime, affirmant que la pandémie ne portait pas ce type de menace.
Outre ce genre de larcins minables, la corruption aux États-Unis est systémique et caractéristique de la fin du cycle d’accumulation étasunien, lorsque le capital retire ses billes.
En comparaison, il y a quelque chose d’anachronique dans les efforts pour garder un robinet ouvert alors même qu’il est basé sur la réification par la finance de la réalité des écosystèmes primaires (et des épidémiologies qui en dépendent) dont elle dépend pour sa survie. Pour Goldman Sachs elle-même, la pandémie, comme d’autres crises auparavant, laisse « de la place pour la croissance » :
Nous partageons l’optimisme des différents experts et chercheurs en vaccin des entreprises de biotechnologie, fondé sur les progrès notables qui ont été faits en matière de thérapie et de vaccination jusqu’à ce jour. Nous pensons que la peur reculera quand ces avancées donneront leurs premières manifestations significatives…
Chercher à négocier un objectif possiblement à la baisse alors que la cible annuelle est fortement plus élevée peut convenir à des négociants au jour le jour, aux suiveurs de tendances et à certains gestionnaires de fonds d’investissement, mais pas aux investisseurs à long terme. Il est tout aussi important de garder à l’esprit qu’il n’y a aucune garantie que le marché atteigne les niveaux les plus bas ; niveaux qui pourraient être utilisés pour justifier de vendre aujourd’hui. D’un autre côté, nous estimons avec une certaine confiance que le marché finira par atteindre les objectifs les plus élevés étant donné la résilience et l’importance de l’économie étasunienne.
Et enfin, nous pensons que les niveaux actuels présentent une occasion d’augmenter lentement les niveaux de risque du/des portefeuille(s). Pour ceux susceptibles d’avoir un excédent de liquidités et qui disposent d’une certaine endurance sur la bonne attribution stratégique d’actifs, l’heure est à l’ajout incrémentiel d’actions S&P.
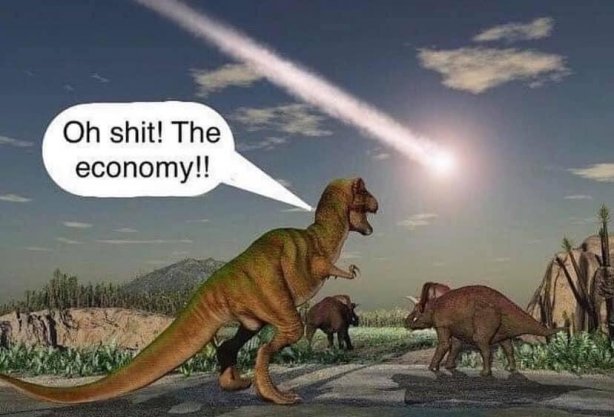
Horrifiés par le carnage en cours, les gens du monde entier tirent des conclusions différentes. Les circuits du capital et de la production sur lesquels les pathogènes laissent des empreintes semblables à des marqueurs radioactifs sont l’un après l’autre perçus comme déraisonnables.
Comment caractériser de tels systèmes, au-delà de l’épisodique et du circonstanciel, ce que nous avons fait précédemment ? Notre groupe s’emploie à mettre au point un modèle qui éclipse les tentatives de la médecine coloniale moderne qu’on retrouve dans l’écoépidémiologie et le mouvement One Health, qui continue à tenir les petits exploitants indigènes et locaux pour responsables de la déforestation qui conduit à l’émergence de maladies mortelles.
Notre théorie générale de l’émergence des maladies néolibérales, y compris en Chine, associe :
• Les circuits mondiaux du capital
• Le déploiement de ce même capital, détruisant la diversité environnementale régionale qui enraye la croissance des populations de pathogènes virulents
• Les hausses subséquentes des taux et de l’étendue taxonomique des évènements de contagion
• Les circuits marchands périurbains élargis qui expédient ces pathogènes nouvellement introduits dans l’élevage et la main-d’œuvre depuis l’arrière-pays le plus profond jusqu’aux villes de province
• Les réseaux mondiaux de transport (et de commerce de bétail) en pleine croissance, qui colportent ces pathogènes depuis ces mêmes villes jusqu’au reste du monde en un temps record
• La façon qu’ont ces réseaux de diminuer les frottements dans la transmission, opérant une sélection en faveur de l’évolution des pathogènes les plus mortels à la fois pour le bétail et les humains
• Et, entre autres choses imposées, la raréfaction de la reproduction sur site du bétail industriel, éliminant la sélection naturelle, un service rendu par les écosystèmes fournissant une protection contre les maladies en temps réel (et quasiment gratuite)
Le principe directeur sous-jacent est que la cause du COVID-19 ou d’autres pathogènes de ce type ne tiennent pas uniquement à l’agent infectieux ou à son évolution clinique, mais aussi au champ des rapports écosystémiques que le capital et d’autres causes structurelles ont constitués à leur avantage. La grande variété d’agents pathogènes, qui comprend plusieurs taxons, hôtes sources, modes de transmission, évolutions cliniques et résultats épidémiologiques, tous ces mots-clés qui nous poussent avec frénésie vers nos moteurs de recherche à chaque épidémie, jalonnent les différentes étapes et trajectoires le long des mêmes circuits d’accumulation de valeur et d’utilisation des sols.
Un programme général d’intervention se dessine en parallèle, bien au-delà d’un virus particulier.
Pour éviter les pires scénarios à venir, la désaliénation est la prochaine grande transition humaine : abandonner les idéologies colonisatrices, réintroduire l’humanité dans le cycle de régénération terrestre, et redécouvrir notre sens de l’individuation parmi les multitudes, au-delà du capital et de l’État. Cependant, l’économisme, la croyance selon laquelle l’économie est cause de toute chose, ne sera pas suffisante à notre libération. Le capitalisme mondial est une hydre à mille têtes, qui s’approprie, intègre et ordonne les multiples strates du rapport social. Le capitalisme agit à travers les champs complexes et connectés de la race, la classe et le genre, en vue de la mise en place de régimes de valeur régionaux.
Au risque de s’en remettre aux préceptes de ce que l’historienne Donna Haraway rejetait comme histoire du Salut – « pouvons-nous désamorcer, à temps, la bombe ? » – la désaliénation doit démanteler ces multiples hiérarchies oppressives et les modalités spécifiques et locales dans lesquelles elles se combinent à l’accumulation. Ce faisant, nous devons nous fuir les réappropriations du capital lors de son expansion au travers des matérialismes productifs, sociaux et symboliques. C’est-à-dire hors de ce qui n’est qu’un totalitarisme. Le capitalisme fait de toute chose une marchandise — l’exploration martienne par-ci, le sommeil par-là, les gisements de lithium, la réparation de respirateurs, la durabilité elle-même, et ainsi de suite, ses nombreuses métamorphoses se retrouvent bien au-delà de l’usine et de la ferme. La façon dont presque tout le monde, partout, est assujetti au marché, qui, dans un moment comme celui que nous traversons est de plus en plus incarné en la personne des politiciens, ne pourrait apparaitre plus nettement.
En bref, une intervention réussie, qui empêcherait l’un des nombreux agents pathogènes qui se pressent au portillon dans les circuits agroéconomiques de tuer un milliard de personnes, ne peut faire l’économie d’un affrontement mondial avec le capital et ses sbires locaux, indépendamment du nombre de fantassins de la bourgeoisie, parmi lesquels Glen, cherchant à limiter la casse. Comme notre groupe le dit dans un de nos derniers travaux, l’agrobusiness est en guerre contre la santé publique. Et la santé publique est en passe de perdre.
Si, toutefois, l’humanité dans sa plus large acception devait remporter ce conflit d’une génération, nous pourrions nous brancher à nouveau sur un métabolisme planétaire qui, bien que différemment incarné d’un lieu à l’autre, reconnecte nos écologies et nos économies. De tels idéaux sont plus que des considérations utopiques. En pensant de la sorte, nous trouvons aussi des solutions immédiates. Nous protégeons la complexité de la forêt qui, à son tour, empêche les agents pathogènes mortels d’embarquer sur des bataillons d’hôtes potentiels à portée du réseau mondial des transports. Nous réintroduisons une diversité du bétail et des cultures, et rétablissons l’élevage et l’agriculture à des échelles qui empêchent l’accroissement de la virulence et l’extension géographique des agents pathogènes. Nous laissons les bêtes destinées à notre alimentation se reproduire sur site, restaurant ainsi la sélection naturelle qui permet à l’évolution immunitaire de suivre les agents pathogènes en temps réel. Dans l’ensemble, nous cessons de traiter la nature et la communauté, si riche de ce qui est nécessaire à notre survie, comme des concurrents à écraser sur le marché.
La solution n’est rien moins que la naissance d’un monde (ou peut-être, tout compte fait, de redescendre sur Terre). Un tel dénouement permettra également de résoudre – en se retroussant les manches – bon nombre de nos problèmes les plus urgents. Aucun·e d’entre nous, confiné chez soi de New York à Pékin, ou pire, portant le deuil de ses morts, ne veut revivre une telle épidémie. Bien sûr, les maladies infectieuses, principale source de mortalité prématurée dans l’histoire de l’humanité, resteront une menace. Mais, si l’on considère le bestiaire actuel de pathogènes en circulation dont les plus redoutables se répandent désormais presque annuellement, le temps qui nous sépare de la prochaine épidémie mortelle sera bien plus court que l’accalmie centenaire qui durait depuis 1918. Sommes-nous capables de profondément adapter nos modes d’appropriation de la nature et parvenir ainsi à une trêve avec les infections ?
Pour d’autres articles sur le coronavirus, c’est par ici !


