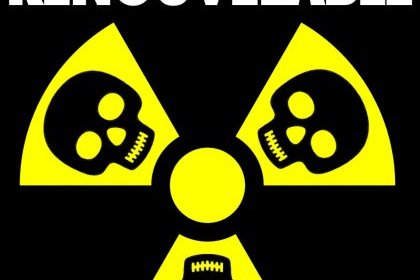Depuis le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, nous observons une incontestable montée en puissance des mouvements écologistes. Les marches pour le climat se sont multipliées, les jeunes se sont réveillés et les actions comme les décrochages de portraits se sont vues massivement médiatisées.
Cependant à force de lire et d’écouter les associations écologistes, on s’aperçoit que certains mots reviennent étonnamment fréquemment tandis que d’autres termes qu’on pourrait attendre sont aux abonnés absents.
L’écologie est politique donc s’inscrit pleinement dans une logique de lutte sociale. Une lutte ne peut exister sans un discours qui lui est attaché et qui la motive. Une analyse du langage qu’emploient les écolos est donc nécessaire. Bien entendu, on compte ici s’attacher à observer le discours majoritaire des associations qui façonnent la lutte comme Greenpeace, ANV-COP21, Youth For Climate, etc.
Il est évident qu’il existe des structures (malheureusement) marginalisées avec un discours tout autre.
I. Comment désigner le problème ?
Beaucoup n’ont de cesse de critiquer le caractère anxiogène des messages de défense de l’environnement. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux de différentes organisations pour observer que les tournures « il est urgent d’agir », « urgence climatique » sont récurrentes.
L’urgence, c’est ce « qui requiert une action, une décision immédiate » [1]. Dès lors, on entrevoit nettement, d’une part le caractère de nécessité et le besoin de rapidité et d’autre part le besoin d’agir.
Dans ce sens, l’écologie est anxiogène, car est la seule lutte à être limitée par des contraintes temporelles : lutter dans 40 ans pour la planète n’aura sûrement plus aucun sens, car il sera trop tard et ce message est bien retransmis par le discours vert.
Cependant, l’emploi du mot « urgence » est problématique. Car ce discours que nous désignons existe en fait depuis la fin du XXe siècle. Comment croire qu’après vingt ans à dénoncer l’urgence le terme ne perde en substance ?
Par définition, il n’existe rien qui appelle de réponse plus immédiate qu’une situation urgente. Si la situation était bel et bien urgente il y a vingt ans (et elle l’était), alors elle l’est encore davantage aujourd’hui.
Cependant, plus aucun mot ne permet de retranscrire la nécessité d’une action toujours plus immédiate, car le mot urgence a trop été usé et rien ne le dépasse en intensité.
Mais dans la manière qu’ont les écologistes d’évoquer les raisons de leur lutte, un autre emploi de terme apparaît à questionner.
Les militants n’ont de cesse de condamner « l’inaction ». Par ailleurs, leurs actions sont bien souvent justifiées par cette « inaction climatique ». Or, a-t-on déjà vu des syndicalistes s’élever contre l’inaction des patrons en matière de justice sociale ? Bien entendu, non.
On pourrait répondre que l’inaction qui est visée est celle des gouvernements qui eux, sont tenus par des devoirs d’action de protection pour les citoyens contrairement aux entreprises.
Mais à nouveau, a-t-on déjà entendu un syndicaliste dénoncer l’inaction d’un gouvernement en matière de politique sociale ? Non, car les gouvernements ne sont en rien dans l’inaction, là est l’erreur commise par les ONG.
Bien au contraire, ceux-ci sont dans l’action acharnée en continuant coûte que coûte la mise en place de politiques économiques, agricoles et d’aménagement du territoire « climaticides ».
La lutte syndicale repose sur un constat qui est celui de l’insupportable condition du travailleur. Le constat de l’inaction n’est pas le bon pour justifier la lutte écologique, car il n’y a pas d’inaction, mais une action qui va dans le mauvais sens. Et quand bien même il y aurait inaction, de telles accusations ne pourraient être portées que contre quelqu’un tenu à des obligations morales c’est-à-dire seulement un État.
Le vocabulaire employé donnerait donc un caractère profondément étatique à la lutte ce qui serait ne pas désigner tous les ennemis de la lutte tout en comptant sur des institutions qui se révèlent, depuis toujours, incapables d’agir.
Notons que la lutte pour l’environnement prend depuis quelque temps l’initiative de criminaliser des politiques et un système détestables.
Les termes « climaticide » ou « écocide » sont des néologismes bienvenus pour désigner les crimes dont le système en place est responsable envers l’environnement. Au Royaume-Uni, il est intéressant d’observer qu’Extinction Rebellion porte comme revendication « Make ecocide law » (Faire loi l’écocide), ce qui traduit bien la volonté, au-delà de la criminalisation, de la judiciarisation de la destruction de la planète, ce qui implique de dénoncer la responsabilité des pollueurs de ce monde.
On peut ici entrevoir un renversement de la culpabilisation : on a d’abord culpabilisé les citoyens, des gens qui n’y sont pour pas grand-chose dans ce désastre, on criminalise enfin les vrais responsables, les vraies sources du problème.
Malgré tout, il semble que l’écologie dans son message pratique l’autocensure ou refuse de reconnaître que le problème est le capitalisme.
Il est indéniable que notre système économique n’est pas soutenable. Or ce système économique est tout autant politique que l’écologie. Il y a donc une bataille des faits et des idées à mener en ce sens contre le capitalisme et le libéralisme.
Mais le problème est que ces deux mots ne font que trop peu voire pas du tout partie du vocabulaire des organisations environnementales. Celles-ci préféreront toujours les termes « productivisme » ou « consumérisme » et cela rend indiscernable l’ennemi : le capital.
Une lutte qui n’identifie pas clairement ses ennemis ne peut savoir où aller. Ce refus de dire la vérité est dramatique, car il est en partie responsable du fait que les idées oxymoriques de capitalisme vert et de croissance verte prolifèrent.
II Comment parler du combat ?
À l’heure actuelle, le moyen de lutte dont on a surtout écho, notamment depuis que Greta Thunberg a fait son effet, sont les « marches pour le climat ».
Dans la forme, il s’agit purement et simplement de manifestations, mais ça n’en porte pas le nom. Manifester c’est signifier une opinion, la revendiquer, l’exprimer publiquement. La manifestation est politique et offensive (ou du moins, devrait l’être).
Une marche n’est rien de tout cela. L’usage du mot « marche » au détriment du mot juste, manifestation, témoigne clairement d’une tentative de dépolitisation de la lutte.
À nouveau, il y a volonté de brouiller la réalité de la lutte. Les écologistes doivent accepter et revendiquer leur lutte et son caractère politique.
Pire encore, les écolos revendiquent l’exclusivité de la « non-violence ».
C’est leur ligne de défense majeure lorsqu’on les traîne en justice, lorsqu’on les gaze, ils sont non-violents. Il est difficile de ne pas voir que le vocabulaire utilisé n’a rien à voir avec la lutte et cherche à mettre en marge des mouvements de luttes traditionnels comme la lutte salariale. La lutte sociale passe par des manifestations qui connaissent, et c’est bien normal, des violences.
Cette distance marquée de manière volontaire avec les luttes traditionnelles empêche définitivement toute convergence pourtant nécessaire pour faire face au capitalisme qui est un ennemi commun.
Enfin, les écologistes se distinguent par un de leurs nouveaux modes d’action favoris : la « désobéissance civile ».
Ces termes ont pour la première fois été utilisés par un philosophe américain, Henry David Thoreau, au XIXe siècle. Celui-ci, opposé à la guerre contre le Mexique et l’esclavage, refusait de payer ses impôts. Thoreau imaginait la désobéissance civile comme un moyen d’empêcher clairement le gouvernement de mener à bien sa politique en diminuant ici ses sources de financement.
Qu’on parle des blocages de routes d’Extinction Rebellion, des décrochages de portraits présidentiels par ANV-COP21, ou des jets de peinture noire sur le siège de Total par ATTAC, en quoi ces actions empêchent-elles le bon fonctionnement du capitalisme ? En rien.
En fait, ces organisations se cachent derrière une idée puissante, mais la dépossèdent de sa force.
Le blocage d’Italie 2 lui, constituait bel et bien une action de désobéissance civile au sens de Thoreau dans la mesure où l’occupation était illégale et avait un réel impact (même si marginal) sur le capital en forçant la fermeture de nombreux commerces.
Il n’est pas acceptable d’user tout le temps du terme de désobéissance civile pour ériger en héros les participants à certaines actions qui ne sont en réalité que symboliques et sans effet.
Par rapport à la dimension originale du terme, les militants pour le climat ne cherchent pas à empêcher et bloquer les actes immoraux du système en place, tout n’est que médiatique ou symbolique.
En conclusion, il apparaît que par son langage, l’écologie cherche à se dépolitiser, cacher son caractère de lutte et son essence anticapitaliste.
Par ailleurs, son attachement à la non-violence empêche toute convergence des luttes et criminalise dans une certaine mesure la violence qu’on observe régulièrement dans les manifestations.
Même les tentatives de radicalité sont vaines et ne se font que dans les mots, car la désobéissance civile pratiquée n’apporte rien et n’est pas vraiment une désobéissance civile au sens historique du terme.
Il est urgent pour l’écologie de repenser son discours.