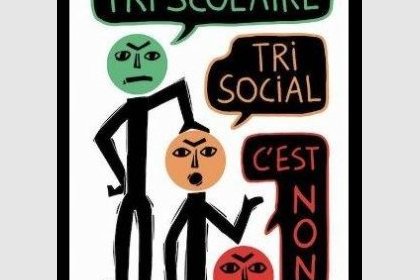Les luttes actuelles dans l’école et autour de l’école sont le produit d’une double crise. Tout d’abord, crise de « l’instruction » des enfants par l’école. Cette école contemporaine achève de dissoudre l’institution de l’éducation dans des « dispositifs de formation » qui doivent se prolonger « tout au long de la vie ». En tendance, la formation « professionnalise » les élèves en les adaptant à leur fonction de gestionnaires de leurs ressources humaines. L’État-nation n’est donc plus éducateur. Cette crise majeure de l’institution de l’éducation se combine avec une crise des finalités de l’école et des contenus et savoirs qu’elle est supposée transmettre.
Cette situation critique de l’école, instrumentalisée par le pouvoir d’État et ses « partenaires sociaux », n’est pas vraiment reconnue par les mouvements de lutte au sein de l’Éducation Nationale.
1 - Très souvent dans les arguments qui sont avancés pour défendre l’école publique, il y a une inversion de l’ordre logique. Alors que c’est parce que les conditions du service public se sont dégradées que l’idéologie du privé s’est crée progressivement une légitimité (gaspillage de l’argent public pour des résultats peu probants), il est proclamé que le service public fonctionne bien mis à part un manque de moyens et que c’est la Droite qui veut « la casse du service public ».
A l’évidence il y a là un double langage des enseignants. C’est celui de la défense de ce qui existe par crainte de ce que ce soit pire après. Cela nous condamne à refuser tous les projets de réforme parce qu’ils constitueraient une menace au lieu de s’en emparer quand justement on est dans le rapport de force établi par la lutte afin de sortir de la simple résistance et de prendre des initiatives.
Cette faiblesse dans l’offensive et l’alternative est évidente en ce qui concerne la question de l’autonomie. Dès qu’ils entendent ce mot, les enseignants pensent privatisation, régionalisation et autres pouvoirs locaux arbitraires. Mais se posent-ils la question de ce que peut être l’autonomie entendue non pas comme stratégie de gestion autocratique, mais comme moyen d’ouvrir des brèches dans l’organisation du statu quo ? Il y en a assez de subir et de se mettre sur le reculoir. Cela amène tous les mouvements récents à n’être que des mouvements de résistance à la merci du moindre recul de l’État. Cela fausse alors complètement les perspectives. Le retrait d’un projet est pris comme une grande victoire alors que ce n’est que le retour à une situation antérieure qu’on critiquait déjà !
Non seulement il n’y a aucune critique publique de l’Institution, mais, de fait, les enseignants en lutte se présentent encore comme les garants de l’existence de l’Institution face au marché. Ils se retrouvent donc dans la position de demander toujours plus d’État, ce qui concrètement veut dire : revenir à l’époque des années 60-70. Or l’ancienne régulation de l’État-providence n’opère plus, ce qui, par exemple au niveau de l’école, nous conduit à dire que « l’État n’est plus éducateur [1]
».
Ce qui est dommage, c’est qu’on a un décalage très important entre certaines formes de lutte et leur contenu. Dans les luttes actuelles on voit des enseignants prendre le risque de désobéir à leur hiérarchie et donc celui d’être sanctionnés pour manquement à la déontologie du fonctionnaire (servir l’État quoiqu’il en coûte), alors que le discours d’ensemble sonne très fonctionnaire, très responsable.
Ce double langage des enseignants trouve malheureusement son écho dans le double langage des lycéens. Tous les jours ils disent et montrent qu’ils ont trop de cours, trop de disciplines ce qui les conduit à pratiquer le zapping permanent. Or ils manifestent contre un projet qui justement baisserait le nombre d’heures de cours et faciliterait ce zapping. C’est donc bien pour autre chose qu’ils manifestent et même se révoltent. Ils pourraient pourtant profiter de la lutte pour dire qu’il y en a marre de l’échec scolaire mais aussi d’une « réussite » qui dépend de plus en plus d’un gavage répétitif avec des évaluations de plus en plus précoces. Ils ne le font pas... et ils se retrouvent devant des prétendus casseurs, lesquels sans forcément en faire l’analyse, expriment concrètement leur « ras-le-bol » devant des processus de relégation et de disqualification qui progressent. Des jeunes qui expriment aussi et ainsi leur mépris devant des grèves et des manifestations qui leur paraissent relever d’un rituel propre à une communauté scolaire à laquelle ils ne veulent (et ne peuvent) plus participer [2]
.
2 - La formation : une commune fausse conscience ?
Le double langage persiste quand il s’agit de formation des maîtres. Les IUFM d’abord critiqués à leur mise en place et affublés du sobriquet « d’instituts universitaires de formatage des maîtres » sont maintenant défendus au nom du « mieux vaut une formation que pas de formation du tout » ! Au lieu d’avancer on entérine les reculs !
Avec ou sans IUFM, c’est la professionnalisation de la formation des maîtres et de leurs activités qui sont à contester ; aussi bien dans les critères de recrutement au concours que dans les méthodes d’apprentissage et les contenus d’enseignement. L’inculcation du « geste professionnel » et de la « bonne pratique pédagogique » dont les nouveaux masters « enseignement » font leur credo constitue une normalisation de l’éducation lourde de conséquences.
3 – L’absence de toute critique du devenu de l’université et du rôle prépondérant de la recherche dans les nouvelles formes de domination.
Du côté enseignant nous avons une réaction de « corps » qui n’a que peu abordé la question des finalités de la recherche. C’est assez logique puisque le mouvement s’est présenté comme celui d’une défense des statuts sous la tutelle de l’État. Ce n’est donc pas la dépendance réelle de l’université vis-à-vis de la politique scientiste de l’État qui sera critiquée mais une « contre-réforme » néo-libérale qui s’attaquerait au service public pour marchandiser la recherche. Or, la notion de contre-réforme est complètement inappropriée pour caractériser les mesures Pécresse [3] puisqu’il s’agit d’une opération de rationalisation et d’optimisation de la gestion de l’enseignement supérieur et de la recherche qui vient compléter la LRU. Une contre-réforme présupposerait une action de réforme, or la réforme n’est plus possible puisqu’il n’y a plus de statu quo, de stabilité. L’État, aujourd’hui, n’a d’autre but que de dissoudre tout ce qui gêne sa fuite en avant, même si les contradictions à l’œuvre donnent plutôt l’impression d’une course en rond : le tourniquet de la société capitalisée.
L’idée de service public, en France du moins, n’est donc pas plus condamnée en soi dans le secteur tertiaire que le capital fixe ne l’est dans le secteur secondaire par la « crise financière ». Simplement, en tant qu’ils constituent des immobilisations de capital, des stocks de fonctionnaires et de locaux, les services publics ralentissent les flux d’une société capitalisée qui tend à s’organiser principalement sous la forme réseau. Il y a finalement peu d’idéologie là-dedans, au moins au départ. L’idéologie vient après comme surajoutée par des lobbies électoraux qu’on ose même plus appeler des partis politiques.
4 - Sur la lutte en cours, quelques réflexions nées de l’action.
Tout d’abord il faut voir que la lutte est complètement partie de la base au niveau des écoles primaires dans un lien enseignants-parents qui est une constante des luttes dans ce secteur depuis les grèves de 2000. Les collectifs de lutte développent de nouvelles formes d’action (désobéissance, occupation des écoles) qui se démarquent des contraintes légalistes de l’action syndicale. Ils mettent ainsi en porte à faux des organisations qui ne pensent qu’en termes de devoirs et de droits des fonctionnaires et non pas en terme de devoir d’insoumission. A ce propos, les luttes récentes autour des élèves et parents sans-papiers, ont activé cette dimension. Les lettres de désobéissance sont donc à prendre comme une prolongation de ces actions de résistance.
Ces actions tranchent avec le consensus citoyenniste de ces vingt dernières années et mettent en pratique une critique qui était jusqu’à là restée très idéologique dans la mesure où elle se cantonnait d’un côté à une dénonciation un peu aristocratique de la « soumission volontaire » de presque tous à l’État ou de l’autre à la traditionnelle critique gauchiste du « Police partout/Justice nulle part ».
Un autre élément a joué un grand rôle, c’est le fait de se trouver devant un gouvernement qui ne fait ni concertation préalable ni d’offre de négociation, même s’il doit reculer en fonction du rapport de force. Cela met les syndicats en porte à faux puisque leur légitimité ne tient plus qu’à leur capacité à négocier au sommet.
Cette position décalée par rapport à la lutte à la base à permis qu’apparaissent à nouveau des coordinations de collectifs en lutte qui ont pu tracer leur propre démarche et perspective d’action. Certes les contenus n’ont pas été suffisamment approfondis, mais il n’y a pas eu d’illusion sur les formes démocratiques des assemblées générales et autres réunions de collectifs. L’organisation est clairement pour l’action et uniquement pour l’action aux risques d’un certain activisme.
Quant aux étudiants, ils peinent à trouver un chemin dans la lutte actuelle. Ainsi, une des raisons de la « froideur » relative des étudiants vis-à-vis du mouvement actuel des enseignants-chercheurs ne repose-t-elle pas sur les positions de ces derniers en grande majorité favorables ou alors indifférents à la loi LRU pendant que leurs étudiants manifestaient avec vigueur leur opposition à la réforme ? Hésitants ou prudents, ils ont tout d’abord semblé accompagner le mouvement plus qu’ils n’y participaient, mais une certaine radicalisation est en train de se produire qui fait qu’aujourd’hui (au 14 mars) on compte 45 universités en grève dont plusieurs avec blocage.
Nous venons de parler de la méfiance des étudiants par rapport aux actions des enseignants-chercheurs, mais il s’agit aussi d’autre chose. Depuis la première révolte contre la loi LRU (2006) les étudiants semblent avoir perdu ce qui avait fait leur force, à savoir la capacité à trouver un bon moyen « technique » d’engendrer un rapport de force favorable (les blocages) et à entretenir un rapport entre minorité agissante et masse des étudiants permettant de transformer le refus de départ en un mouvement de contestation prolongé. Se sentant démunis, ils en appellent souvent à une mythique classe ouvrière ou au peuple pour élargir ce qu’ils ne peuvent approfondir.
5 - Qu’est-ce qui peut unir, de la maternelle à l’université, en passant par la recherche, les protagonistes de la lutte ? C’est cela qu’il faut faire ressortir collectivement dans des AG regroupant les différents niveaux. La volonté de convergence doit dépasser le simple aspect velléitaire. Approfondir les actions particulières (désobéissance, grève du bac) et unifier les actions collectives à portée universelle (refus d’une formation de plus en plus étriquée et fonctionnelle qui recouvre tous les niveaux de l’enseignement et de l’éducation) semble bien maintenant une épreuve de réalité pour le présent mouvement. Mais la difficulté, sa limite, c’est qu’il ne peut vraiment réaliser cela qu’en dépassant dans la lutte (pratique et théorique) ce qu’il est immédiatement (corps enseignant constitué, chercheur-expert, apprenant, parent, etc.).